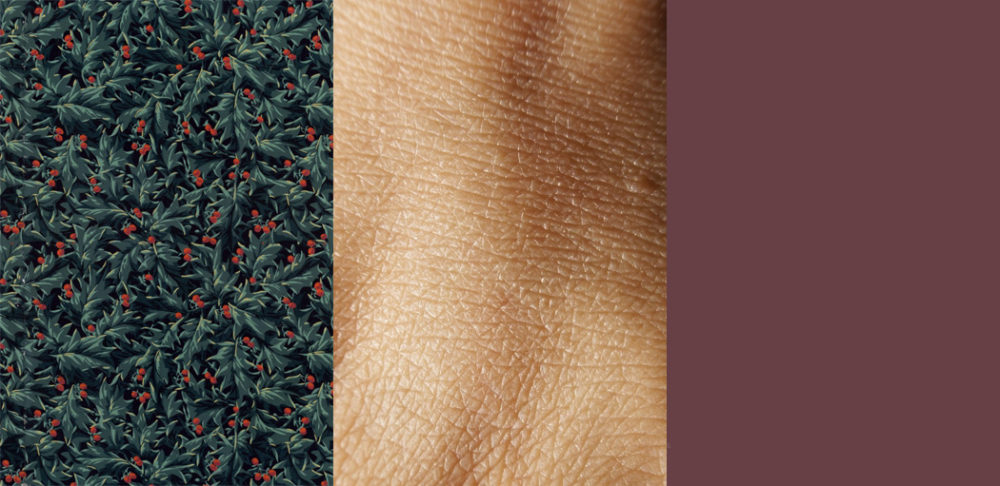Filles des premiers lilas,
vous descendez l’été
dans vos robes légères,
agrandissez le ciel
de vos sourires bleus.
Dans les prés et les champs
virevoltent vos rêves,
violettes énamourées
à vos lèvres dormantes.
A combien de peurs
vos peaux se sont-elles frottées ?
Combien de pleurs
avez-vous retenus
dans l’aube têtue
qui refuse de naître ?
Vous avez traversé
la glace, le feu,
indifférence et désamour,
mais la vie est plus forte
qui terrasse le cri,
mais la vie est plus vaste
où s’abîme la nuit.
Filles des flûtes d’or,
aux épaules en berceau,
vous descendez le temps
et vos cœurs unanimes
transcendent le néant.
Vous êtes messagères
de l’arbre, de la source, du vent.
A vos lèvres gourmandes
s’arrime le vivant
et l’horizon s’éclaire
de vos pas dans le soir.
*
Nous marchions en de vastes forêts.
L’air, vibrant et doux, crissait sous nos dents et dans nos bouches gourmandes installait sa demeure.
Tapi sous les frondaisons, l’été ronronnait. A sa ceinture, quelques javelles et un caillou, pour la soif.
Sans doute de frêles aurores nous avaient-elles précédés, abandonnant ici et là un filet d’encre mauve.
L’écriture naissait à chacun de nos pas, soulevant la croûte de sel.
Prestance des signes aux contours affermis.
Aux meules du soleil s’affinait la pâte odorante des mots.
Il faisait clair dans chaque tige, dans chaque syllabe.
Le vantail de la nuit avait enfin cédé, libérant flûtes et cymbales.
Combien de margelles avait-elle usées, cette eau arrogante qui venait on ne savait d’où, déployant ses tessons dans le creux de nos paumes, nous forçant à la lenteur et à l’humilité ?
Jusque dans la moindre brindille se hissait la force nue.
Et l’oiseau tournait, tout là-haut, au mitan de la page.
Allions-nous lui confier nos initiales sylvestres, l’âpreté de nos mains convalescentes ?
Enjôleuse, une voix nous incitait à plus de sollicitude : ‘’ Ne jamais oublier l’ample séjour du vent, là où se font et se défont les trombes claires du sang. ‘’
Et nous, de repriser, sous l’œil attentif des fougères, les ailes délabrées, les paroles vétustes et de rendre au matin sa partition immaculée.
C’est ainsi que nous devrions, dans la fraîche ordonnance du frêne, donner la parole à l’autre : à la colline qui s’impatiente, à l’arbre qui passe…au ciel qui peut s’indifférer.
Nous marchions en de vastes forêts, ébréchant, à chacun de nos pas, un peu plus de silence.
*
Qu’il ne reste qu’un semblant de terre,
qu’un bout de ciel
et la large poitrine du vent.
Nous y accoterons nos gestes clairs,
nos maisons rebâties
et la horde des mots
jamais prononcés.
Très haut,
là où la vie sauvage chante
et ne se retourne pas,
s’est rouverte la porte ancienne.
Le passage est intact
des voix diluviennes
et de la promesse des sources.
Chaque parole est un lieu où cheminer,
chaque silence s’élance au plus fort de la soif.
A la place des peurs,
nous mettons un printemps,
nos corps sont l’horizon
qui toujours refleurit.
Rien ne pèse, rien ne manque.
Tout s’envole et absout.
Nous ne savons pas le début.
Nous ignorons la fin.
Mais y a-t-il un début ?
Y a-t-il une fin ?
Jusque sous nos volets,
dans la moindre étincelle,
le vivant bourgeonne
et éclate en bouquets.
Qu’il ne reste qu’un semblant de terre,
qu’un bout de ciel
et la large poitrine du vent,
la graine est semée.
L’Amour peut voyager.
*