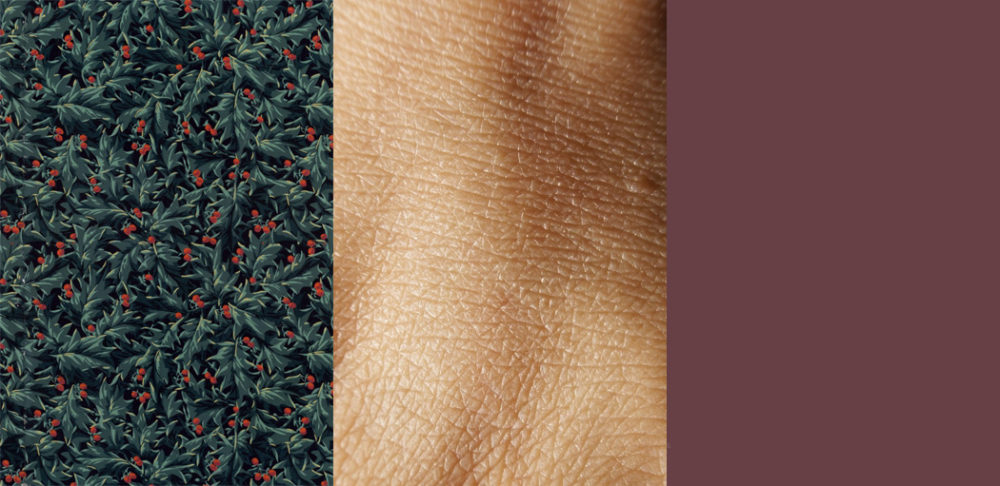Le hors-venu avait surgi un matin d’hiver dans un village du bas-pays. Il semblait chercher quelque chose.
Il n’était pas passé inaperçu. On crut qu’il était de passage, mais les jours se suivirent et il resta. On ne pouvait pas l’éviter. Il était sur tous les sentiers et dans tous les refuges.
Quand on l’avait vu une fois, on ne pouvait pas l’oublier. Il avait un air étrange. Son silence était singulier, son dire enivrant. Tous l’écoutaient sans broncher, l’œil fixe, la bouche ouverte. Ce qu’il disait enflammait l’esprit et figeait les sangs. Il forçait l’admiration et instillait l’angoisse. Après son passage, on s’affrontait verbalement : c’étaient des joutes interminables qui ne menaient à rien.
Et nul ne savait pourquoi il était venu. Il ne faisait pas grand-chose dans ces bois perdus. Il errait sans autre intention que de s’enivrer des chants d’oiseaux. Il allait auprès des souches pour les embraser. Il s’y réchauffait le corps. Puis, pour cuire son gibier, il brassait ces brûlis dont la fumée âcre rendait la brume épaisse. Le soir venu, il entrait dans les hameaux et parlait aux gens pendant des heures. Après sa venue, on s’oubliait en parleries et en disputes.
Les semaines passèrent.
Puis ce fut l’incendie. Pas à cause de lui, non. A cause d’escarbilles de fagots de saule que des bûcherons de la plaine avaient imprudemment jetés dans les flammes. Le feu ravagea d’abord les landes du haut, puis embrasa la forêt d’Ajoubes à la lisière de laquelle se trouvait le bourg de Sarche. Rien ne put barrer la route aux flammes. La réserve de la Banque Régionale, les réservoirs de la compagnie pétrolière et les soutes à munitions de l’armée, tout finit par exploser. Projetée au-dessus du gros village en ruines, une poussière d’or se répandit dans les halliers, dans les bosquets et se déposa sur tous les arbres qui étincelèrent bientôt sous le soleil ambré…
A dire vrai, il n’avait jamais envisagé de s’établir dans cette région de forêts. D’emblée, il avait senti que le pays n’était pas sûr. Des étrangers venus avant lui s’étaient infiltrés dans le terroir. Ils vivaient de rapine, de braconnage et de trafic. Assez rusés pour échapper aux agents forestiers, ils débroussaillaient les friches et faisaient semblant de cultiver la terre. Vivant dans des cabanes de fortune, ils refusaient de partir. Les autorités locales les soupçonnaient bien d’infractions, de déprédations et de saccages, mais, faute de preuve, elles ne faisaient rien, elles n’osaient pas s’aventurer dans les campements. Pourtant, de temps à autre, pour apaiser les gens du pays et conjurer leur colère, on capturait un pauvre hère qui s’était approché trop près du village et on le brûlait sans délai sur un bûcher dressé devant la Maison Centrale.
C’est ainsi que les gardes régionaux s’efforçaient de maintenir la paix en ces contrées sauvages. Malgré leur souci d’appliquer les directives du pouvoir, ils avaient un doute sur la probité du commandeur qui, dans la région, faisait appliquer les lois : il spéculait sur les matières premières, détournait les fonds public et caviardait les articles de loi.
Ce magistrat corrompu avait d’ailleurs envoyé les intellectuels au fin fond de la sylve, une dizaine d’individus éparpillés sur des centaines de kilomètres carrés, s’occuper de réguler la population d’oiseaux. Membres désignés d’une prétendue « brigade de protection ornithologique », ils étaient relégués dans le secteur le plus hostile et le plus accidenté de la région. Heureusement, ils bénéficiaient de la protection bienveillante des Sylvestranes, ces femmes des bois soumises à une prêtresse de la forêt que tous craignaient et qu’on appelait la maîtresse de la pluie. De temps à autre, on la voyait debout au sommet d’une colline crier dans sa corne de voix : « Il faut protéger les arbres. ». Les villageois avaient beau hausser les épaules dès qu’on parlait d’elle, nul n’osait plus aller couper les arbres de la forêt de Veltebrugue.
C’étaient de vastes bois qui tapissaient les vallées sinueuses du massif. On n’y trouvait jamais personne. Et pour cause. Les Sylvestranes étaient irascibles et supportaient mal la présence d’étrangers sur leurs terres sacrées. Les vagabonds frontaliers qui venaient parfois chercher des chutes d’écorce rare en savaient quelque chose. Malheur à celui qu’atteignait une de leurs flèches empoisonnées !
Jusqu’alors, le hors-venu avait supporté les intrusions des trafiquants, les embuscades des nomades et l’irrédentisme des Sylvestranes, mais désormais, étant donné la disparition du village et la dévastation des environs, il prit sa décision : ne plus rien dire à personne, partir, aller plus loin. Il passa donc les crêtes et entra, silencieux, dans le pays d’A-haut.
Dans cet autre ailleurs coupé du reste, on faisait comme on avait toujours fait. La nuit, sur les grands plateaux sans arbres, au milieu des champs immenses, les gardes des greniers communs passaient leurs nuits à contempler la lune, tout en surveillant les récoltes et en contrôlant le passage des dérivants sur les terres collectives, c’était la loi. On craignait les réseaux clandestins de subversion. On parlait de malfrats sans scrupules qui projetaient de dérober tous les stocks de grains pour les revendre sur la côte Est à des équipages d’Outrocéan. La commanderie n’accordait guère de crédit à ces rumeurs subreptices qui hantaient les esprits rustiques, mais il fut décidé de renforcer la garde en recrutant des miliciens. L’étranger s’engagea. Le travail, bien payé, n’était pas sans danger : la nuit, des attaques eurent lieu, surtout par les nuits sans lune. Plusieurs gardes et miliciens disparurent, comme happés par des choses indicibles qui gargouillaient dans le noir et disparaissaient dans les grottes.
C’en était trop pour lui. Il n’était pas d’ici et il ne voulait pas risquer sa vie pour les autres. Il s’esquiva un matin de brouillard et alla s’embarquer sur un navire pour des îles où il finirait peut-être par trouver qui il était vraiment. On ne le revit jamais, mais son souvenir persista, on imagina ce qu’il était devenu et le récit devint légende. Le temps passa. Bien plus tard, on se mit à douter. Avait-il, cet étranger, vraiment existé ? Ou bien n’était-il qu’un autre nous-mêmes ?