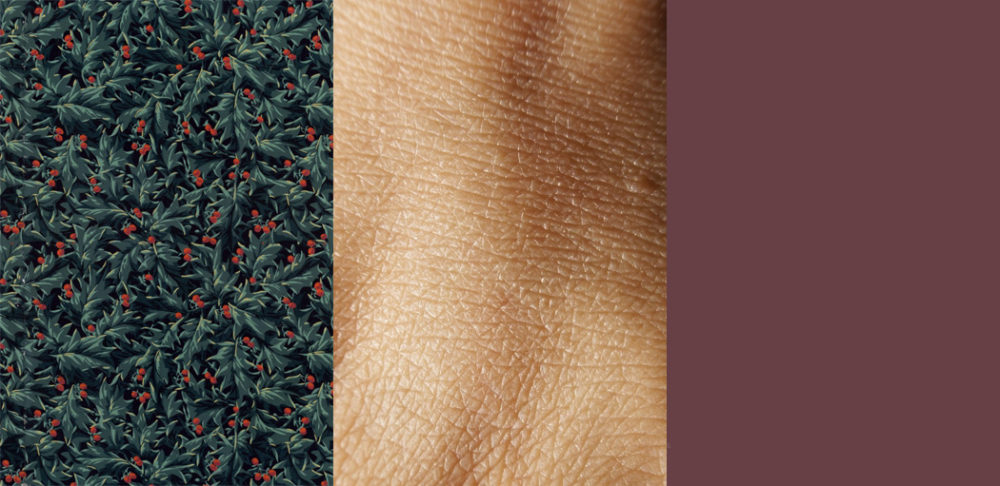Maho
Maho
François Rousseau, le cadet du philosophe dont on avait perdu la trace et que l’on a longtemps cru mort jeune, a vécu assez longtemps pour écrire à son célèbre frère une lettre, juste après la publication des Confessions. Dans celle-ci, il révèle certains faits qui éclairent la personnalité de l’auteur de cette monumentale autobiographie et relativisent quelque peu la portée de son Préambule.
A Paris le dix-huit du mois de juin de l’an de grâce 1770
Au grand Jean-Jacques, mon « frère »,
Je viens de faire l’acquisition du dernier livre que tu as réussi, malgré la censure qui te persécute, à faire publier chez le libraire Morgnier de Grenoble. Ces Confessions, comme tu les as intitulées, m’intriguent, je suis contraint de l’avouer, et, malgré la réticence et la difficulté que m’inflige une telle lecture, moi dont la vue n’a cessé de baisser depuis mon infortune, j’ai cependant commencé à prendre connaissance du Préambule et du premier chapitre de ton livre.
Il n’est point dans mes usages de porter quelque jugement que ce soit sur mes semblables, mais, dans le cas présent, il a été ardu pour moi de résister à l’envie de corriger quelques erreurs ou oublis dont tu t’es, sans aucun doute à ton corps défendant, rendu coupable. Je me suis longtemps contenu, mais je n’y tiens plus et le temps est venu de rendre clair ce qui baignait dans le flou et de ramener à la lumière ce qui errait dans les ténèbres.
Il est aisé de voir le penchant que tu as marqué insensiblement pour tes qualités plutôt que tes défauts : je compte, en effet, deux adjectifs pour tes vices, l’un, « méprisable », et l’autre, « vil », tandis que tu as pris grand soin d’en énumérer trois pour vanter tes vertus : bon, généreux et sublime. Or, aussi loin que ma mémoire peut remonter et admis le fait que d’innombrables années nous séparent de notre enfance, je n’ai pas souvenir chez toi d’une grande bonté ni d’une générosité remarquable. Je n’ai trouvé, dans le premier chapitre de tes Confessions dont tu loues avec tant de dévotion sacrée, la « franchise » aucune mention ni récit des tourments que tu me fis endurer lorsque j’étais petit enfant, comment tu venais la nuit, dans le noir le plus épais, me tirer les pieds sous les draps du lit en poussant des cris de bête féroce. Tu n’y dis rien non plus des menus larcins dont tu faisais de moi l’innocente victime en me dérobant les quelques sols que m’octroyait notre bonne tante. Et j’ai peine à croire que tu aies totalement effacé de ta mémoire le triste après-midi où tu avais placé, sur le siège de travail de l’atelier d’horlogerie de notre cher père, un perce-cul* de ta fabrication. Le souvenir que j’ai de l’ire du pauvre homme, justement courroucé de la douleur qu’infligeait à son fondement le métal barbelé enfoncé dans sa chair, m’émeut encore à l’heure où je t’écris ; mais c’est surtout l’infâme accusation que tu fis à mon égard auprès de notre géniteur, et qui déchaîna contre moi le cruel châtiment du martinet, qui m’attriste plus qu’il n’est permis. Si le séant du bon homme avait été en partie enflammé par le fer, le mien le fut entièrement par le cuir dont j’éprouvais la morsure de chaque lanière. A l’instant même où je t’écris ces mots, le grincement de la plume d’oie sur le vélin sonne comme un gémissement de souffrance et les brûlures acérées des coups de fouet toujours inscrites dans ma chair, je voudrais que tu les éprouves quand tu te présenteras, le livre à la main, devant l’Être éternel. Lui n’aura pas oublié ce forfait indigne, ce mensonge coupable, cette perversité honteuse qui fut la tienne, alors, envers le pauvre enfant que j’étais, moi, ton cadet vulnérable, ton petit frère.
J’avais l’intention expresse de t’adresser d’autres critiques à propos d’épisodes ultérieurs que tu as narrés avec trop « d’ornements », mais je me rends compte tout de suite que mon projet est vain : jamais, je le sais aujourd’hui – je te connais trop bien – tu n’avoueras les mauvaises actions qui t’importunent, tu n’as retenu que celles qui te grandissaient, même, et peut-être surtout, quand tu en fus la victime : c’est la manière la plus habile que tu as trouvée pour dissimuler ta vocation de bourreau. L’un de mes bons amis m’a révélé l’autre jour que tu avais écrit, dans un autre de tes ouvrages savants, que l’homme était né bon et que c’était la société qui l’avait corrompu. En ce sens, alors, je comprends mieux ce qui t’a induit à affirmer que tu n’es fait comme aucun de tes semblables, que tu es autre…
Je n’ai pas l’orgueilleuse prétention de croire que cette lettre de moi changera en quoi que ce soit le cours des choses qui émanent de toi car j’imagine fort bien que tu la destines, cette lettre importune, au feu de ton âtre, mais je m’étais promis de t’écrire pour que tu saches qu’il n’est pas forcément besoin d’attendre le jour du jugement dernier pour entendre la vérité sur soi.
Je ne me rendrai pas coupable de fourberie ni en te saluant fraternellement ni en te vouant une haine inextinguible. Je songe seulement avec quelque humaine compassion à l’instant fatal où l’Être éternel t’infligera, sans même daigner jeter un divin regard à ton livre, tous les brûlures de l’Enfer « à fond et sous la peau ». Tel est mon souhait le plus cher…
Le « petit » François Rousseau
( Lettres de François Rousseau à son frère Jean-Jacques – Éditions Fishbein, Bâle, 2005)
© Jean-Jacques Brouard, Récits corrosifs