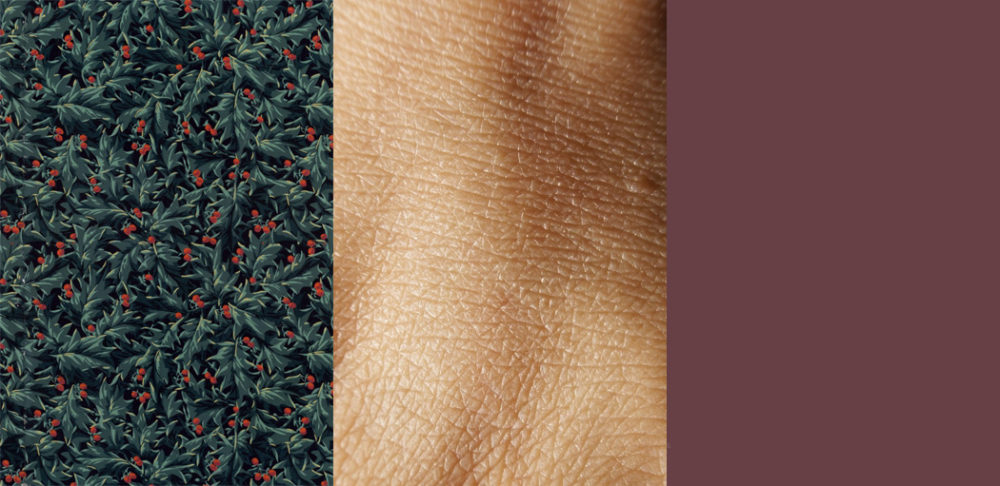Des écrits autour de la littérature: essais, chroniques, réflexions sur l’art de la parole.
——————————–
10 – Le festin des brumes (Ed. Unicité), d’Olivier Lechat. Un article de Miguel Ángel Real
« Le festin des brumes » d’Olivier Lechat (Ed. Unicité) est un livre sur le voyage. Mais d’une série de voyages qui n’a rien à voir avec l’émerveillement béat et superficiel des hordes de touristes : il s’agit d’une véritable fusion de l’être avec le monde. Ses poèmes nous rappellent le prélude de Debussy Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir, dont le titre est tiré d’un vers de Baudelaire, car nous sommes immergés dans un univers d’odeurs, de mouvement et de textures qui avancent vers une renaissance perpétuelle et sont composés dans un élan de curiosité très humaine, ce qui est également la définition même de la poésie.
Aucune indifférence n’est possible dans le parcours d’une vie, et cette volonté de ne pas être indifférent au monde se traduit par un désir de changement, que l’on observe dans des vers comme En chaque vie cicatrise une révolution ou N’y aurait-il pas comme une rébellion / De poètes assoiffés de sang. Le poète a donc une mission qui se construit dans l’humilité et le doute. Ce n’est pas un paradoxe car Olivier Lechat s’éloigne de tout nombrilisme et ne prend jamais la pose des poètes auto proclamés maudits : Et dans l’incognito,je serai / Votre chrysalide / Régurgitant les affres du monde.
Les poèmes du livre, organisés par ordre alphabétique à partir de leur titre, nous apportent leur devoir de mémoire, mais dans la fragilité qui jaillit des vagues souvenirs d’un futur décomposé. L’observation du monde n’est jamais superficielle : bien au contraire, le poète nous dit : Je tangue dans mes incertitudes et on constate que nous existons seulement dans les voyages, considérés comme un ultime lien qui relie les hommes aux hommes.
Malgré le pessimisme présent, le poète ne s’avoue pas vaincu, et veut constamment croire et s’appuyer sur la verve de l’humanité. Mais avant tout, Olivier Lechat nous transmettra sa colère face aux faux-semblants, aux désordres hypocrites qui sont le résultat d’une société de consommation dans laquelle on abandonne notre âme. Cette réalité est dénoncée de façon récurrente car nous l’être humain semble replié sur lui-même. Mais Qu’importe ! En ce labyrinthe des réels / La vie des uns se nourrit de l’étrange des autres. Nous sommes perdus dans le miroir de nos inconsistances alors que nous devons chercher la vérité dans l’échange et dans l’envie de retrouver les vraies valeurs de la poésie sans avoir peur, précisément de ce qui est considéré comme étrange.
Le poète a peur de ne pas profiter de la vie comme il se doit. Il veut la brûler sur des chemins interdits, en essayant de retrouver son âme d’enfant, ses souvenirs précieux qui bâtissent son être. Pour y parvenir, l’auteur insiste également sur l’importance de la parole et, par opposition, sur la lâcheté de ceux qui restent en silence. Il critique durement les charognards de la bonne parole et revendique constamment son humilité (Et le vent emportera le bruits de mes pas). Car le poète ne possède pas la vérité, il ne tient pas à nous convaincre, mais nous invite sans prétention à ouvrir les yeux pour accéder à un monde plein d’évocations, pour essayer de saisir les éloquences des effroyables beautés.
On ne doit donc pas avoir peur. Face au désordre du monde et à sa vacuité, le pouvoir de la poésie doit prévaloir comme un outil au service de nos rêves. Aussi utopique de que cela puisse paraître, l’environnement se voit sublimé par sa charge symbolique que nos sens doivent rechercher sans cesse, même si les hallucinations et les incongruités nous guettent. Car qui sait fleurir de sa propre magie / réinventera son histoire à chacun de ses pas. Il s’agit de mener un combat contre soi-même pour parvenir à percevoir la force dialectique d’un monde incongru, mais qu’on admire. On navigue ainsi, en équilibre instable, dans un monde vénal, décadent, mais qui fourmille de beauté. Et même si le désespoir pointe, même si l’optimise peut être une chimère, à chaque fois le poète nous dit : Ne perds pas espoir de ce monde / Je voudrais y croire.Ou encore : Que même sur un mur décrépi d’une tanière à rats / Vous trouverez le théorème de l’art du bonheur.
Voyager. Voyager toujours pour vivre le présent, le sublimer, et ainsi avoir une vision plus claire du passé, de l’enfance qui apparaît dans différents poèmes, comme dans « L’enfant des vignes » où l’on peut lire ceci : Il me faudra assurément déambuler / Au silence du désert du Namib / Et écouter les astres légendaires pour comprendre. Voyager loin des anecdotes, comme un acte de solidarité et d’empathie pour se réinventer à chaque bruissement du monde.
Un très beau recueil où l’on navigue entre affection et aversion de ce monde, qui nous invite à lâcher prise pour, en définitive, s’égarer au-delà des frontières / s’égarer au-delà de soi-même.
**********
9.- » Le sacrifice du géomètre » de Jean-Michel Maubert – Une lecture par Jean-Jacques Brouard
Le sacrifice du géomètre est le récit éponyme d’un recueil de sept textes qui nous transportent dans l’univers imaginaire de la Grèce antique, que l’auteur prend, à l’évidence, plaisir à recréer, avec une nostalgie presque métaphysique.
D’emblée, nous cédons au charme du discours poétique qui tisse le thème de l’énigme et de ses multiples variations. L’écriture de Jean-Michel Maubert est sobre, humble, noble, envoûtante… enfin – disons-le – belle. C’est l’écriture des mythes grecs, mais aussi celle des grands écrivains de l’étrange tels Bauchau, Bioy Casares, Gracq, Kafka, Borges… Une écriture cependant personnelle et originale, empreinte de singulière mélancolie, dont les ellipses et les figures nourrissent l’imaginaire, captivent la pensée et préservent toujours une part de mystère.
Dans l’univers de ce texte envoûtant, où le calme et la volupté sont chargés de bruit et de fureur, l’île est dans un labyrinthe, celui de la mer, « brillant à la manière d’un bouclier d’argent », une mer résolument gorgée de soleil « sous le bleu indigo du ciel », la mer d’Icare, à n’en point douter.
Le narrateur, Aristoclès, est, de prime abord, dans le pire des labyrinthes, celui de l’obscurité puisqu’il est amené sur ce rivage inconnu les yeux bandés. On veut absolument qu’il oublie la configuration du littoral et des îles environnantes : c’est que l’oubli aussi est un labyrinthe. Ensuite, Aristoclès nous dit que « le chemin menant à l’école du labyrinthe est lui-même un labyrinthe » et que « l’école est en elle-même un labyrinthe ». Habile mise en abîme à la manière d’Umberto Eco : un labyrinthe peut en cacher un autre. Et ce d’autant que, avant d’atteindre cette école, Aristoclès doit traverser une forêt d’arbres pétrifiés – encore un autre labyrinthe, naturel celui-là. Enfin lui apparaît « la masse cyclopéenne d’une vaste construction » dont il doit longer « l’hermétique paroi » avant d’en découvrir l’entrée. Le seuil passé, non seulement il se perd, mais il perd la faculté de penser « Les idées le fuyaient, semblables à des biches dans la brume forestière». Or s’il est une errance angoissante, c’est bien celle de la confusion de l’esprit.
Toutefois, le labyrinthe n’est pas désert : des formes apparaissent, des silhouettes masquées aux tuniques bariolées qui parlent une langue inconnue. Elles n’ont rien d’hostile et accueillent Aristoclès pour le guider. C’est alors qu’il doit suivre un parcours initiatique fait d’ascèse et de leçons de géométrie, de sculpture, de métallurgie, de poterie et de dessin prodiguées par des maîtres. Pour accéder à la révélation des mystères, il doit apprendre « comment inscrire sa pensée dans une masse minérale » et s’efforcer d’atteindre la perfection.
Apprenti « assidu et travailleur », il est alors autorisé à « écrire ses pensées sur des rouleaux de papyrus ». Il y exprime la pétrification que provoque en lui depuis l’enfance le sang versé, y décrit d’« atypiques petites créatures » qui peuplent le labyrinthe et le labyrinthe lui-même qui est « comme une cité » et qui contient d’autres labyrinthes où l’on exilent les bannis… C’est un espace en fractales qui « n’est jamais sûr » et au centre duquel se tient Dédale, l’inaccessible et invisible maître de l’école.
Pour accroître l’effrayante complexité du labyrinthe, l’auteur nous donne à imaginer une chambre des miroirs où il fait entrer Aristoclès : c’est un « labyrinthe optique » où « voir devient un supplice ». Ce lieu maudit instille dans l’être une « terrifiante panique » qui « émiette » la pensée et creuse dans l’esprit un labyrinthe « abyssal ». Pourtant, Aristoclès apprend à maîtriser sa pensée et parvient à sortir de cet « espace […] froissé ».
Peu après, toutefois, il doit subir une épreuve : sortir d’une partie du labyrinthe qu’il ne connaît pas, épreuve qu’il surmonte et à l’issue de laquelle il en arrive à méditer sur sa vie d’avant qui lui paraît lointaine. Il évoque des souvenirs d’enfance, l’éveil des sens au contact de la nature où vivaient en symbiose les « hommes de sa terre natale ». Il évoque aussi l’omniprésence de la mer qui a tissé sa pensée, modelé sa chair et qui, même si parfois elle « l’engloutissait dans des abîmes primitifs », était « une puissance bienfaitrice, sauvage et maternelle » qui « l’apaisait » et d’où il contemplait « le dessin ouaté du contour » des nuages. C’est là toute l’ambiguïté du labyrinthe océan.
Par ailleurs, le labyrinthe a une dimension esthétique : il en émane, en effet, un chant sibyllin. Et, dans « les circonvolutions des pierres », on y voit inscrite la danse cérémoniale des vierges sacrifiées au Minotaure, qui, précise le narrateur, est « lui-même labyrinthe de chair et d’esprit ».
Pour le narrateur et – à coup sûr – l’auteur lui-même, l’homme aussi est un labyrinthe : Aristoclès se dit à lui-même que « Le véritable labyrinthe, le labyrinthe accompli, est ton miroir. ». C’est qu’il a, à l’instar du narrateur du Joueur d’échecs qui pense des parties d’échecs, une « imagination architecturale », capable d’engendrer des « constructions d’une pureté presque abstraite ». Le labyrinthe, « fascinant miroir de pierre » apparaît donc comme la pierre de touche de l’âme humaine : seuls les cœurs purs et les esprits forts échappent à l’errance ; les êtres « sans fermeté d’âme» succombent au « venin glacé » de sa « morsure de serpent ». Aristoclès est pris dans la nuit comme dans un filet car il ne parvient plus à se laisser « engourdir dans les rythmes brumeux du sommeil. » Il est assailli par des « restes agonisants de mémoire », des « formes spectrales » qui le submergent d’une « mélancolie pernicieuse ».
A l’inverse, le géomètre Psychros, lui, « dort continuellement » et rêve de « figures » labyrinthiques « qu’il dessine dans son énigmatique sommeil. ». Antithèse paradoxale qui participe à la cartographie sémiotique de cet espace-temps aberrant.
L’espace de la fiction est lui-même un dédale fascinant peuplé de bêtes et de monstres… D’une part, Aristoclès rêve parfois qu’il est Le Minotaure. Ainsi, par cette subtilité, l’auteur parvient à nous livrer le discours intérieur du monstre, fait de sensations, de bribes de souvenirs, d’impressions primitives et de sentiments embryonnaires… Et on ne sait plus si les on-dit concernant Dédale émanent d’Aristoclès ou du Minotaure lui-même. Dans tous les cas, la révélation des vérités sur l’architecte, qui, au final, se révèle être un triple meurtrier, s’apparente à une démythification. Il aurait, en effet, tué son neveu Talos, le jumeau d’Icare et Icare lui-même, meurtres dont les Hamadryades ont été les témoins, témoins que nul ne peut menacer car elles ont « pour alliés et protecteurs les serpents , comme elles nés de la terre. ». Le fait est que, au fil du temps, Dédale a disparu « au cœur de l’édifice » ; et il est possible qu’il soit mort, d’autant que les couloirs ressemblent à l’Hadès, ce qui est assez logique puisque « ceux qui ont participé à sa construction ont tous disparu d’une façon ou d’une autre. »
Le bestiaire se compose aussi de « rongeurs glabres aux grands yeux » dont les apprentis architectes étudient le comportement dans de petits labyrinthes, du « requin » qui a dévoré la moitié du corps d’Icare, d’un arbre qui a l’apparence d’une « araignée végétale » et d’oiseaux qui, dès que la Pythis Thelxinoé leur parle, sont pris de « contorsions sauvages » et éprouvent une « faim dévorante, cherchant du sang, des chairs à déchirer, des yeux à crever. »
Enfin, il y a l’hamadryade, la femme-arbre « magnifique, nue, entrelacée à son arbre-père » ; créature femelle dont le chant, contrairement à celui des sirènes qui est un sortilège fatal, est source d’émotion et d’exaltation comme « une nuée mouvante d’oiseaux frôlant les blés». Créature très étrange, en effet, puisque, presque humaine, « ses reptations le long de l’arbre » l’apparentent au serpent, mais un serpent au corps et à la couleur indéfinissables qui semble « la plupart du temps n’être qu’un bourgeon surgissant du tronc massif »… Ce qui rend les hamadryades plus énigmatiques encore est le fait qu’elles parlent une langue inconnue et ont un savoir profond du pouvoir des plantes. On ne peut traiter avec elles qu’ « à travers des signes, des rites et des codes immuables ». Ce qui n’empêche pas Aristoclès d’aimer l’une d’entre elles et de s’unir à elle.
Toutes ces créatures étranges illustrent bien la nature même de la monstruosité qui est la combinaison, en un même être, du règne humain et du règne animal, pour le Minotaure, ou des règnes animal, humain et végétal pour l’hamadryade… D’une certaine manière, le labyrinthe aussi est monstrueux par son caractère hyperbolique : c’est la multiplication infinie et la complexité extrême de ses corridors qui en constituent l’essence tératologique.
Pourtant, si le labyrinthe est la demeure du monstre qu’est Astérion, il est aussi un palais pour les rois qui craignent d’être assassinés – comme l’a aussi suggéré Jorge-Luis Borges – ; aussi les fils de rois doivent-ils « apprendre l’art des labyrinthes ». Car le labyrinthe doit être « effrayant de complexité » : c’est donc un espace où règne l’ordre absolu de la géométrie qui exclut « l’imprévisible, l’inattendu, l’éclair dans la nuit, ce qui disloque les œuvres du logos. ». Aussi nul ne peut-il se représenter le labyrinthe – Il n’en existe qu’un « plan intégral » que « seul Dédale détient » – d’autant que « des prolongements tortueux […]sont en construction », des « agencements hypercomplexes » où se multiplient « les pièges et les faux-semblants ». Le labyrinthe est l’énigme. Ainsi, dans le dédale de ses rêves, Aristoclès rencontre « l’homme-labyrinthe » qui a « le secret des labyrinthes » tissé dans le corps par une « araignée-géomètre ». Et quand il meurt, on le dépèce pour « trouver en lui la texture géométrique et le chiffre secret des labyrinthes » que seuls quelques initiés peuvent lire. Or cet homme chiffré, Aristoclès finira par comprendre que c’est lui-même et que la fin est proche. La fin du labyrinthe, d’abord, victime de la « submersion par une monstrueuse végétation, rampante, mortelle » « réduisant en poudre absurde » les murs. Ou bien réduit, du fait de la prolifération de la guerre, à l’état de « ruines et braises refroidies ». Ou encore anéanti à cause même de la fusion érotique avec la Dryade, qui dès lors cède à l’hybris. La fin d’Aristoclès, ensuite, assailli par les cauchemars terrifiants, « signes prémonitoires » de sa propre mort. Après avoir échappé à l’étreinte du « long serpent blanc » de l’hamadryade, il décide, pour se venger, d’arracher celle-ci à son arbre pour la laisser dépérir « dans un endroit reculé du territoire ».
Puis, c’est dans un état d’ataraxie qu’il attend sa propre fin, contemplant dans « le miroir de son propre désespoir » le labyrinthe ; et méditant sur sa nature complexe qu’il se représente tantôt comme une « paradoxale mer verticale » qui l’empêche de se « représenter le monde extérieur » ; tantôt comme un « serpent minéral, aveugle sans mémoire […] effaçant les traces de nos passages » ; à la fois « espace de jeu pur » pour les rois et « piège et tombeau, ou une danse de l’espace avec lui-même ». Et l’auteur d’ajouter, au final, que « c’est le lieu du savoir et du non-savoir, de la peur des choses immémoriales » qui fait perdre « tout sens de la réalité », et où, dans « les brumes vénéneuses du soir », « lentement tout s’efface, inutile, comme ces embryons à peine formés qui ne sauront rien de la vie. ». En fait, peu importe qu’on soit « près d’un mur adjointé à d’autres murs », on est dans une « nuit pure, sans bords », « étendue illimitée » de vide qui nous absorbe. Et Jean-Michel Maubert fait Aristoclès, joyeux de pouvoir « tracer une ligne dont il faut penser la brisure serpentine », exprimer le désir de « construire le plus parfait labyrinthe, dont soi-même on ne peut sortir ». Et s’il demande que ses cendres soient dispersées là où la Dryade a dépéri, n’est-ce pas le symbole d’une éventuelle renaissance – comme un éternel retour de l’arbre de la connaissance dans l’infini du livre de sable ?
Jean-Jacques Brouard
****
8.- Des « Paysages ambulants » d’Arnaud Rivière Kéraval – un article de Jean-Jacques Brouard
Dès les premières pages de ce beau recueil, on décèle chez Arnaud Rivière Kéraval l’impérieux besoin d’un dialogue avec l’autre. L’échange verbal, gestuel, sensuel est constant, d’où les apostrophes, les injonctions, les appels…peut-être pour conjurer l’ « entropie de l’autre ». On sent l’envie constante de dire, d’adresser la parole, mais aussi d’interroger (« Pourquoi toujours franchir le tumulte des peines et fuir vers le champ insondable des ardeurs ? »). Comme tout bon poète, Arnaud doute et sait que la connaissance est une quête permanente de l’ailleurs et de l’autre qui ne se livre pas d’emblée : « Tu es mon énigme ».
Dans le mandala des arcanes, il opère une transmutation rimbaldienne du monde : les murs font surgir les « pavillons des vaisseaux conquérants». L’alchimie du poème agit par explosion d’images sibyllines qui remuent l’imagination (« De nobles voies lobées encerclent la frontière dermique, le filet signe la peau miroir qui se courbe »). Ce qui envoûte dans l’univers poétique d’Arnaud Rivière Kéraval, c’est la mystérieuse profondeur, l’ « attitude hermétique ». Énigme et illumination enchantent… « Les veines invisibles brûlent ton apogée »…
S’il y a de la démiurgie (« Oui enfin je vais changer. Les collines, tout, rien ne sera plus comme avant. ») comme si le monde était paradoxalement volupté et douleur (« Peur ? Les prières de démon fratricides vont aussi loin »), détestable et désirable, c’est presque toujours le désir qui l’emporte. Tout, en effet, dans cette poésie est sensualité. Le corps y est vivant, vibrant. Torse, hanches, poitrine, bras, épaules participent à ces noces avec la vie, la vraie vie. Car l’œuvre de chair n’est pas que caresses : « Ma peau, ce jardin falsifié. »… Et, parfois, au fil de la méditation, émergent « les îles de tourmente », les « ombres de mal ». Le poète perçoit le « murmure » de « la mort dans la tempête des sens ». Se noyer, sombrer semble être à la fois une crainte et un désir : « viens à mes messes catastrophiques ». Pourtant, l’aspiration à l’envol, le désir d’élévation prévaut encore : « Déploie tes ailes avant le noir » pour aller dans « l’arbre au-dessus des eaux ».
C’est de là qu’il contemple et éprouve : « l’œil [suit] les virgules de l’impression ». C’est le surgissement capturé des visions et des sens : les mots fracturent la phrase comme les sensations troublent la raison… Arnaud est sensible à la moindre vibration (« papillon de vie sur l’épaule nue »). Il nous offre la perception sensuelle d’un monde vaste et complexe dont la beauté jaillit du moindre « jardin de miel », des « montagnes infidèles », des « chants de pierre ». Il nous donne à voir un espace kaléidoscopique à la manière de Cendrars, où l’on peut se perdre « vers le large ». Un espace qui aspire : « Rien n’est plus songe, nous voyons tout », « les îles désertes », « le labyrinthe », « les champs vierges »… Pour capter « l’instant revêche qui résiste à l’éternel / L’instant qui englobe le monde et le charnel », le poète « inscri[t] des traits des obliques dans une langue intemporelle ». Sa poésie pourrait bien être un « subtil agrément, écorce de ma chair », « comme une preuve de mon passage ici », « histoire de venger les frasques volontaires ». Elle pourrait être aussi une inscription des corps sur « les feuilles d’or » du livre des désirs, la saga de l’éternel « duo éphémère ». C’est que « contempler est l’éternel recevant ». Et c’est une contemplation par tous les sens. En effet, si le « paysage est vivant », ce n’est pas seulement une anthropomorphisation : en fait, c’est le corps lui-même qui devient paysage. Le poète va « par les chemins de l’absence » retrouver « les plaines de l’épiderme » et « le désir s’apprivoise à l’orée de la montagne ». Il est avide de la révélation du mystère. « Mon chemin sent la direction des secrets » et « touche le calice de l’instant ». L’œil collé à la vitre du train, le poète nous invite à une déambulation dans les paysages. Ce qui fait la magie du train, c’est l’ailleurs qu’il promet d’atteindre ou l’ici qu’il permet de quitter. « Bientôt le train te délivrera de cet inventaire », de « la parade de l’opulence et de la réussite », des « mensonges de la destinée ». Dans le sillage de Valéry Larbaud, Arnaud Rivière Kéraval aspire à « partir » « loin des rumeurs de la ville », « quitter » pour « trouver », quitter pour « retrouver », « aimer », « marcher le long des quais »…Trouver et retrouver l’âme-frère « demandeur de voluptés » et si son « amour s’est enfui », il est « déjà parti respirer les corps au loin. ».
Toujours en quête du « monde sensible », d’un « nouveau monde », d’« une terre à découvrir », il aime « suivre et errer dans le monde », « horizon de pure instabilité ». L’aveu est clair : « Je vais un petit monde assoiffé » et « la folie des grands espaces m’appelle à son chevet ». La « randonnée » pour fuir « rutilant et accompli vers l’océan étoilé qui efface mes traces » jamais ne cesse : « L’aventure expire, mais c’est bon d’en redemander. ». Une aventure à l’issue incertaine qui tantôt est « flamboyance », tantôt déception, mais quand « l’équilibre faiblit », Arnaud « reste à la lisière », conscient que « les blessures existeront toujours ». On sent comme une résignation à vivre « la vie indicible et ses radeaux de fortune ». Et puis, c’est un désir inextinguible de la pulsation du monde qui éclate dans cette objurgation : « oublie de vivre mais vis à tout jamais. ». « Malgré le fil dédale, je reste ardent ». Pour Arnaud, la vie est un « vertige », à la fois « aura » et « supplice », « vers les limites de la mappemonde ». Ivre « des plus beaux soleils de sel, [des]plus beaux vols de nuit de miel de vie », il « joui[t]de ce statut infaillible », vivre pour « tant de rencontres éphémères dans le mouvement du désir » pour sauver « les écueils de la pierre solitaire »
Obstiné à « courir, voir, voler / s’entourer de toutes les flammes » … La quête de l’ailleurs est aussi celle de l’autre, celle de « la vie au détour d’un regard », de « l’accointance à son apogée ». « Je voudrais arrêter le temps, rompre ici le trait tendu de l’histoire, pour ne pas altérer la révélation de la nuit. » et il ajoute, plus loin, « Je mets les embuscades au service / des passions échappées.». La présence charnelle au monde atteint une dimension quasi mystique, tant le texte est traversé par le souffle du cosmos (« le vide s’accélère dévisage l’abîme / fort de mon envie de lumière »). Remué d’« aspirations nocturnes », contemplant « une constellation de grains de beauté », humant « les saveurs de l’autre », il demande : « Que feras-tu de mon désir, Grand escamoteur, quand la lune aura couché nos corps sur le chemin descendant ? ». Arnaud ne se départit jamais d’une amère lucidité dans l’observation « à la dérobée » de « l’isolement des mondes », de « la faune hypocrite », de « l’aveuglement » des hommes. Et pourtant, il se sent attendu quelque part par l’inconnu sous « le toit doré du temple ». Et malgré l’errance parfois (« Je tournoie à n’en plus finir »), il chante : « Je saluerai dès lors ce monde qui s’ébranle » pourvu qu’il « accueille nos corps. ». Ouvert à l’ «inattendu », « captivé par [un] spectacle anodin », entraîné « sur le chemin des mots qu’[il] écouterai[t] des heures », il exerce sa faculté de contemplation des choses et des êtres de ce monde, fussent-ils les plus insignifiants, car leur insignifiance n’est qu’apparente. Au-delà de l’apparente banalité des paysages et des hommes, le verbe original d’Arnaud Rivière Kéraval chante les délices des « saveurs humaines » et l’impitoyable volupté de la tragique beauté du monde.
Jean-Jacques Brouard
****
7.- « Le givre promis » de Miguel Ángel Real – un article de Jean-Jacques Brouard
Dès la première page de son recueil « Le givre promis », Miguel Ángel Real, qui s’avoue daltonien, nous convie à vivre « un récit » où il s’agira de « refléter sur une page vierge » les couleurs de la terre et des ciels. Le poète nous invite à la contemplation d’une peinture magmatique qui nous fait jouir plus réellement du monde, de ses odeurs, de sa texture et de ses lumières. C’est « des nuages aux nuances d’agrumes » ou « des œillets comme des gueules de tigre » qu’émane le plaisir des sens, de tous les sens déréglés. Au fil des synesthésies qui mêlent le visuel et le sonore dans « la couleur du silence », la capture des sensations rend la poésie tactile et sensuelle : « Le pinceau enferme une voix. ». Nous ne sommes pas face à une poésie du reflet, non, mais plongés dans une poésie « pour dépasser tous les miroirs ». Car la sensualité n’exclut jamais la pensée. On peut même dire qu’elle la suscite, la nourrit par une sorte de transmutation subtile et secrète. Le poète, en effet, est un « alchimiste qui jamais ne dévoile ses mélanges ». Dans l’univers realien, l’être est un Grand-Œuvre, une opération complexe qui implique des pierres précieuses, des métaux, mais aussi une fusion du feu, de la neige et de l’encre pour « le tracé aléatoire d’une envie de vivre », « admettre / la présence du papier qui pourrait déclencher toutes les métamorphoses […] « pour que la flamme boive / aspire /annihile/ toute envie de reprendre le vieux décompte du temps. ». Comme Gaston Bachelard, Miguel Ángel Real nous amène à une profonde méditation sur le symbolisme des choses.
Comme le disait Baudelaire, le poète est un phare – et « il n’y a pas pire solitude en haut du phare : le silence impossible » – et sa lumière ne doit ni éblouir ni blesser ; elle est une lueur salvatrice, un signal qui guide, avertit du danger et permet d’échapper aux « spirales de l’orage », au « gouffre des parenthèses »… et à l’impossible silence. A l’écoute des vibrations du monde humain – voix, musiques et paroles – Miguel Ángel Real « refuse les barrières » et « revendique l’insomnie ». Sensible et attentif à tout ce qui est, il recense et donne un sens profond à ce qui peut parfois nous sembler dérisoire ou insignifiant pour « nous tenir éveillés au monde ». Toutefois, l’émerveillement de l’innocence se double toujours d’une pointe de lucidité, d’une touche d’humour, d’un chleuasme[1] qui confère au texte une vérité qui est aussi beauté dans sa saisie de l’infime, sa ciselure de l’éphémère, l’esquisse de l’ineffable : « juste une vanité blanche, une trame de sel / sur la neige que tu laisses : aspérités » ; « nuages imbus de leur vent, / musique, portes, ». La poésie décèle dans l’infime le sens du sacré, mais un sacré qui n’est pas religieux, qui suscite le doute et l’humour, indissociables de la quête, nous entraînant dans des « forêts / où l’impossible horizon tisse des dieux / dans une amertume de fausses vérités / que l’on croit indispensable. ». Au détour de la page, Miguel Ángel Real nous réserve un clin d’esprit, la surprise d’un saut en para…doxe. Paradoxe du daltonien qui propose des variations sur les couleurs : dix sur le rouge qui sont autant de manières de « se libérer des conventions » et dix sur le bleu, dix exercices de « présence », de « nuance », de « tropisme », de libre vibration.
Parfois l’expression poétique se fait plus concise, plus elliptique, entre le haïku ou le tanka et l’aphorisme, comme ces scansions sur les possibles d’une couleur dans « Dix variations sur le jaune » – palette de sensations saisies au bond par la pensée vive, gage d’une lucidité de voyant – ou bien dans « Six acrostiches, dont un indocile » qui prend le parti des choses à la mode oulipienne. Il y a toujours ce questionnement des objets qui donne lieu à une méditation poétique : « Est-ce qu’une boîte a une forme de nuage ? ». Pleine de « souvenirs enveloppés par les araignées », la boîte en carton se métamorphose en « novembre gris », « caresse à contre-temps », « neige et silence ».
Si le passé a sa place dans l’univers de Miguel Ángel Real, c’est le temps présent, l’instant de l’être-au-monde qui mobilise son attention. Il a « conscience du temps à saisir », de sa fugacité dans le mouvement perpétuel des êtres et des choses. La quête poétique passe donc par les voyages. En ce sens, comme Valéry Larbaud et Blaise Cendrars, Miguel Ángel Real se plaît à arpenter le monde, ses villes et ses paysages, dont il note les ambiances, les pulsations, « les ombres impossibles »… Pour lui, « chaque pas est un voyage » et, au lieu de « composer des hymnes à la lumière », il préfère les variations sur le silence : il y a « un monde qui s’ouvre derrière l’horizon », mais il faut avoir « la force de savoir attendre » car, en toute humilité, la vérité du monde, seul le monde la connaît. Ce monde, il l’« observe au-delà des ombres » de cette « frontière figée et intouchable / que l’on dépasse » ; un monde où « une solitude s’avance vers une autre », où l’ « on s’accroche au besoin d’être un » en créant, « pour troubler la déraison de l’oubli », pour conjurer « l’ignorance de l’ailleurs, le contre-désir ».
Il y a, nous l’avons dit, de l’ironie dans la poésie de Miguel Ángel Real, quand il se moque de « la prétendue harmonie du monde » mais on y trouve aussi de la tendresse, de l’empathie, le sens du partage désintéressé, la générosité de la pensée, du dialogue avec l’autre ; et son dire « se nourrit de la beauté fluctuante de l’art. »
Pour cet auteur, la poésie retrouve sa nature première : elle est création, naissance, dans l’innocence de la lumière, une lumière qui est « un enfant qui ne pense pas. ». Il s’agit toujours « d’atteindre l’instant antidote / contre le givre promis ». L’acte poétique est un acte d’amour et vice versa : après l’ « attente incandescente », l’écriture fait « imaginer la liberté du feu ».
Avec sincérité, le poète avoue préférer l’écart de la métaphore au dire clair de ceux qui nous fouettent « sans avoir besoin d’échafauder une équation inutile ». Pourtant sa rébellion est là et n’a rien d’inutile quand il nous dit que « le métal fondu de notre égoïsme nous scelle les paupières […] sur les fondations d’un vaisseau écartelé ». Aveu qui révèle l’hésitation paradoxale entre, d’une part, humilité et tolérance (« pas de jugement./ on modifie son regard / quand on est humble ») et, d’autre part, refus et rébellion (« on s’obstine / à transformer / le sens du monde / pour combattre / ses circonvolutions »). « Le langage est une révolution à concevoir » qui permettrait peut-être dans le « dédale sans aucune limite sans contraintes » à « nos pensées (d’atteindre) libérées de tout effort, leur point de sublimation. »
Par une peinture contemplative et sismographique toute de pulsations, de synesthésies et de métaphores, Miguel Ángel Real, dans ce recueil, réussit à capter sous leur insignifiante apparence la haute valeur symbolique des choses, à transmuter le dérisoire en essentiel. Ouvert à la richesse du monde, le poète est porteur de lumière, créateur candide, mais aussi partisan du soupçon, de l’humour et de la rébellion. Soucieux de l’être-au-monde dans l’éphémère de l’instant, il cultive le doute et le paradoxe dans sa quête de l’ailleurs et de l’autre. Une pensée exigeante, un art de la nuance, une finesse à déchiffrer les arcanes et un exercice subtil de la subversion contribuent à l’éveil de tous les sens et au vrai plaisir du texte.
[1] Ironie tournée vers soi
« Le givre promis » a été publié par les éditions Tarmac
****
6.- A propos des « Paysages ambulants » d’Arnaud Rivière Kéraval par Daniel Malbranque
l’âme est un paysage choisi
Pour la troisième fois je referme les Paysages ambulants d’Arnaud Rivière Kéraval, proposés par les éditions Ballade à la Lune. Pour la troisième fois je me dis que les mots ont pouvoir de grâce et force d’invitation au voyage. Dès les premières lignes de ce court recueil, mais ô combien dense (j’aurais pu écrire danse, tant on y ressent les souples ondulations de Shiva Nataraja), dès les premières lignes, disais-je, les mots du poète nous embarquent vers des horizons de parfums et de désirs avoués, inavoués, toujours à fleur de peau.
Car ce qui sous-tend l’écriture voltigeuse d’Arnaud Rivière Kéraval est bien l’émotion. Celle qui fait frissonner l’esprit, qui fait trembloter l’âme et surtout qui fait battre le cœur, quand il soupire d’attendre l’inattendu : rencontre, apparition, espérance, dans le jardin, sur le chemin du temple, partout là où les paysages de l’amour conduisent nos déambulations. Les feuilles qui frémissent sur l’arbre millénaire se font entendre parmi les vers du poète. Et c’est tout son être que l’on pense deviner.
Que feras-tu de mon désir / Grand escamoteur / quand la lune aura couché nos corps / sur le chemin descendant ? interroge le poète dans l’un des plus émouvants poèmes de ce recueil. Il nous confie avec une pudeur fébrile le tréfonds de ses pensées et soudain ces rides de l’âme sont également nôtres. C’est la magie de sa poésie. Arnaud Rivière Kéraval est certainement quelqu’un qui, libéré du poids de toute civilisation, a su écouter, l’orage vient de passer, le doux filet d’un chant d’oiseau faisant prière au renouveau de l’aurore. En conclusion et pour reprendre l’un de ses titres : c’est très beau !
Pour la quatrième fois et pas la dernière, j’entre dans le monde des Paysages ambulants.
Daniel Malbranque
****
5.- A propos de « Horizons intérieurs » de Jean-Jacques Brouard par Daniel Malbranque
Verbe en joie, gerbe de voix
Voici, ô voici que vient de paraître un tout petit livre… de grande envergure : Horizons intérieurs suivi de Algarades, publiés chez Sémaphore ! Son auteur : Jean-Jacques Brouard, âme et animateur du site de poésie Oupoli (avec Miguel Ángel Real, ami et préfacier dudit ouvrage).
Grande envergure disais-je ! Et grande aventure ! Le périple projeté par l’auteur, en effet, se vit comme un voyage initiatique, dixit son préfacier, entre un univers personnel et une envie permanente de visions lointaines. Et c’est réussi. Dès les premiers vers, on embarque et ça tangue et ça gîte. À l’assaut du fort intérieur d’où choient, par les mâchicoulis, des vertiges de songes merveilleusement suggérés. Ou bien voguant au grand large de l’imagination, balayé par la houle des révélations d’Orphée. Surréalisme retardataire, diront certains, mais surréalisme immarcescible, toujours renouvelé, qui permet d’invoquer à la fois les voix du magma intime et la vox caeli en sa mystérieuse éternité. Vibre la corde entre l’astre et nous … c’est le chant du mystère … Écoutons le murmure des trous du cosmos déclame -t-il de sa voix prophétique et visionnaire. Peu de textes nécessitent relecture. Ceux de Brouard, eux , l’imposent. Non pas pour en mieux comprendre la délicieuse moelle mais plutôt pour s’en laisser griser car le bougre sait nous inoculer à merveille son opium de poésie. Et l’on y revient comme le gourmand qui se ressert en fermant les yeux de plaisir.
Oui ! Gast ar c’hast ! Le Verbe de Brouard est joie. Il est fils du Grand Zef. Celui qui emporte l’esprit dans un long tourbillon d’émerveillement et qui se fait palpitant dans la sphère d’écriture. La fougueuse laisse que nous propose Yann depuis Kemper et ses terres à la limite du visible nous entraîne avec exubérance saine dans la [belle] forêt des mythes. Mais loin des références pesantes et ankylosées, son texte ravigote l’âme des légendes. Il y a du Graal en horizon chez lui. Je dirais même du Grall tant le souffle qu’il met à plonger dans le tréfonds du tréfonds me fait penser parfois aux sônes du pétrel de Botzulan. S’il y a des références à commettre encore, on ajoutera celle d’un marseillais qui devint pays puisqu’il s’établit à Roskañvel puis Kameled : Saint-Pol-Roux le magnifique qui chanta ainsi sa terre d’adoption : Voilà quelle est la race aux grands yeux de mystère / Aussi nombreuse et pure que l’oiseau dans l’air, / Un gâs breton sur chaque motte de la Terre, / Un gâs breton sur chaque lame de la Mer. Brouard qui en ses Horizons intérieurs se montre à la fois d’ar goat et d’ar mor, par sa virulente générosité envers le vocabulaire fait écho aux envolées de l’oiseau nichant au Manoir de Cœcilian. Je ne ferai pas faute non plus d’oublier comme phare à son œuvre le nom de Blaise Cendrars. Entiché du grand voyageur, Yann, par sa façon de conduire librement son vers, sans en tenir serrées les rênes ( vois comme il a faim le tigre de la liberté, dit-il), rappelle certaines pages passionnées de la Prose du Transsibérien.
Breton, mais aussi d’ailleurs, du Ciel et de la Terre mais aussi de la Mer, Jean-Jacques Brouard, dit Yann, prouve avec ce recueil, s’il en était besoin que la poésie est affaire de passion, dans les deux sens du mot et que sa quête est celle de l’écriture d’avant l’alphabet qui raconte[rait] l’univers. C’est alors que le poète jouit / du verbe final. Oh, gast ar c’hast, est joie la voix de Yann !
Daniel Malbranque
Daniel Malbranque est né en 1953, à Brest. Études de lettres et philosophie abandonnées au profit de l’errance. Dix années d’itinérance (Espagne, Yougoslavie, Turquie, Iran, Afghanistan); puis quinze ans d’activités radiophoniques au sein d’une radio locale à Ribérac, en Périgord. Entré dans l’administration, il finit par s’installer au pays de Cyrano. Créateur en 1969 du défunt Club de la Poésie, puis rédacteur de la revue anarcho-Dada Toalette (1971-1972). Présent dans de nombreuses revues : Digor, Vorace, Le Vice et la vertu, Les Voleurs de Feu, Friches, Le club des Hydropathes, La lettre des Poètes du Berry, Le Journal à Sajat, Instinct Nomade et dans les anthologies : L’Auberge espagnole (2011), Les Souffleurs de vers (2013), Le Florilège du centième (2015), Florilège des Poètes en Bergeracois (2016), Dossiers d’Aquitaine (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020). En 2018, il a créé la revue de littérature La Vie Multiple. Il est membre du comité de rédaction de la revue Instinct Nomade. Nominé au prix Troubadours 2020.
Publications récentes : Des nuits de l’outre soi & de certains jours renaissants, Anthologie personnelle 1973-2018, éditions Germes de barbarie (2019) – Cette voile sobre qui cingle suivi de Cordes cuivres et vents (2017), éd. Thierry Sajat – Comme un reflet sur l’au-delà suivi de quelques Eaux-Fortes (2015), éd. Thierry Sajat – une autobiographie aux éditions Germes de barbarie : tome I, Aller voir ailleurs (2020); tome II, La Perte des rêves, (2022).
****
4. – Recension de « Bréviaire de sel »* de Louis Bertholom – par Éric Chassefière
* éditions Sauvages, 2013
« Le grondement sourd / mémoire des tsunamis avortés / clame une force qui se retient. // Des puissances omniscientes / s’associent au chant de furie / de ce bréviaire de sel ». Le tableau est posé, c’est le chant de la mer, cette récitation des « psaumes / du mouvement perpétuel », cette « prière » de la mer qui est « respiration / d’une chorale de vagues / devant la candeur des villages », dont le poète, arpentant sa terre, vient s’emplir, reprenant vie et force à cet océan qui a bercé son enfance : « Je marche dans la parole plurielle / d’un pays de haut vol. // Respirer un peu d’espace / est ma prière, / ma peine, fluidifiée / sur les herbes rases ». Le lieu sacré est ici la baie d’Audierne – « Tout en murmure la Baie / en chant de furie, en apaisement, / toute une gamme écrite / par le Grand Mystère / du sel et du vent » -, terre de prédilection de Paul Quéré, auquel ce livre est dédié, Quéré dont l’inscription gravée sur sa tombe dans le petit cimetière de Tréguennec dit ceci : « J’aime tout ce qui s’écrit sur le silence, l’immobilité / L’écriture est alors l’imperceptible mouvement, / l’à peine audible respiration d’un infini, / Un instant attentif à l’homme ». C’est dans cette immensité de temps et d’espace que Louis Bertholom, en une suite de poèmes rocailleux, inquiets et tendres, tous écrits dans les mois d’automne et d’hiver, inscrit le lien qu’il cherche à renouer avec l’origine, « la mère, l’amniotique berceau », lui « né dans le cœur même d’une ferme aux relents de goémons », enfant de cette terre aimée, matrice première de sa naissance à la poésie et au monde. « J’ai écrit ces mots à même le sable, j’ai hurlé leur musique dans le vent pour savoir qu’en avalant les embruns j’allais ingérer la mémoire sauvage et obscure d’un pays sans limite ». Mots, donc, comme des pas, acte de marcher et acte d’écrire se confondant en la quête d’un rythme unique, une respiration commune pour nous faire toucher le monde ; pays, donc, comme un corps vivant, dont le poète cherche à s’approprier la mémoire pour en partager l’histoire.
Voici ce que le poète, dans le prologue du livre, nous dit de la baie d’Audierne, berceau commun à sa poésie et à celle de Paul Quéré : « La baie est une ouverture vers l’au-delà, un souffle sacré d’une sauvage parole. Il n’est pas étonnant d’y ressentir nos disparus ou de simples présences, les traces de pas sur l’estran qui sont les témoins visibles de cet immense carbone de la vie. J’imagine l’air comme une imprimante magnétique qui enregistrerait plaintes et rires, prières et cris de tous les temps pour venir empoisser de sa logorrhée notre chevelure, ensemble de récepteurs biologiques faisant le lien entre le passé, le présent et l’avenir ». Ce chant du berceau, nous confie-t-il dans l’épilogue, « n’est certes pas une comptine mais un grondement diffus, une menace qui donne sens à une méditation régulière s’accentuant au fil de l’âge, un appel à tester la déraison comme s’il fallait méditer la proximité fluctuante de l’eau salée ». La mort est partout présente dans ces textes, l’océan se fait orée d’un monde inconnu et inquiétant, il ne s’agit pas tant de déchiffrer l’écriture des grèves que de l’accompagner de son pas, marcher pour écrire, mais aussi pour se dissoudre dans le tumulte de l’immense tourbillon qui nous aspire :
Sentir la cendre et le fruit
d’un monde inconnu
jusqu’à l’ivresse de la mort.
Le lien sacré se trouve
sur le bord du temps,
à l’orée du dedans et du néant
qui nous aspire d’un vertige bluffant.
Mes rêves ont la fluidité,
la morsure d’avant la vie.
Les grèves transcendent la nuit,
ne pas déchiffrer leurs paroles,
les accompagner d’un pas lent,
s’y dissoudre tel un dément
sur les draps
de la Grande Concrétion.
Se faire ultime élément constituant de la matière : « Je suis une monade / dans cette respiration océanique / qui avale l’infini, / aspire, rejette les spasmes / des passagers du soleil ». Et toujours cette proximité du précipice, de ce bord du monde prêt à nous engloutir : « Seul, silencieux, / le monde me scrute, / dansent mes pensées, / j’écoute luire le sable / à l’orée du vide ». Devenir le cri lui-même, vibrer à l’unisson du corps vivant de la mer : « Des jets de courlis, / complices de leurs géométries, / rentrent dans ma gorge, / pluie d’octaves / qui se réfugie dans le ventre du cri ». Le poète, dans ces paysages maintes fois arpentés, de pas et de mots, déploie tous ses sens, fait corps et souffle avec la nature sauvage : « Revenir tout doucement / par les voies caillouteuses, / caresser les graminées d’automne, / humer les chaumières, / respirer les crottins, / entendre le vacarme sourd et continu / de la longue respiration du monde. // L’idée qui doit surgir / avec l’oxygène des mots / brûlera de toute sa clarté ». Ainsi, les mots sont l’oxygène qui nourrit la flamme intérieure, peut-être ces « scintillances » que le poète dit venir retrouver aux « dunes mauvaises », cette « table, / [où] inscrire l’âme de la Baie ». La lumière est dans ces poèmes un élément central du paysage, ainsi : « Le ciel lourd de lambeaux / transpercés de lumières labiles / réincarne l’espace de l’insaisissable ». Lumière qui sait se faire intérieure : « Dans la solitude / des rêves éveillés / s’éteint insidieusement / la lueur / pour rejaillir dans l’éclat / d’un jour nouveau ». L’apaisement après la tempête, le miracle de la pure présence au monde tandis que parcourant « ce pays si dépouillé, / tertres de landes, / marais d’où s’envolent / des hérons pourprés, / tout cela que drape la brume / des mois noirs / vers d’indicibles légendes » :
Errances pastorales
entre les talus de sureaux,
je suis au cœur de la vie,
j’habite l’instant,
le repos des mots quand s’arrêtent les pas : « Les mots se reposent / dans les aiguilles de pin séchées / qui attendent le feu », il est des instants de pur bonheur… Mais à l’arrière-plan, l’industrialisation croissante, le paysage peu à peu dénaturé de cette baie si chère au cœur de ses enfants, la solitude qui résulte de la perte, l’urgence à reprendre vie en ces lieux arpentés de la source d’être : « Notre solitude à venir / dans un monde perdu, / ici j’ose encore m’inventer / dans les limbes du recueillement ». Lisant ces textes, prenant pas à la scansion de ces mots rugueux, nous marchons, témoins silencieux, aux côtés du poète. Bréviaire de sel est un voyage aux sources de la pensée, dans cette baie d’Audierne faite bord du monde, dont il nous dit pour conclure le livre : « Les abords de fin de continent sont des invitations à mieux appréhender ses propres limites spatio-temporelles à saisir goulûment l’énergie prométhéenne, à crier dans le vent comme pour nous remplir de l’éther du vide ». S’emplir enfin de la respiration de l’infini si chère à Paul Quéré…
Éric Chassefière
(publié le 7 juillet 2023)
*****
3. – Jean-Jacques Brouard, « Horizons intérieurs » – préface de Miguel Ángel Real
« Horizons intérieurs », suivi de « Algarades », est un périple qui se vit comme un voyage initiatique entre un univers personnel et une envie permanente de visions lointaines. Si Jean-Jacques Brouard se définit d’emblée comme un indigène d’un pays intérieur, c’est pour nous conduire vers un monde où la poésie est partage et trouvailles, source et destination, rêverie et labyrinthe de réalité. C’est souvent la nuit que l’auteur entend les voix qui le conduisent vers la création de rêves éveillés, dont la charpente est composée de mythes. A partir d’une érudition qui se veut généreuse, les vers s’affirment donc comme une quête de l’origine et comme la traversée d’un monde où mes pensées libres déferlent sur les plages pour revendiquer une curiosité vitale et critiquer sans relâche la banalité d’une société où la morale des petits hommes est l’ennemie de la pensée.
La poésie doit être exigence : Écrire n’est pas un jeu / On y risque son être / Il faut tenir sa plume comme une épée. Les mots sont une garantie pour éviter les engrenages noirs qui dans la grande nuit du monde essayent de nous attirer vers un endormissement fatal. Les poèmes de ce recueil sont imbibés d’une magie qui se nourrit d’éléments naturels. Grand randonneur, Jean-Jacques Brouard nous transmet son regard curieux sur la réalité qui l’entoure, pour opérer ensuite une alchimie qui a comme objectif de nous dévoiler le sens des choses vraies. Le paysage est également une scène sur laquelle viennent jouer Dionysos, Ouranos et Gaïa, Pan et Eros, pour nous inviter à abandonner la simple contemplation ; il s’agit de montrer clairement une dimension hédoniste de l’existence, une négation de toute artificialité pour renouveler sans cesse les définitions et démolir les préjugés.
Jean-Jacques Brouard puise aussi son énergie dans les fleuves de nos pères. En ce sens, ce livre nous questionne sur les mystères de l’origine, qui ne peuvent être dévoilés que par la magie du dire. La volupté de l’écriture, clé de voûte de l’existence de l’écrivain, est en effet une caractéristique évidente du style de l’auteur. La parole est justement la clé du monde inversé, seulement accessible si nous reconnaissons la puissance du verbe. La magie du verbe rend l’univers lisible, et ce sont bien sûr les mots qui vont nous permettre de mener ce voyage quelque peu homérique entre le passé à élucider et un horizon qui est une promesse d’étincelles, en passant bien évidemment par un présent qu’il faut vénérer : peu importe l’avant /peu importe l’après / c’est le pendant qui importe. Des traversées concrètes ou imaginaires mais toujours présentes dans la poésie de cet auteur qui se voit guidé par un fil d’Ariane qui mène vers l’ailleurs et qui reprend ainsi, à sa façon, l’Invitation au voyage baudelairienne.
Il ne faut pas penser que l’univers classique dépeint par Jean-Jacques Brouard dans certains de ses poèmes soit le synonyme d’une quelconque nostalgie sans issue. Même si on peut lire que le passé aura toujours le goût du vrai dans les entrailles de nos songes, on dépasse ici le message de Jorge Manrique, poète espagnol du XVe siècle qui affirmait que cualquier tiempo pasado fue mejor. Le sens qu’apportent les références culturelles est celui de l’humaniste qui nous transmet ses connaissances pour enrichir notre pensée et aller de l’avant, sans s’embourber dans un présent sans exigences. Cet héritage indispensable est un synonyme de volonté d’être et de savoir : Moi je veux être plus vivant que le soleil, dit le poète, qui tel un chevalier mène sa quête d’un idéal qui ne peut que tourner autour de la poésie. Libérez-moi des vieux démons du passé, peut-on lire, comme pour insister sur l’impérieuse nécessité de s’abreuver du monde qui nous entoure et ainsi engendrer un futur.
L’écriture de Jean-Jacques Brouard est de ce fait remplie de spiritualité concrète : il rejette avec force les dogmes païens et les chimères mystiques. Dieu est mort, l’homme est vivant. Et le poète de nous expliquer que son droit de repli au fond du jardin est en vérité une envie d’ailleurs et surtout un geste de résistance pour redéfinir les contours du monde grâce à la parole. Pour lui, la nature est vérité, et ce sont les confins du poème et les charmes de la lumière qui nous apportent la nourriture vitale : c’est pourquoi la poésie de ce livre tente de répondre à l’appel de l’infini et nous invite à rêver sans cesse car ce n’est pas que nous n’aimions pas le réel / mais la rêverie est ce qui nous préserve de l’inconsistance du monde.
Aussi bien les « Horizons intérieurs » que les « Algarades » sont une définition de ce que le travail poétique doit être. Comme un vrai démiurge, essentiel à notre époque remplie de vide et d’inconsistance, le poète sera celui qui à travers le voile des fleurs vénéneuses / allume les yeux des aveugles et ouvre des portes incandescentes. Comme des véritables invocations, les poèmes de Jean-Jacques Brouard nous donnent la clé pour oublier la médiocrité d’un monde commercial et immédiat et nous permettent de nous élever vers un ailleurs intégral à travers les mots, qui visent à nous aider à lutter contre l’angoisse de la vie qui passe pour mieux nous rapprocher du cosmos dans son sens strict : l’ordre et l’harmonie qui en découle.
Miguel Ángel Real
(publié le 6 juillet 2023)
2. – Les « Horizons intérieurs » de Jean-Jacques Brouard – par Rémy Leboissetier
Hors du service commandé de la criticaillerie, il est difficile de consigner ses impressions dans le même temps de la lecture sans risquer de rompre le flux de celle-ci – et d’engendrer une dissociation de l’individu, de lecteur-critiquant ou de critique-lectorant.
J’ai néanmoins marqué au vol, sans me dessaisir du vif, donc, des passages ayant retenu mon attention et force est de constater que les fins de poèmes de Jean-Jacques Brouard sont en général performantes, comme un impératif conclusif de progression ascendante :
« J’entends claquer les mâchoires des affamés
J’entends le ricanement des élites
Poésie poésie ne sois pas gentille !
Vois comme il a faim le tigre de la liberté ! »
Horizons intérieurs, II, p. 20
Je l’aime bien, ce « tigre de la liberté », qui nous place du côté des grands félidés et non des petits affidés de service. Et je l’entends bien feuler, râler, rauquer… Le fauve en question !
Ailleurs, une autre espèce animale s’introduit :
« Axolotls lumineux
Dans la grande nuit du monde »
Horizons intérieurs, IV, p. 25
…Espèce des plus étranges que cette salamandre mexicaine, qui apporte une note fantastique (et qui fut au centre d’un récit de Julio Cortazar). Plusieurs fois nous serons ainsi surpris, plongés dans le grand bain de la poésie, d’aborder les rives de la science-fiction : c’est une voie singulière qui mérite d’être approfondie – de poésie dissipée, diffractée, qui ne recherche pas la pureté du genre, plutôt sa pluralité.
Gourmet du lexique, Jean-Jacques Brouard s’empare de mots issus d’autres domaines d’activité, par exemple de termes juridiques, pour mieux étendre son champ d’action et sa volonté d’appropriation :
« Nu-propriétaire des francs-alleux j’en savourais l’usufruit sauvage
Je ne désirais qu’une chose
Que dure l’extase ! »
Horizons intérieurs, VI, p. 30
Le poème VIII se clôt en s’ouvrant sur l’infini, comme une nouvelle promesse de feu prométhéenne. Au cœur du désir, Jean-Jacques Brouard souhaite tout embras(s)er – c’est l’essence même du panthéisme, comburant d’origine immémoriale.
« — Signe cultivé dans le sens —
Vouée à être ce qu’elle (possession rituelle de la chose) doit être
Une représentation toujours indéfinie
Une étincelle d’∞ ! »
Horizons intérieurs, VIII, p. 34
Flaveurs en faveur, ferveur sensuelle rythmée par des accès de fièvre nietzschéenne – donc dionysiaque. Le panthéisme revient souvent habiter les poèmes et se mêle à des accents lyriques/extatiques qui m’ont rappelé aussi ceux d’Armand Robin – un autre costarmoricain –, mais avant il y a cet extrait, avec ses deux jolis vers alexandrins du diable et de Diane, qui encadrent art poétique et geste amoureuse :
« […] Il faut craindre le mycélium de la métaphore
Quand il s’immisce dans les fibres de l’imaginaire
Et contamine le texte de sa grasse poétique
Vers lents et hiatus désintégrés
Enjambements audacieux
Ellipses écartèlements
Quel coït continu dans le brûlis des strophes !
La cyprine sémantique titille le nez du diable
Le poète est troublé par les hanches de Diane
Le pied est délivré de son piège dentu
Et peut danser la volte du gai savoir »…
Horizons intérieurs, XII, p. 43
Et voilà le mode de transport robinien dont je parlais, par la voie d’un poète dont les facultés d’assimilation des langues étrangères, quasi médiumniques, les lui rendaient mystérieusement familières :
« […] Nous attendons de belles extases du futur
Le plus abyssal
ô carcasse rudimentaire !
La lune est ta mère
Le soleil ton roi
Ton sang est l’eau des terres
Et l’œil posé
Sur toi
Comme un oiseau de lumière ! »
Horizons intérieurs, XIV, p. 46-47
Jean-Jacques Brouard use d’un lexique prolifique, mais surtout organique, sensuel, qui circonscrit un territoire enchanteur autant que sauvage, aussi âpre que voluptueux, à mi-chemin du rêve et du réel : Brocéliande et la Matière de Bretagne, humains se confondant avec la nature et nature métamorphique générant des êtres hybrides, « femmes végétales », « sève d’Eros », « houppiers d’or », « layons d’azur », les vieux arbres qui pleurent et Merlin qui rit… Sur son cheval hennissant.
Plus loin, il est écrit que l’« excès d’images nourrit les fantasmes ». J’ai tendance à penser l’inverse : le fantasme – celui qui nous importe se nourrit de notre propre imagination. Mais il s’agit plutôt ici, n’est-ce pas, des produits actuels de l’industrie du divertissement… et sa « masse de données », indigeste et narcotique. Et non du fantasme inviolable, isiaque, du sceau de l’énigme.
« Explosion de sèmes ! Éruption d’images ! »
De sèmes, certes, mais surtout de mèmes, dont on connaît aujourd’hui la portée virale, phénomène éclairant qui nous confirme la prédominance du visuel sur le textuel, lesquels n’évoluent plus vraiment en bonne intelligence.
Dans le poème XIX apparaît Brest en cité suspendue, entre ses nuages et ses ponts et l’écho de ses canonnades : ville-phare, de tous les départs.
Avec le poème qui suit nous ne serions pas loin d’une heroic-poetry, avec cette « blonde vestale » qui « exsude un suc bestial », ces sacrifices, supplices et séances d’égorgements rédempteurs !
Et dans le poème XXII, Jean-Jacques Brouard termine par une nécessaire mise au point, dans un tourbillon ou court-bouillon macrocosmique, où le maître de la docte ignorance se joint au chantre du gai savoir :
« Il y a le point
On ne voit pas de ligne
Le point règne en maître
Il n’y a que lui dans
L’espace qui lui-même
N’est qu’un point
Infini
Où des mains indéfinies
S’agitent sans cesse dans
Le tourbillon sans fin
De circonférence point
Rien d’autre à dire
Point »
Horizons intérieurs, XXII, p. 70
Dans le poème XXIII, une astérisque signale que le mot « fouailleur » ne figure pas dans les usuels… C’est vrai, mais on s’en moque : on peut être fou ailleurs ou fou à lier dans son propre foyer.
Dans la suite, discrètement, il y a l’ami Borgès qui dressent ses antennes :
« […] J’épice le sirop des nuits avec des lexiques infinis
J’extrais la quintessence des livres de sable exhumés des déserts »…
Horizons intérieurs, XXIV, p. 74
Et plus loin, page suivante, c’est le Rimb’ qui pointe son nez :
« […] Que des musiciens échevelés joueront à l’aube du renouveau
Dans le plus pur dérèglement des sens »…
Horizons intérieurs, XXIV, p. 75
Désir d’errance et de délivrance vers « l’ailleurs intégral ».
La mélancolie affleure, à travers un « matin clair et silencieux qui berce la pensée », mais la vivacité tôt reprend, sur fond de musique mozartienne, où s’insinue – ce n’est pas si fréquent – une impeccable association rimée, invitation à la danse et à l’agape !
« […] La bière coule douce et ambrée
Une muse passe belle et cambrée »…
Horizons intérieurs, XXV, p. 77
Est-ce le rythme qui accélère ou nos horloges qui prennent du « retard dans le ballet cosmique » ? Dans ce moteur à deux temps, seul compte l’intervalle, l’entre-temps, qui fait dire à Jean-Jacques Brouard qu’il « fatigue plus vite que son double ». Très certainement, puisque ce double ne porte aucun squelette et ne sait même pas compter les ans !
« […] Je ne sais plus de quoi hier était forgé
Je m’enivre d’aujourd’hui
Et pour demain j’ai perdu la main
Des heures passent dans l’escarcelle du diable
L’écriture épuise et transfigure
Quelle malédiction ! »
Horizons intérieurs, XXV, p. 78
Enfin, pour clore ces « horizons intérieurs », rien de mieux qu’un poème cosmogonique, en quête d’un havre posthume ou pays-refuge prénatal :
« Il t’obsède le nombril mystérieux du monde
La jachère illimitée des trous noirs
Les champs de météorites et les talus sidérés »
Horizons intérieurs, XXVI, p. 80
Sidération partagée. Tandis qu’ici, on continue gaiement à se « détrouver », se « fendouiller » et « calancher » à qui mieux pire… Alors, mieux vaut esquisser un pas de côté, n’est-ce pas, à la manière d’Henri Michaux.
ALGARADES
D’emblée, nous sommes prévenus : le poète qu’on identifie sous le nom de Jean-Jacques Brouard est « d’un monde qui n’est pas celui-ci », d’ailleurs il est « d’ailleurs » ; cet ailleurs qui revient si souvent dans ce recueil nous ferait douter de sa substance corporelle, alors qu’à n’en pas douter, il y a bien des grondement et des soulèvements dans cette voix, et des scènes charnelles ! Des prises de gueules, il y en a dans la partie ! Pour soi, son double et autrui, comment apparier l’élévation spirituelle et la complétude sensorielle ?
« La main crispée sur la crosse du stylo à plume de phénix
Le poète scande
Le sexe ornement dressé bien droit au milieu du front
Le poète jouit
Du verbe final »
Algarades, II, p. 87
À défaut d’infinitude, le poète fonde son entreprise de perpétuel recommencement et reviviscence, sachant qu’il « jouit du verbe final ».
« […] Longtemps il a fallu perdre du temps à faire autre chose qu’à chercher le [ Graal
La chasse aux vérités relatives, la traque des pensées folles et le cumul des [ savoirs
Pour découvrir enfin ce qu’est la volupté pure
La fusion du corps et de l’esprit
Le talisman de l’extase ! »
Algarades, III, p. 88
« Le talisman de l’extase » ! Jouisseur en diable, ce J.-J. Brouard ! La poésie se fait ici quasi-prosodie, adopte un ton prophétique, toujours en quête d’un ailleurs, suscitant un mouvement qui serait à la fois bond en avant et salto arrière, clameurs ancestrales ricochant sur les ondes de la postmodernité…
« […] Pour le potlacht des noirs desseins
Et le feu du Grand Néant. »
Algarades, IV, p. 91
On y va, on y vient… à l’ultime Festival Son & Lumière de l’Irradiation planétaire ?
L’Algarade V déroule un vocabulaire qui est un condensé de sensualité épicée : « île de tous les rêves », « les sens à vif », « dû de volupté », « éclairs d’amour unique », jouissance encore et tourbillon, ivresse et liesse, extase et vision inouïe… Un vrai vortex dans le cortex !
La verte Irlande baigne l’Algarade VI, avec sa bière noire comme l’encre, ses « îles flottantes » et « nœuds d’eaux » et ses paysages familiers du monde celte :
« L’Irlande du triple sexe lové dans la glèbe
Démiurge bicéphale dressé sur un pic
Au milieu de l’onde harassée »…
Algarades, VI, p. 94
Algarade (proche de « à la garde »), rappelons-le, provient de l’arabe al-ghâra, défini comme une brusque attaque, mais à qui s’en prendre, à quel monstre assoiffé de sang ? Non, Jean-Jacques, pour ma part je ne tiendrai jamais ma « plume comme une épée », ne me sentant nullement l’âme d’un guerrier et moins encore d’un archange terrassant le dragon. Il y a d’autres façons d’enfourcher « le tigre de la liberté« , de sonder la matière noire ou d’explorer, au risque de se perdre, l’autre côté… Et il y a aussi ce « bel oiseau de pensées », oiseau de feu qui prend son envol depuis la plus haute tour du « grand château des cartes »… Suivons-le !
Rémy Leboissetier
(publié le 6 juillet 2023)
*****
1. – JOSÉ INIESTA, LUMIÈRE ET VÉRITÉ
Par Miguel Ángel Real
De la lecture de l’œuvre de José Iniesta (Valence, Espagne, 1962) se dégage une impression d’unité thématique et formelle remarquable. La lumière est l’un des thèmes principaux, qui se décline de différentes façons à travers une recherche mélodique récurrente qui permet à ce poète de s’inscrire pleinement dans un courant classique très présent depuis toujours dans la poésie espagnole, et qui contraste globalement avec les différentes tendances observées en France, au XXe siècle notamment.
Le recours constant aux formes classiques de la métrique espagnole -les vers hendécasyllabes et heptasyllabes- fait de la lecture de la plupart des recueils de José Iniesta un moment de grande musicalité. L’utilisation des vers blancs permet d’apporter tout de même une touche actuelle dans ce que communément s’appelle en espagnol une silva, forme strophique libre dont la souplesse en fait la plus moderne des compositions traditionnelles. Il en est ainsi notamment dans les recueils « El eje de la luz »1 et « Cantar la vida »2, que nous commenterons dans cette étude. Pour sa part, « La plenitud descalza« 3 est un livre d’haïkus, que nous citerons également.
La force de la parole est revendiquée d’emblée dans Cantar la vida :
Es siempre posesión decir la vida, C’est toujours possession de dire la vie,
asirme a cuanto veo con palabras. saisir tout ce que je vois avec des mots.
Et dans ce premier poème qui ouvre le recueil, sorte de poétique personnelle, Iniesta de continuer en disant :
Cantar es la manera Chanter est le moyen
de encender una luz d’allumer une lumière
en la cueva profunda de la carne, dans la grotte profonde de la chair,
la sola soledad, mi compañía. la solitude seule, ma compagnie.
Une façon de nous expliquer son choix, éloigné de toute avant-garde et qui cherche de garder une ligne claire. En effet, il s’agit d’une poésie transparente dont la tendance classique le rapproche de quelques poètes contemporains comme Luis García Montero, Juan Lamillar ou Felipe Benítez Reyes. Ce biais classique, signalé par Luis Antonio de Villena dans « Fin de siglo, (El sesgo clásico en la última poesía española) »4 est pleinement repris par Iniesta, pour qui la musique de la parole est indispensable pour son salut. En ce sens, musique et lumière seront intimement liés pour transpercer doutes et questions existentielles telles que la présence de l’absurde dans notre vie.
Dans le texte d’introduction de « Cantar la vida », Iniesta affirme qu’il souhaite donner du sens et de la musique à certains souvenirs. Car sa production est liée à son expérience quotidienne et à ses souvenirs d’enfance. L’écriture est présentée comme un refuge dans ce recueil, composé aussi de textes en prose qui gardent une intention prosodique importante. De même, dans certains poèmes on trouvera une alternance de vers et de prose, comme pour se munir de moyens différents d’expression pour parvenir à faire transcender la parole.
Le chant est associé à la lumière et relié directement à l’importance de la parole et du rôle du poète. « El eje de la luz » débute par l’exclamation Quelle splendeur dans la musique dans un poème qui met en avant également ce temple que les paroles aident à bâtir.Chanter est parfois une tentative de « posséder » les souvenirs et donc la vie elle-même, comme on l’indiquait plus haut. Ce chant est constamment associé à la lumière :
donde es mucha luz là où il y a beaucoup de lumière
cantan los pájaros les oiseaux chantent.
Un chant qui se présente à nous comme synonyme de vie, comme une énergie qui sert à se rapprocher de mystères de l’âme et du quotidien, mis sur un plan d’égalité pour évoquer ainsi l’importance de chaque objet dans notre réalité. Une réalité liée aux éléments naturels, très présents dans l’œuvre du poète espagnol : sentiers, jardins, arbres, roses, limons, sillons, ainsi que la cour de sa maison, espace omniprésent et centre de création, comme nous l’indiquerons plus tard. Les sens sont en éveil face à l’odeur de la terre creusée, le murmure de l’eau qui inonde les champs. Iniesta nous fait part de son expérience dans un monde rural, pauvre mais éloigné de tout misérabilisme, où les figures du père et de la mère se détachent. Le monde, en somme, est un diapason, un moyen de mesure d’un équilibre qui semble à notre portée mais dont on est continuellement en quête à travers les mots. Il faut s’affirmer sur la nature, qui est beaucoup plus qu’un simple décor : une scène où les efforts de l’homme attendent une récompense toujours entourée de lumière ; il est également essentiel de ne pas la modifier : « El eje de la luz » nous propose donc une contemplation admirative de la réalité, où se trouve la leçon de quelques nuages sans désirs, / le vol sans paroles des oiseaux.
L’image du jardin de la maison familiale est elle aussi récurrente. Il s’agit, dans la plus pure tradition classique, d’un locus amoenus où la vie semble s’apaiser. Une cour qui n’est pas sans rappeler celle d’Antonio Machado, qui disait :
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
Mon enfance, ce sont des souvenirs d’une cour à Séville
et d’un jardin clair où mûrit le citronnier.
De son côté, José Iniesta aime cet espace intime pour vivre et y vieillir, en profitant pleinement de la vision des plantes qui l’entourent et de la compagnie des siens :
Qué suerte envejecer en este patio Quelle chance de vieillir dans cette cour
al lado del granado que me sabe. à côté du grenadier qui me connaît.
Iniesta avoue appartenir au monde -à travers le regard qu’il y porte- mais s’éloigner de sa maison suppose un moment d’angoisse :
Quel tremblement, sans ma maison, affirme-t-il dans « El eje de la luz ». Il ne souhaite rien d’autre que regarder le soleil éclairer les murs de la cour. Il y passe ses journées et voit les saisons défiler, en attendant la vérité d’un chardonneret qui se pose sur la branche des myrtes.
Justement, la vision de la nature tend souvent chez José Iniesta à la réconciliation avec la mémoire , surtout dans « Cantar la luz« . Sa modestie, ses actes humbles qui ne prétendent à rien et ses doutes face au présent trouvent le réconfort nécessaire dans une promenade le long des sentiers qui laissent entrevoir les énigmes autour. La vie n’est pas un fleuve : l’image de la soif et de la sécheresse reviendra souvent, accompagnée de questions sur le sens du chant que l’on veut faire résonner malgré tout, car l’élan vital semble aider le poète à surmonter les difficultés.
La lumière est également indispensable pour éclairer une réalité qui semble frissonner, frémir, qui se refuse parfois à être appréhendée. Le soleil, motif récurrent, sert à faire apparaître la fragilité de l’existence, mais le poète n’oublie pas de nous rappeler aussi que cette lumière est parfois fuyante dans un temps sans cesse recherché ; il s’agit surtout d’un outil pour combattre l’oubli, un garant des souvenirs car c’est elle qui sait se métamorphoser en temps : cette lumière ancienne est présente, jamais ce soleil sur l’arbre ne s’évanouit. Et c’est justement cette transformation qui apporte l’espoir et combat la nostalgie. Lumière-vérité : le réel est le soleil sur mon visage, même si elle tremble dans la mémoire du chemin.
La vie est une discrète aventure sans certitudes, dont on ne comprend pas souvent le sens. Pourtant, l’amour des siens nous aide à la parcourir. En parlant de sa femme, sa présence remplit le creux. Son être est une pulsation, le monde s’y dilue. Ses enfants, à qui il dédie plusieurs poèmes, sont les destinataires de la voix du poète, qui sera la lumière pour transmettre son amour. Cette relation filiale donne un sens à une existence toujours teintée d’absurde, et met en valeur l’envie de vivre un destin commun et de dépasser l’obscurité avec la lumière des mots, véritable héritage doré dans lequel on retrouve l’admiration du poète envers le modèle inspiré par son père : dans cette obscurité je suis aujourd’hui mon père.
La poésie de José Iniesta, empreinte de vitalité, fait aussi penser à certains concepts cher à Jorge Guillén, grand poète de la generación de 1927. Pour les deux auteurs, l’air est essentiel : pour Guillén le profond, c’est l’air, et pour Iniesta nous respirons l’air, nous sommes lumière, ou bien l’air est tout l’or qui me reste ou encore, un rayon de soleil est l’important. Guillén fait aussi de la lumière un point d’ancrage fondamental dans sa conception de l’existence. Prenons comme exemple le poème « Razones para la poesía » de José Iniesta, où l’on retrouve des échos « guilléniens » très forts. Il y est question de plénitude (donde arde lo real, y es plenitud) dans l’observation admirative et pleine d’amour que fait un enfant de la nature environnante (la aventura de ser vida en la luz) ou su amor es una copa de existencia. Guillén, pour sa part, dira ceci dans son poème « Las doce en el reloj » de son chef d’œuvre Cántico:
Dije: Todo ya pleno. J’ai dit : tout plein enfin.
Un álamo vibro. Un peuplier vibra.
Las hojas plateadas Les feuilles argentées
Sonaron con amor. Résonnèrent avec amour.
Los verdes eran grises, Les verts étaient gris,
El amor era sol. L’amour était soleil.
Le réel est aussi sublimé par l’innocence de la vision de l’enfant qu’était José Iniesta, l’un des axes majeurs de « Cantar la vida » :Dans les nuages, il voit des nuages, rien d’autre. Cette vision pure des choses devient, pour rester dansl’esprit de Jorge Guillén, une sublimation du moment présent. Iniesta nous dit :
Eso es la eternidad :
vivir en lo posible,
creer a ciegas siempre en lo que vemos.
Voici l’éternité :
vivre dans ce qui est possible,
croire toujours, les yeux fermés, en ce que nous voyons
« La plenitud descalza » à travers ses haïkus, sert de conclusion à cette étude car on y retrouve bon nombre d’éléments cités précédemment : rigueur de la construction poétique, importance de l’observation des éléments naturels, sens sous-jacent d’un absurde que seul les paroles peuvent atténuer… Un véritable précis des recueils que nous avons évoqués, dans lequel on découvre un auteur d’une grande sensibilité qui tient à nous faire part avec générosité de sa vision de la vie, du temps et du langage. Nous proposons donc pour terminer trois de ses haïkus :
Nada alcanzamos. Nous n’atteignons rien.
Contemplaba una nube Je contemplais un nuage
y se me fue. et il m’a échappé
*
Esta luz justa Cette lumière juste
da vida en el frutero donne vie dans le compotier
a unas naranjas à des oranges.
*
¿Y la verdad ? Et la vérité
No sé. Dame tu mano Je ne sais pas. Donne-moi ta main
en el camino. Sur le chemin.
Notes:
1Ed. Renacimiento, Séville, 2017
2Ed. Renacimiento, Séville, 2021
3Ed. Polibea, Madrid, 2021
4Luis Antonio de Villena, Fin de siglo. Ed. Visor, 1992