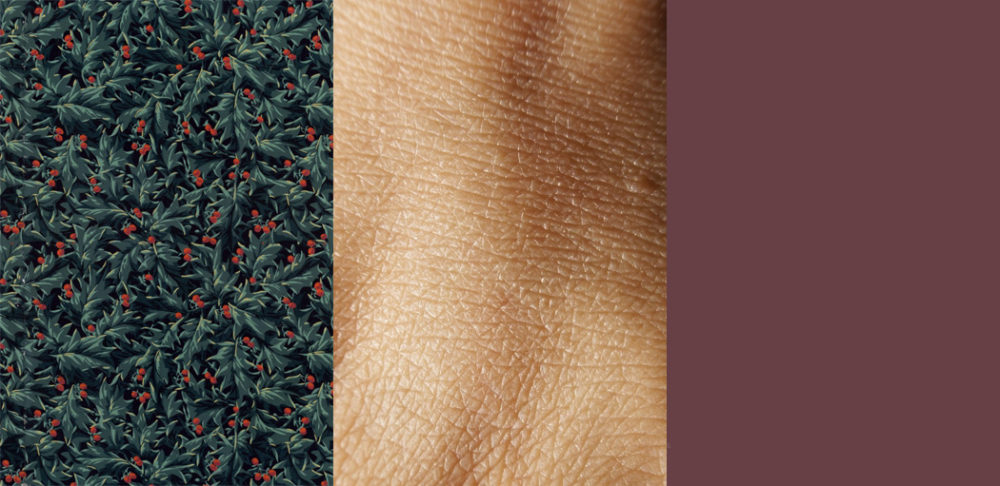Ce texte fait l’objet d’une publication en trois temps.
Première partie
« Je n’étais pas dans mon assiette. Elle est profonde mon
assiette, une assiette à soupe, et il est rare que je n’y
soit pas. C’est pourquoi je le signale. »
« Bon. Maintenant qu’on sait où l’on va, allons-y. Il est
si bon de savoir où l’on va, dans les premiers temps.
Ça vous enlève presque l’envie d’y aller. »
– Molloy –
« Non non, simplement la misère mentale, le nom me
reviendra dans la nuit. »
– Tous ceux qui tombent –
Samuel Beckett
Une araignée progresse prudemment sur le plâtre blanc du mur.
Encore l’éternel ballet mécanique de l’arachnide errante, fidèle à elle-même, belle en un sens, mais trop lente malgré ses pointes inopinées de vitesse, je trouve.
Dissimulée, à présent.
Deux pattes sont un peu trop visibles.
J’ai une technique avec des bouteilles en plastiques coupées en deux. Il faut juste être patient. J’ai tout l’après-midi. Quand l’araignée a daigné sortir de sa cachette je m’arrange pour qu’elle tombe dans le fond de la bouteille. Je vais ensuite tranquillement la remettre dans un buisson ou dans le garage s’il fait trop froid. Cette fois-ci, je la dépose au pied d’un arbre.
J’aime les algues.
Des lamelles. Reposant dans leur piscine d’huile.
Une grande assiette blanche bordée d’un liseré bleu. Je dois manger ce fouillis mariné (pour me nourrir). Je vais donc les avaler. Dans une poignée d’instants.
Voilà, c’est fait.
C’est fait, mais il me faut dire que je me sens solidaire de ces créatures – et de bien d’autres (comme les loutres, par exemple, mais ça n’a rien à voir).
Ces algues, bien sûr, elles sont écrasées, broyées, mâchées consciencieusement pour certaines et finalement dissoutes, réduites à l’état de pur souvenir – n’empêche, je me sens solidaire.
La solidarité instinctive des vaincus, peut-être. Sûrement, oui.
Je suis assis dans un fauteuil. Ma femme s’approche, pose sa main sur ma tête. Va-t-elle esquisser un mouvement?
Non, finalement non.
J’attends. Quoi encore ?
J’attends.
La main reste immobile un bon moment, puis se retire.
Le plus difficile pour moi a été de découvrir que j’étais un minable pur. Un pur, oui.
J’ai eu du mal à m’y habituer.
Plus encore : ça m’a été difficile de le comprendre – je veux dire : réellement, le comprendre, saisir l’idée à même les gestes et pensées du quotidien.
Car mon esprit est lent. Très, très lent. D’une lenteur de jour gris interminable.
Donc, ce fut une sorte de révélation – progressive, disons. Ma femme m’a aidé à y voir clair, à sa manière.
L’onde de choc s’est fait sentir durant des années. Jusqu’à aujourd’hui sans doute.
Mais on se fait à tout finalement. C’est ça le plus étonnant – cette sorte de jouissance froide et fade devant l’irrémédiable constat.
En fait, il n’est pas si facile que cela d’être soi.
A la réflexion, j’ai toujours eu du mal, au fond, à savoir de quoi il retournait. Je ne comprends même pas exactement ce que cela veut dire. Celui que je rencontre dans mes pensées quand je me tourne vers l’intérieur n’est jamais exactement celui que je croyais rencontrer et j’avoue que ça m’a toujours un peu, voire beaucoup, déçu.
Pour oublier, s’il ne pleut pas des cordes (en fait ça n’a aucune importance), je fais un tour de vélo. Le pâté de maison peut suffire, mais, si le moral est au plus bas, je m’aventure alors sur la route, ce qui est toujours source d’émotions, étant donné les bolides qui ne manquent jamais de me frôler, à ma plus grande joie. Le mieux pourtant est de pouvoir bifurquer sur un chemin de campagne, si bien sûr aucun molosse égaré ne se met en tête de me courser au-delà du raisonnable.
Je dors très peu.
Ma femme, elle, dort comme une pierre. On l’entend à peine respirer.
Son visage a une douceur angélique, quasi divine, qui disparaît au réveil…
Le plus souvent, je sors dans la rue faire un tour. Presque toutes les nuits.
Je fais mon jogging.
Il y a toujours un chien quelque part qui explore une poubelle.
J’ai inventé un jeu. Mais il ne faut pas trop en parler. Les voisins pourraient se plaindre.
Parfois je fais un peu de jardin, quand la lune est pleine surtout. J’observe les vers de terre, les limaces – des renards passent le long des champs. Il y a aussi des chevreuils.
J’ai exercé quelques temps le métier de cantonnier. Ce furent mes meilleures années, en termes d’activité professionnelle.
Puis je me suis retrouvé manœuvre pour une boîte vendant des matériaux de construction.
J’ai aussi exercé mes talents dans un supermarché, au rayon épicerie salée.
Maintenant je suis au chômage.
A la base, je voulais être infirmier; mais on n’a pas voulu de moi dans ce domaine. Je regarde souvent le film A tombeau ouvert. Ça me console de presque tout.
Nager. Une grande affaire. Chez certains, il y a un problème de température. Un défaut de constitution, une faiblesse métabolique entrent sans aucun doute en jeu. Dans la résistance au froid, je veux dire.
Pour ma part, quand l’eau n’est qu’un horizon lointain, je me sens assez semblable à un fruit déshydraté. Un peu chétif, un peu sec, amoindri en tout cas. Puis viennent les mois où je me sens prêt. Je recherche alors des lieux plutôt déserts. Il me faut de l’espace, du vide. C’est pour moi un moment d’ascèse – loin des jeux, des cris, des éclaboussements trop humains.
Une mer bien froide, gris-vert, pas trop agitée, a ma préférence. Alors le fruit déshydraté revient à la vie. Lentement. Il me faut un temps d’accommodation. Quelques exercices nautiques et les muscles reprennent peu à peu leur fermeté et leur souplesse originelles, la mécanique des bras, des épaules, des jambes se dérouille. Je peux alors filer dans l’onde opaque comme un jouet dont on aurait remonté le système d’engrenages à bloc. Crawl est le nom de ma religion. Tout est dans la respiration et la coordination des mouvements. Le début est laborieux. Oh Thalès, cruel Thalès de Millet ! Le corps se bat pour ainsi dire avec l’élément aqueux. Il n’y est pas encore tout à fait accordé. C’est un problème de rythme. Très important, le rythme. Avec de la persévérance et du calme, il finit pourtant par venir. Quand la symbiose se fait entre l’organique et l’environnement aquatique, alors le corps que je suis semble simplement glisser à la surface de l’eau comme une vague parmi les autres vagues. De fait, il y a bien à un certain moment une sensation d’effort, mais le mieux c’est lorsqu’on franchit justement le seuil de celui-ci. Il me semble alors que le temps se ralentit et qu’étrangement la lenteur que je savoure dans le déroulement et l’enchaînement de mes gestes est la source d’une stupéfiante vitesse. Quelques poissons me frôlent – et il est clair à mon esprit que parfois je suis à un cheveu de pouvoir les regarder dans les yeux.
Paradoxalement, mon autre source d’extase est une mer déchaînée (toujours froide), hurlante d’écume, prête à vous broyer les os, à vous concasser comme une benne à ordure. Je n’y verrais pas d’inconvénient d’ailleurs. C’est assez semblable à un combat de boxe. Sans doute y a-t-il une forme de démence des deux côtés. Chez moi, une rage, un effroi qui ne trouvent pas vraiment d’exutoire dans le rythme ordinaire des jours. Du côté de l’élément liquide, je ne sais pas. Mais la démesure est là. J’exulte donc devant l’effroi du paysage lui-même. Les collines autour, noires, compactes, assaillies par les flots glacés, le ciel plombé, l’atmosphère brumeuse et incertaine. Des mouettes, seules spectatrices, semblent ricaner, à l’abri, de mon insupportable forfanterie. Mais on ne se refait pas. Ma pauvre joie est à ce prix.
Un chien pouilleux semble s’être attaché à moi dans le quartier. La pitié animale n’a pas de mesure, dirait-on.
Quand je m’occupe de mon potager – quelques légumes malingres – il s’approche inexorablement d’une patte méditative et vient s’accroupir à quelques pas de moi. Il me fixe pendant des heures. Au bout d’un certain temps, il semble hocher de la tête, le museau humide. Puis, il s’en retourne.
Quand j’étais enfant, ma mère avait inventé, pour me punir, un supplice à mon intention : elle mettait des cailloux dans mes chaussures, me les laçait fermement et m’obligeait à marcher de longues minutes jusqu’à ce que les larmes me viennent. Idiot ! me lançait-elle alors.
J’ai mis au point un exercice d’ennui. Imparable.
C’est un secret.
C’est cela que je ressens je crois : un horrible et profond chagrin. Je ne suis pas certain que ces mots conviennent mais je n’en ai pas d’autres à disposition.
Je viens de faire des courses à l’hypermarché du coin. Je ressortais avec mon petit sac garni de quelques victuailles pour la semaine. Et là, je l’ai aperçue. A peine visible dans la pénombre de la fin d’après-midi, comme si elle avait honte de simplement être là. Un visage encore jeune, mais creusé. Quelque chose comme de l’effroi émanait d’elle, je crois. Mal habillée, et ce voile de tristesse dans le regard, je l’ai déjà rencontré, je ne sais où, mais ça sent la nuit, la pauvreté, l’abandon. Sur un carton qu’elle tenait devant elle, la tête basse, quelques mots expliquaient sa situation. Ils sont gravés dans mon esprit. Je me les répète encore. La plupart des gens passaient comme s’il n’y avait rien de particulier. Je suis aussi passé devant elle. Mais je n’ai pas pu aller très loin. Je sentais que ma gorge se serrait comme un linge humide que l’on tord. J’ai fait demi-tour et je lui ai donné mon sac. Elle a un peu souri. J’étais gêné, je ne me suis pas attardé. Puis je suis rentré. Et c’est là que je me suis mis à pleurer sans pouvoir m’arrêter.
J’y suis retourné. La jeune femme n’était plus là. J’espère pourtant pouvoir retrouver sa trace.
Journée migraineuse – distendue et alourdie par la fatigue du mauvais sommeil.
Ce soir, j’ai expulsé au dehors deux grosses araignées : une qui remontait le long de la cheminée et l’autre à l’étage, près de la chambre. Cela inquiète ma femme : elle en a très peur. Une angoisse, un frisson de dégoût horrifié la traverse à la seule vue de l’animal (une telle sensation m’est inconnue). Elle m’affirme que rien qu’à en saisir une, soudain, du coin de l’œil, dans un angle mal famé de son champ de vision, elle sent presque comme un contact comme si la bête la touchait vraiment, entrait en relation avec elle de façon intime – quelque chose de la substance de l’araignée lui semble alors proliférer sur sa peau, des éclats de peur la parcourent de la tête aux pieds. Véloce ou immobile, l’animal arachnéen a quelque chose (pour ma compagne) du fantôme, attendant nuit et fraîcheur pour ses dévorations spectrales – elle est de l’ordre de l’apparition, du surgissement incongru : un recoin quelconque, le dessous d’un meuble, un tiroir pourtant bien fermé (croit-on) : la condition de cet apparaître subit étant une progression laborieuse dans l’ombre, comme une mauvaise pensée.
A ce propos, il m’est arrivé d’imaginer à partir de cette obsession apeurée pour les araignées une histoire paranoïaque dans laquelle un mari terrifie sa femme à l’aide d’une (ou de plusieurs) petites/moyennes araignées qu’il domestique en secret. Son épouse en a une sainte horreur, n’ose même pas les écraser, tant la simple vision de l’animal la tétanise. Lui, construit, renforce, fait monter en puissance (peu à peu) cette insidieuse hantise. Il exacerbe l’aspect maladif de la situation, de façon quotidienne, en confrontant sa femme à des situations qu’elle ne peut dominer et qu’elle aurait voulu par-dessus tout éviter. En travaillant ainsi la peur entêtante de sa compagne, il la pousse au bord du suicide (un demi-accident…). Pas d’autre motif psychologique qu’une haine maladive, le désir de détruire à petit feu, l’arme du crime étant en elle-même innocente.
Tout ceci n’est pas très rassurant. Je vais aller jardiner. C’est une activité plus tranquille. Mon soutien psychologique canin m’attend sûrement.
Regardons ce qu’il y a dans ce miroir. Ma tête au premier plan. Bon. Derrière, une fenêtre et des rideaux. Une mouche qui s’approche de la surface froide et lisse, dessine une double parabole puis se pose sur son reflet – longtemps, ainsi, elle reste collée à son double ; et elle chemine un bon moment comme un étonnant petit narcisse drosophile.
Quand je reviens à ma tête, je me dis : tu es cette larve amère, mal rasée, posée à cet endroit dans l’espace.
C’est étrange.
[…]