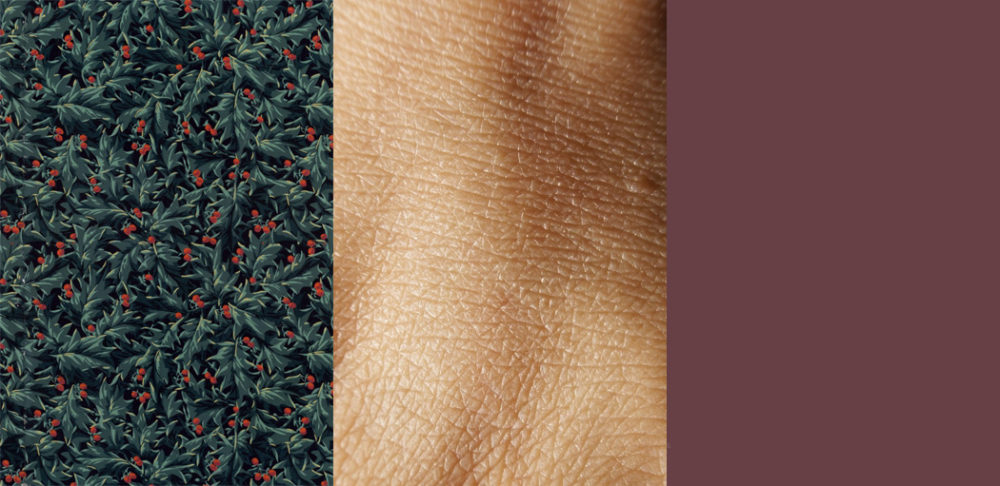Sommaire chronologique
Mal incurable – Jean-Jacques Brouard
Le diable et les détails – Charles Garatynski
Le frère impensable – Jean-Michel Maubert
Quai du grand port – Marceau Vassseur
Perds pas ton temps – Béatrice Vergnaud
Je suis un humain de compagnie – Jean-Michel Maubert
La fuite dans les idées – Jean-Jacques Brouard
Au ciel de la maison des morts – Régis Roux
Alice Grey – Rémy Leboissetier
Si la femme m’était contée – Gérard Cukier
La quadrature magique du texte – Gérard Cukier
L’encrevé – Rémy Leboissetier
Le passant – Jean-Jacques Brouard
Bouffons froids bouffés frits – Jean-Claude Goiri
Dans les hauts de l’île – Jean-Jacques Brouard
Ce vieux fou de Kaetz – Rémy Leboissetier
Dédale et Icare – Jean-Jacques Brouard
Vacances en Aciérie – Rémy Leboissetier
La vérité des masques, Métamorphose, Nuit féline – Gérard Cukier
Voyage en Anthropie (extraits) – Jean-Jacques Brouard
***
Jean-Jacques Brouard
Mal incurable
« Dans les caves des villes que nous traversions, nous entendions des plaintes et des gémissements venant du dessous, mais nous n’osions pas descendre, de peur de découvrir quelque horreur . Nous préférions poursuivre notre marche à travers les rues désertes des centres-villes dévastés et des faubourgs incendiés… Les monuments bombardés offraient leurs carcasses fragmentées aux réfugiés hagards. Nous ne reconnaissions rien. Des obusiers obstinés avaient décidé de tout détruire. Leur tâche accomplie, ils s’étaient retirés sans attendre et sans laisser d’adresse, sans scrupules ni regrets, les infâmes, même pas honteux. Puis l’aviation avait fini le travail avec un tapis de bombes qui avait soufflé les rares constructions encore debout. L’anéantissement était complet. La cité était rasée de près, c’était sûr ! Rien n’allait repousser, se disait-on. Propriétaires de ruines, qu’ils étaient, les habitants, et de gravats. Le présent était désespérant, mais l’avenir s’annonçait radieux pour les architectes, les plombiers et les maçons. Ils n’avaient plus qu’à tout nettoyer et à rebâtir à zéro. Du travail, ils n’allaient pas en manquer : il leur faudrait même sans doute l’aide d’un peuple ami. Ceux de l’au-delà de la mer allaient affluer par bateaux entiers pour participer à la Grande Restauration. Comme ils étaient miséreux et pas gourmands, on les paierait des nèfles. La vie serait belle. Ceux qui prétendaient le contraire étaient de fieffés battus d’avance, des saboteurs de moral, des dégonflés, des défaitistes : le poteau, qu’ils méritaient, les saligauds ! Une salve dans le poitrail, un point c’était tout ! »
Il sauvegarda le fichier et éteignit l’ordinateur. Il suffoquait : c’étaient des souvenirs pénibles, angoissants, insupportables vraiment : il valait mieux les oublier vite.
Le soir même, il s’abandonna lâchement à une beuverie débridée avec des acolytes de moyenne extraction dont il ne partageait ni franchement les valeurs ni vraiment la posture, mais cela lui permit d’effacer ce passé qui l’obsédait. C’était aussi un bon moyen de nettoyer l’âme de ses toxines.
Au milieu de la nuit, il exultait dans le délire, à poil, sous les étoiles, avec des étincelles dans le corps, en équilibre avec les anges sur un fil invisible, suspendu au-dessus d’un abîme qu’il était le seul à voir. Un faux mouvement, il le savait, et ce serait la chute dans un gouffre noir, gluant, indescriptible, terrifiant ! Mais il se rappela qu’il avait la tête ceinte d’une couronne de fleurs de cristal et de pétales de lave : son talisman !
Pour briser l’inouï train-train de la vie de bohème d’un vieux guerrier, rien de tel qu’un acte surréaliste ! Toucher les galaxies en tendant la main vers la voûte ! Laisser le palpeur de vent, juste sorti des entrailles de la déesse, mettre son doigt d’onyx dans la narine bien enflée du traumatisé ! Se brûler au magma du langage poétique ! Se vivre comme d’un autre monde, rescapé ou tout comme.
Imaginer l’innommable renaissance, si inattendue, si inespérée qu’on n’oserait pas la raconter. Inénarrable onirisme de fond du marginal.
Mais vint le matin et son flot de signes exogènes… Le vortex obligatoire… Le tunnel vers plus loin… La réalité pleine de pas de surprises du tout… Le présent tyrannique fit des ronds dans l’eau de ses rêves et dans la boue de ses cauchemars, des trous dans ses espoirs…
Lui, comme tous les autres, assistait, impuissant et médusé, à une courbure de l’espace-temps pour des considérations d’un autre âge. C’était comme si les pensées étaient asservies à un ordre supérieur contre lequel il était impossible de lutter autrement que par les outils critiques remis au cours des décennies par les formateurs, professeurs, détourneurs de sens, bidouilleurs de système, éventreurs de théorie et autre charlatans de la sémiotique restreinte. Outils bien inefficaces, ma foi ! Il suffisait de regarder le monde comme il dérivait…
Une catastrophe molle, songeait-il dépité, cet abandon des valeurs d’autrefois, de l’ancienne philosophie au profit de ce qu’on pourrait appeler la nouvelle genèse, la pensée unique…. On se laissait aller à des penchants hédonistes sans vraiment plus se soucier d’autrui, en se laissant vivre au gré des campagnes de publicité, vagues d’un tsunami qui noyait la conscience sous des tonnes de boue émolliente…
Ce qui les guettait, les citoyens mondiaux, c’était la peste masquée, ce fléau tapi dans l’ombre des salles des cartes, dans la moiteur des officines géopolitiques, dans la puanteur des laboratoires stratégiques. C’était le retour de la geste éternelle, la guerre du troisième millénaire, l’atrocité majeure…
Il voyait bien ce que serait l’avenir et il enrageait !
Non, ils n’allaient pas en sortir indemnes du tout, les modernes ! Une opération prévue de longue date par des vicieux qui l’avaient minutieusement préparée, cette étripade internationale, cette roustée planétaire… Ils l’avaient bien mitonnée, cette guerre, à coups d’industrie des armes et bagages… Ils en avaient fait un explose-trogne de précision, un écrase-mioches de grande portée, un brise-monde apocalyptique. D’abord, ils s’étaient passablement entraînés à petite échelle dans différentes régions des deux hémisphères; et puis, ils avaient créé des jeux de combats virtuels, afin d’habituer les mouflets à la violence ambiante, de normaliser l’étripaillerie, de banaliser le potlatch meurtrier… Il suffisait d’actionner une manette et d’appuyer sur un bouton et l’autre en face… déconstruit, pulvéradié, nullifié… Sans délai ni cérémonie. Un feu d’artifice des plus esthétiques : d’un geste, gerbes de couleurs et grand nettoyage à sec dans l’au-delà de l’écran. Qu’importe ces bipèdes cloportes, ces villes de maquette, ces écoles de théâtre des opérations, ces faux hôpitaux… De son avion de chasse, l’éphèbe aimera cette neutralisation à distance, sans état d’âme, le rire aux dents, candide, bien fier de lui et de son action d’éclat qui lui rapportera des points négociables. La guerre comme un jeu qui peut rapporter gros…
Une guerre ne s’improvise pas, elle se prépare de longue haleine. Il ne faut pas précipiter les choses. Pour la refaire, la guerre, il faut bien quatre générations : il faut que les gens aient oublié le prix du sang, que les citoyens n’aient plus en tête le souvenir des hécatombes, que la terreur de l’atroce s’efface, que s’estompe dans la mémoire collective la vision des grands cimetières sous la lune, que pourrissent les croix de bois dans le vent de l’histoire et sous la pluie solaire des commémorations.
Ah, il les voyait bien occupés, les potentats d’Occident, à se concerter en s’empiffrant de meringue et de caviar dans leur palais tout illuminés, pendant les sommets internationaux, en se grattant d’une main et en s’épongeant de l’autre, en comparant leurs trésors. C’est que, pour une belle conflagration mondiale, il ne faut pas regarder à la dépense. Il faut prélever l’impôt, distraire le peuple et l’inciter à creuser un abri de jardin en béton armé et à le remplir de boîtes de conserve pour se prémunir des effets primaires et secondaires de la déchireuse à noyaux.
Il entendit la grande voix qui disait : « Tout va bien. La guerre aura bien lieu, mais un peu plus tard. Soyez rassurés. Nous contrôlons la situation. Vous pouvez vous remettre la tête dans le sable. »
La minute d’après, ce fut le grand noir.
***
Charles Garatynski
Le diable et les détails
Depuis combien de temps ne l’avait-il plus touchée ? Même regardée — vraiment, avec le cœur — elle ne s’en souvenait plus. Ah, si, quand elle avait raté la soupe, deux semaines plus tôt. Quel ingrat ! Elle l’observa poser ses coudes sur ses genoux et regarder son chevalet avec amour.
– André, viens donc te coucher.
Il s’agita dans l’obscurité. « Il ne voit rien, mais il persévère à rater ses toiles », songea-t-elle.
– André…?
– J’arrive, Nadjima.
– Qu’est-ce que tu fais ?
– Tu sais bien ce que je fais.
– Mais tu as déjà retouché trois fois à la cuisse de cette grenouille !
– Tu ne comprends pas. Tout le tableau repose sur cette cuisse.
Elle posa ses lunettes sur la table de chevet et ferma les yeux sans chercher le sommeil. Il est vrai que ce côté artiste raté et compulsif lui avait plu dans sa prime jeunesse, mais aujourd’hui…
Il ne vint jamais se coucher cette nuit-là. Elle entendit le bruit des pinceaux caresser la toile des heures durant.
Il s’endormit sur le canapé, à sept heures, tandis que Nadjima se réveillait. Elle le regarda s’étaler sur la méridienne. Son ventre dépassait de sa chemise. Alors elle se décida, s’approcha de lui et coupa une de ses mèches de cheveux. Il y avait à Glod, leur petit village de Roumanie, une haute montagne qui dominait la plaine. On raconte que le diable y était réfugié depuis plusieurs siècles. On disait aussi qu’il se nourrissait des cheveux des époux défaillants, afin de leur ôter la vie et de délivrer leurs femmes excédées. Il réalisait aussi d’autres miracles, comme redonner la vue aux aveugles ou faire démarrer les moteurs des pick-ups en hiver.
Alors, aux premières lueurs du jour, elle chaussa ses bottes en plastique et prit le petit couteau du placard à cornichons pour se défendre. Dans la chaleur accablante, seule une légère traînée de poussière semblait la poursuivre. Elle aperçut finalement un homme tout de blanc vêtu, au détour d’un sentier.
– C’est toi, le diable des Carpates ?
– C’est moi-même ! Regarde donc !
Il désigna un olivier qui s’embrasa aussitôt. Nadjima sourit, satisfaite.
– Je ne pensais pas que tu t’habillais en blanc.
– Il fait trop chaud, j’ai abandonné le noir depuis longtemps.
– Soit, mais je ne viens pas pour cela. Je viens car mon mari ne me touche plus… Enfin, il ne me regarde même plus ! Il ne fait que peindre.
– Eh bien, pars !
– Non ! Je veux que tu lui enlèves la vie.
– Mais tu l’aimes tout de même, n’est-ce pas ?
Elle renifla.
– Oui.
– Je le vois. Je le sais. Je te propose autre chose. J’ai toujours rêvé de peindre un chef-d’œuvre, mais j’ai besoin d’une âme pour le faire. Je m’empare momentanément de celle de ton mari, j’exécute mon tableau au sommet de mon art, puis je lui rends sa liberté. Il ne peindra plus, trop assouvi par mon souvenir.
Elle lui tendit les cheveux d’André, mais au lieu de les avaler, il les glissa sous ses ongles sales, à même la chair. L’un d’eux se brisa, puis repoussa l’instant qui suivit. Enfin, sa peau se craquela comme celle d’un reptile.
– Je m’en vais trouver ton mari. S’agit-il bien d’André Miumiu qui habite au 56 boulevard du médecin-laboureur Caro…
Il n’eut pas le temps de finir, mais il ne se trompait pas. Peu à peu, ses mains s’évaporèrent, et il ne resta plus qu’une ombre blanche.
Quand elle rentra auprès de son mari, elle le trouva encore plus agité que d’habitude. Il était dans un état d’excitation extrême, changeait constamment d’orientation, arpentait la salle de vie avec rage.
– Ah ! Te voilà, Nadjima ! C’est ce qu’il me manquait.
Pour la première fois depuis longtemps, il lui témoigna de la douceur et semblait heureux de la voir. Elle remercia le Diable en silence, il n’avait pas traîné. Elle voulut embrasser son mari, mais se retint encore.
– Viens donc là, Nadjima. Approche-toi. Je veux te peindre. Je veux tout peindre de toi. Oh oui, oh oui !
Elle se dirigea d’un pas lent vers la fenêtre. Elle ne distinguait que le dos d’André. Dehors, un chien jappa.
– Approche-toi encore, et ne bouge plus. Montre-moi tes genoux.
Elle demeurait auprès de la fenêtre. Le rideau léger cachait son corps tandis que l’éclairage de la rue dessinait son profil. Il s’acharna sur la toile à coups de gestes larges mais maîtrisés. Elle croisa son regard : plein de fougue et de colère.
– Tu es belle, mon amour, mais il me faut plus. Il me faut voir plus précisément.
De sa chemise, il sortit une lame qui brilla dans l’obscurité.
– Que fais-tu, André ?
– Je veux voir l’intérieur, l’escalier de service… Et même les canalisations ! Je veux connaître toute la vérité pour mieux lui rendre hommage.
Elle tenta de ne rien laisser paraître et s’immobilisa dans la pénombre. Le souffle d’André devint rauque, trop brusque. Sa gorge se répandit en bruits étranges. Il faillit s’étouffer.
Quelques glaires vinrent inonder sa bouche. Il s’apprêtait à les cracher à même la toile, quand une voix d’outre-tombe résonna :
– Pas sur le tableau, imbécile !
Il ravala aussitôt les immondices.
– Pardon, maître.
– Ce que tu peux être distrait, reprit la voix. Reprends-toi ! Ne vois-tu pas qu’elle s’enfuit ?
Nadjima descendit les marches deux à deux et s’enfuit dans les ruelles de Glod. Avant de quitter l’appartement, elle n’avait pu entrapercevoir qu’une masse de couleurs informes sur la toile.
Seul, André colla son visage contre le mur.
– Comment faire, maître ? Je n’ai plus de muse à décortiquer.
– Eh bien, c’est toi qui vas devoir t’observer de l’intérieur.
Il serra davantage le manche du couteau. Il leva la lame et la suspendit à hauteur de son visage, prêt à fendre son ventre pour mieux s’observer. Le diable se cache dans les détails, pensait-il. Mais il hésita encore.
– Qu’attends-tu ?
– Je vais le faire, mais avant ça, qui êtes-vous, maître ? Je vous entends mais ne vous vois pas. Et puis, on ne se connaît que depuis cet après-midi. Je trouve qu’on va vite en besogne, tous les deux.
– Parce que tu as besoin que je te donne des raisons ? Quand on a la foi, on ne pose pas de questions. Au travail !
Il acquiesça. Il leva un peu la main et abattit de toutes ses forces la pointe du canif vers son nombril. Mais, à cet instant précis, il ne put accomplir son geste. Une force le retenait, silencieuse et incontournable.
– Maître, je n’y arrive pas ! Je te promets que je n’y arrive pas !
Il voulut pleurer, mais la voix le consola sans tarder.
– Ah, cher André, merci ! Tu as tout donné et tu n’as plus rien, c’est parfait. Tu m’as offert mon plus beau chef-d’œuvre. Tu peux mourir tranquille, désormais.
– Mais qui es-tu ?
Il ne le savait pas encore, mais la voix se tairait à jamais. Un coq chanta : l’aube. Il reposa sa tête sur le parquet encore frais.
Il existait une solution à son malheur. Lui aussi savait qu’on disait que le diable habitait les montagnes de Glod. Et s’il existait ? Il irait le trouver le matin même. Peut-être pourrait-il lui donner la force de se venger de la voix. Peut-être allait-il en profiter pour lui conférer un talent pour la peinture. Contre service rendu, bien sûr.
***
Jean-Michel Maubert
Le frère impensable
Il y a bien longtemps, j’ai connu un homme – qu’on peut ici nommer Georg K. – qui pensait le plus sincèrement du monde être le frère présumé mort – selon ses dires – de Franz Kafka. Il observait l’écrivain de loin, scrutait ses allées et venues, spéculait quotidiennement sur ses faits et gestes (notant dans un cahier sa façon de traverser une rue, de soulever son chapeau lorsqu’il croisait l’une de ses connaissances ; il faisait également des croquis quand il ne parvenait pas à mettre en mots ce qu’il observait), pensant mener avec méthode et discrétion une filature qui, à terme, pensait-il, confirmerait sa relation de parenté avec l’écrivain pragois. Il se vivait à la façon d’un double, d’un enfant perdu dans le temps, privé de ce qui aurait dû être sa véritable existence – luttant pied à pied contre l’image d’un passé brouillé, rendu illisible par des circonstances singulièrement retorses. J’ai retrouvé dans un de mes carnets des notes liées à cette histoire. Je les livre telles quelles.
La vie de Georg est à ses propres yeux profondément lacunaire. La certitude que Franz Kafka est son frère hante ses jours et ses nuits. Chaque minute de son existence est empoisonnée par cette certitude. Il le suit de loin en loin dans les rues de Prague, entre à sa suite dans des cafés, assiste à des spectacles de théâtre yiddish et tente de déchiffrer les émotions qu’il pense voir passer sur le visage de Franz. Il se dit parfois que, malgré toutes les précautions qu’il prend, Franz doit parfaitement savoir qu’il le suit et se nourrit de ses gestes, rires et mouvements de sa haute silhouette – telle une ombre seconde ou un petit animal furtif. Il lit avec avidité les quelques textes de Kafka qui ont été publiés. Il pense que le trouble morbide, l’angoisse (comme si l’intérieur de son crâne et sa minuscule chambre étaient repeints en noir), le rire intérieur froid – mêlé d’une étrange panique –, qui s’emparent de lui lorsqu’il lit l’histoire de Grégoire Samsa, sont des signes que tout cela à avoir avec lui. Il se dit : l’insecte, l’homme-insecte, incarne ce que je suis. Je provoque malgré moi répulsion et dégoût. Ce que Gregor est devenu fait de lui un être promis à une mort ignominieuse. Je serai ce mort qui n’a plus de visage, et qui pour les autres hommes n’est rien de plus qu’un déchet. K. ne s’est jamais adressé directement à Kafka. Il imagine leur rencontre dans ses rêveries, face à sa fenêtre sans lumière (elle donne sur un mur). Lui apparaît, face à lui, le visage de Franz, affable, un peu figé, le teint mat, un sourire indéchiffrable aux lèvres, le sondant de ses yeux bleus gris intenses. L’écrivain comprend qui il est avant qu’il puisse achever ses explications embrouillées. Cette scène revient dans des rêves peuplant la profonde nuit intérieure qui gît en lui, ou lors de ses insomnies – à la façon d’un film muet. Elle varie insensiblement, mais sans cesse fait retour et l’entraîne toujours davantage dans des pensées labyrinthiques qui l’épuisent. Il craint de finir interné dans un asile psychiatrique s’il parle de cela à qui que ce soit. Il ne peut le confier qu’aux pages de ses cahiers. Il lui arrive de penser que ce qu’il vit – une véritable torture quotidienne – est une histoire écrite par Kafka lui-même. La nuit, il voit la lumière d’une chandelle à la fenêtre de ce qu’il pense être la chambre de Kafka. Sa chambre d’écriture, se chuchote-t-il à lui-même tout bas. Il faut cette nuit du monde pour pouvoir se tourner vers une autre nuit, celle qu’on porte en soi. Une nuit peuplée de créatures sans nom, cachées dans des recoins infréquentés. Oubliées des hommes. Cela demande un œil et une oreille capables d’une extrême attention à ce qui est aux limites du visible et de l’audible. Saisir l’impensable. Les vies impensables. K. a, dans la famille où il a grandi, un autre frère, un peu plus jeune, qui, dit-on, vient du même endroit que lui. Il ne lui ressemble pas. Ils ont été adoptés, mais personne ne consent à leur révéler quoi que ce soit sur leurs origines. On ne sait pas quel est cet endroit dont K. n’a entendu parler que par inadvertance. Cette origine dérobée est sans doute, se dit K. quelquefois à lui-même (dans une sorte d’éclair de lucidité), la source d’une de ces légendes qui s’inventent dans l’enfance. Une de ces histoires qu’on se raconte le soir en chuchotant, et qui, espère-t-on, va nous ouvrir une porte sur le sommeil, et peut-être apaiser en nous une angoisse qui semble s’enraciner dans nos os. Malheureusement, par la suite, cette pensée croît dans la tête à l’instar d’une plante coriace insensible aux désherbants. Peu à peu s’installe la certitude de venir d’ailleurs, d’être comme Œdipe, un enfant maudit. K. n’en est pas absolument sûr, mais il croit avoir été petit dans la même école que Franz. Il doute que ce soit vrai, mais il se voit le consoler dans une cour d’école, passant en silence un bras autour des épaules de Franz. Lui est resté l’image d’une larme coulant sur la joue de Kafka. Il le voyait semblable à un animal craintif, cherchant à se retirer dans un coin d’ombre. Ce qui trouble aussi K. c’est que dans sa famille – la famille où il a vécu pendant son enfance – le frère aîné (l’enfant naturel de la famille) est mort en bas âge. K. sait bien qu’il n’est jamais facile de vivre et de respirer avec un tel fantôme sur ses épaules.
Il a cru pendant un certain temps se reconnaître dans un croquis dessiné par Kafka dans un café, sur une nappe en papier, et oublié par celui-ci – à moins qu’il s’agisse d’un bout de papier tombé à terre. Il n’arrive pas à retrouver ce portrait, mais il croit fermement qu’il s’agit de son visage – figé dans cette expression morose reflétée journellement dans le miroir au-dessus de la cheminée –, il en est absolument persuadé, tout autant qu’en cet instant la lumière du soleil éclaire sa main posée sur la table. Un autre phénomène occupe ses pensées. Il raconte qu’une petite souris toute grise vient le voir quand il est allongé dans son lit, et qu’elle lui donne des nouvelles de Franz. Elle surgit toujours quand il est à la lisière du sommeil. Il ne sait pas comment elle chemine de Franz à lui. De quelle manière elle passe d’un appartement à l’autre, en longeant les murs, filant par les rues hostiles et bruyantes, se hissant sur les toits, entrant dans les immeubles – mais, de façon intangible, son chemin familier, quel qu’il soit, la mène aux abord du lit de Georg. Parfois, dit-il, elle se love dans la paume de sa main. Sa voix est très aiguë. Les paupières de Georg sont lourdes, sa vision un peu trouble et brumeuse, mais il voit l’animal distinctement, ses yeux opaques et fiévreux, tels deux têtes d’épingles, ses moustaches vibrantes, son museau pointu, elle lui parle dans sa langue de souris, son chant grinçant, et tous les sons qu’elle émet viennent cogner contre les parois de ses tympans, puis se transforment en un récit – au sein duquel il lui semble percevoir des inflexions de voix ressemblant à celle de Kafka lui-même.
Georg s’est attelé à l’écriture d’un roman futuriste dans lequel un double de Kafka déambule dans une Prague fictive. Ce roman demeura inachevé, inachevable, se perdant dans des bifurcations narratives dont Georg n’arrivait pas à sortir, comme s’il découvrait à l’intérieur d’une pièce la porte vers une autre pièce qui menait à une chambre, puis à une autre chambre encore, ou un salon, ou une bibliothèque, ou à des couloirs se fondant dans d’autres couloirs, sans qu’il puisse jamais entrevoir l’architecture globale des lieux qu’il traversait. Dans son roman apparait un Golem machinique, dont la glaise matricielle a été remplacée par de l’acier et dont le principe d’animation ne serait pas des mots en hébreu mais des impulsions électriques. Georg décrit une Prague arpentée par des animaux-machines, hérissées d’immeubles transparents ; et où Kafka lui-même est un personnage, constructeur de machines, vivant au milieu de ses créations – un cafard mécanique, un agneau-chat tout en rouages et ressorts, des étoiles pensantes, une machine à scarifier les peaux humaines, etc.
Longtemps Georg eut la sensation persistante d’être le jouet ou le figurant du rêve d’un autre – de Franz lui-même ou de l’une de ses créatures. Il était convaincu que les créatures de Kafka ne pouvaient être seulement des êtres d’encre et de papier ; qu’il serait presque capable de les toucher mentalement en fermant les yeux. L’intensité de leurs tourments, leurs gestes et paroles – aussi froidement rapportés soient-ils – possédaient une texture telle que Georg les sentaient passer en lui et renaître dans le théâtre de sa tête. Les êtres que Kafka décrivait minutieusement avaient des silhouettes si nettement découpées dans le tissu des maisons et des rues, des chambres, des usines, des machineries bureaucratiques ou des plaines oubliées, qu’on ne pouvait à aucun moment les croire irréels. Il avait senti la neige et la boue sous leurs pas, vu leurs regards et entendu leurs voix qui, dans l’indifférence, s’éteignaient insensiblement, perçu leurs cris et gesticulations (tel ce rat transpercé cruellement par une lame de couteau et dont l’extrémité de la patte se referme telle une petite main), sondé la plaie infestée de vers qui ne guérissait pas (et au sein de laquelle il lui parut discerner sa propre mort), humé l’odeur rance et irrésistible des restes de nourriture – tout cela lui collait à la peau. Il s’était parfois éveillé avec l’impression tenace que l’une ou l’autre des créatures de l’écrivain – à l’image de la souris – se tenait aux abords de son lit, trop étroit pour son corps étiré, évoquant sur un mode comique un contorsionniste fatigué – ce qu’il n’était pas, vu la raideur de ses jambes et de de ses articulations.
Georg prétend avoir vu Kafka sur le lit d’hôpital (en réalité il s’agissait d’un sanatorium privé) qui deviendra son lit de mort. Il se serait rendu à son chevet quelques instants en jouant le rôle d’un livreur de fleurs – ces fleurs, des pivoines, dont Franz demanda à être entouré dans les tous derniers temps de sa courte vie. Il m’a dit qu’il a eu l’impulsion de se coucher dans le lit de Franz, à ses côtés, et qu’il aurait voulu le prendre doucement dans ses bras pour l’accompagner dans les ultimes heures de son existence ; il pensait qu’il aurait pu juste se blottir contre lui, à la manière d’un chien fidèle ; et ainsi le soutenir dans ses tentatives désespérées d’absorber – au prix d’une terrible souffrance – cet air dont la maladie le privait. Georg, bien sûr, ne fit rien de tout cela. Néanmoins il écrivit longuement dans son journal sur cette agonie qui barrait l’horizon de sa vie. Il avait l’impression de tomber dans le vide en silence, sans pouvoir rien n’y faire.
***
Marceau Vasseur
Quai du grand port
Au bord du quai du grand port, les pieds derrière un petit mur de ciment, Luis regrette la rambarde de fer rouillé, qui permettait de s’accouder sur la mer.
Il est debout, dans ses sabots, sous son béret.
A droite, un bras vert à musculature irrégulière retient par la taille la baie. A gauche, un bras en ciment se casse à angle droit vers le large. Sur l’épaule du même côté, un bâtiment blanc, la criée,
plein de rumeur ou de silence, fait semblant de prendre la mer.
Luis, d’un doigt, fait une bosse dans son béret.
Personne n’appelle.
Il fait soleil ce matin, les nuages sont gris-perlés. En face, sur la côte du Ris, trois pins à contre-jour, se fabriquent un espace d’estampe japonaise. Sur le triceps du bras droit, les Plomarc’hs
sont dans la ouate.
« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone! »
Luis, du même doigt, fait une autre bosse dans son béret.
« Treisour : »
A travers ses gros verres fumés, Luis regarde. Des pêcheurs
sur un bateau, l’appellent. Il descend de son pas court une des langues de ciment que le quai tire dans le port. De ses doigts prestes il libère un anneau rongé du nœud de l’amarre, la prend dans la main gauche, saute dans sa barque noire, l’éloigne en poussant de l’aviron contre la cale, godille.
Les maisons qui se grimpent les unes par-dessus les autres pour mieux voir la baie réfléchissent sur leurs vitres les crachats aveuglants du soleil. Les Plomarc’hs se découvrent: apparaissent les
contours dodus et verts, de petites maisons grises et trapues, les arbres aux hauts fûts parallèles. Les mouettes battent des odeurs d’herbes fraîches dans la forte haleine du flot.
Luis serre sa barque contre le cotre, en agrippant des deux mains son bord. Deux pêcheurs choient sur son plancher. Un troisième passe des cageots de maquereaux, de merlans, d’aiguillettes, saute à son tour. Luis dandine son embarcation vers la cale.
Ses yeux sont noirs et globuleux.
Ruelles et venelles du quartier du port descendent vers le quai: dansantes, tournantes, verdâtres, cassées, ouvertes, en cul-de-sac, sombres, ensoleillées, humides brouillardeuses glissantes
de bave, des Alcyons, au ciel mouvant, coupées du hoquet d’un escalier, de la virgule d’une fontaine, Boudoulec, gonflées de vent, immobiles, charriant des silhouettes bleues parfois oscillantes, des silhouettes noires, lentes à tête blanche, du Rosmeur, ne connaissant qu’une lettre de l’alphabet, le i grec en bois où sèche le linge.
Luis amarre sa barque à un anneau situé plus haut sur la cale, car la marée monte. Un des pêcheurs lui donne quelques maquereaux qu’une ficelle relie par les ouïes.
« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone ! »
« Combien as-tu as-tu vendu ton merlan Hervé ? », des voitures circulent sur la chaussée, la marée monte, les hommes s’affairent, repoussent le paysage, le vol des mouettes, les maisons des Plomarc’hs, les arbres aux hauts fûts parallèles. Les poissons morts se déversent sur la ville.
Luis étale le journal « le Télégramme » sur la table de l’unique pièce de sa cabane en bois, verte au toit goudronné, située sur le quai. Il y pose ses maquereaux, tire de sa poche un couteau, déplie la lame, tranche la corde qui les relie, attaque au bas du ventre, découpe en remontant, dégage les boyaux, range ses poissons bleus sur une assiette à fleurs, sort pour les laver à l’eau de la fontaine proche, revient, ressort aussitôt, tenant les boyaux enveloppés dans le journal, descend la cale ronde, jette son paquet dans la mer. Les goélands foncent dessus.
Des rigoles de pierres inégales écoulent les eaux au pied des murs blancs, ocre-sable, gris, parfois creusés de fenêtres myopes, au menton sur la rue, aux carreaux peints à petits rectangles jaunes et rouges, de portes brunes au sommet arrondi, des maisons des ruelles, qui répercutent très tôt le matin les cadences sèches des sabots, caoutchoutées des bottes, les voix de rocaille des pêcheurs bretons, graves, râpeuses, rauques, rouillées, faites pour la mer et contre le vent.
Luis en haut de la cale, retire son béret, le bat contre sa cuisse. Ses cheveux sont blancs, son visage est tanné.
Les toits bleuissants et coupants hachent le vent, ou se posent noirs et blancs sous le soleil comme un damier entrecoupé, ou recouvrent la ville par les soirs de brume, colorée comme une cuirasse de chevalier du moyen-âge.
Luis a un large sourire émacié qui strie des joues brunes picotées de poils noirs et blancs.
Une moto, moteur coupé, glisse sur le quai, prise sous un homme à veste beige, entre des jambes de velours marron. Il freine doucement, pose le pied droit à terre, décrit en l’air de la jambe
gauche un arc-de-cercle, pousse l’engin contre un mur, s’en va à pas longs, l’œil aigu, quatre doigts retournés sur le pouce et le bord de la manche, vire dans un bistrot.
Luis porte un habit de toile bleue.
Le ciel se soulève, le soleil se met à angle droit, le muscadet et le vin rouge montent et descendent dans les verres, les mouettes filent des traits blancs, les bateaux se reposent, les yeux se vissent dans la luminosité du moment.
Luis s’affaire près de son réchaud à gaz; de petites flammes sautent au cul de la poêle à frire, font crépiter l’huile, puis les maquereaux, qu’il secoue et retourne de temps en temps.
L’horloge, face au port, s’est arrêtée à quatre heures moins dix.
Le ciel est de belle toile, la mer de soie. La gueule en triangle, au bord du quai, les yeux très bleus, un gars tatoué plutôt musclé se laisse fendre verticalement par les rayons du soleil.
Luis, assis sur le bord de son lit, une assiette sur les genoux, découpe son maquereau, détache la peau de ses patates bouillies.
Des goélands voraces se précipitent dans un désordre blanc sur un poisson qui flotte ventre en l’air ; ils crient, se disputent, battent l’air et l’eau de leurs ailes jusqu’à ce que le poisson file dans un bec. Puis, calmés, ils vont chercher ailleurs.
Assis sur une barque retournée, Luis digère, en détaillant les couleurs mouvantes de la mer. De temps en temps, il respire profondément.
« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone ! »
Les sternes hystériques rayent l’azur de leurs cris et leurs vols aigus, plongent à pic.
« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone! «
Luis plonge ses yeux fermés dans la chaleur du soleil, tire en grimaçant sur le mégot qui lui brûle les lèvres.
Rue du Sémaphore, des draps qui sèchent se prennent pour des voiles, s’enflent et claquent de plaisir dans l’air sableux.
Au bord de cet après-midi, dans des bistrots, des hommes boivent en silence.
Luis, en passant, regarde son image, sur fond de port et de bateaux, dans la grande vitre du
café « Aux Loups des Mers », le dernier de ce côté, avant l’urinoir du bout du quai.
Des autos, des camionnettes de nouveau circulent, des moteurs de navires se mettent en marche, monsieur Auguste Le Mao doit téléphoner. Non.
« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone ! «
C’est une voix douce, un peu voilée, de femme, qui appelle au haut-parleur de la criée, prenant le quartier du port dans un filet de soie sonore.
Une lumière grise découpe avec acuité les arêtes des maisons et des toits.
Luis conduit dans son canot au plancher lisse comme celui d’une piste de danse quatre pêcheurs debout l’un derrière l’autre. Il masse l’eau de sa rame à longs et larges huits propulseurs.
Les nuages et la mer se plombent. Un goéland, plus blanc, ricane. Une nappe de mazout aux reflets arc-en-ciel se partage sous l’étrave, se reforme en dansant. Les sternes glapissent en cisaillant l’espace. Des mouettes se reposent, rêvent, fientent sur un vieux sardinier dodelinant. Une autre s’ennuie sur un yacht.
Luis revient, seul. Il range sa barque noire contre les pierres humides, brunes et vertes de la cale ronde, pose son aviron sur le plancher, saisit l’amarre, grimpe, fait quelques pas, la noue à un anneau de fonte.
Près de sa cabane, au pied d’un grand mur, des canots retournés sèchent leurs dessous fraîchement peints en brun roux de peinture sous-marine ou en noir de coaltar, où s’amalgament les fientes
blanches des oiseaux marins et, en virgule, les jus de chique de vieux pêcheurs qui conversent en haut du mur.
« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone ! «
Le soleil a accompli son trajet par-dessus les toits de la ville. Il vient de trouver une ouverture à travers les nuages, incendie l’Ile Tristan.
Le Quai du grand port est dans l’ombre, mais la rive du Ris est éclairée. Des voiles gobent la lumière. Des mouettes d’or planent.
– » Alors Luis, ça va? demande un pêcheur.
– Ça va, oui. Cari no scre ou pech.
– Oui, on a sorti quelques crabes. Oh, Yves, amène donc un crabe à Luis là ! Ça va la santé?
– Croc ki sa mour va den hospito ki rou dano mehor langoust so mero tani.
– Un mauritanien est arrivé, le Jupiter, avec trente tonnes.
– Si.
– Viens boire un coup là, chez Rose.
– Non, non.
– Tiens Luis, voilà le crabe.
– Non, non.
– Ah ben si !
– Merci.
Luis porte le crabe dans sa cabane verte.
– I va jamais au bistrot Luis.
– Non, i boit que d’l’eau.
– Il est Portugais ou Espagnol?
– Ché pas.
– Salut Rose, deux rouges. Tiens, La Brume, qu’est-ce qu’il t’est arrivé hier?
– Salut tonton, rôh, ils m’ont arrêté pour excès d’ivresse.
Le soleil s’écrase en mer,
Luis plonge son crabe au fond d’un faitout où l’eau bout. Les pattes rouges émergent,
raidies dans la vapeur. Luis les repousse en grognant, pose un couvercle et une pierre
dessus. Il s’assoit sur le rebord de son lit, s’accoude sur la table toute proche, regarde au- dessus de lui la barre de bois en diagonale où pend son linge. Le crabe gratte l’aluminium du récipient.
Des autos s’avancent lentement comme des tortues luisantes, derrière les entonnoirs blancs de leurs phares.
» Monsieur Auguste Le Mao! »
Les lueurs des hauts réverbères happent les grains de bruine, les vitres des bistrots font des taches jaunes verticales, qui débordent un peu à l’horizontale sur le trottoir où se distorsionne l’ombre du client.
Luis suce les pattes de son crabe
Dans les ruelles obscures se promènent à hauteur d’homme des points rouges de cigarettes.
Luis marche, revêtu d’un ciré jaune. Ses sabots l’équilibrent sur le quai visqueux. Le flot noir
clapote, les bateaux se cognent. Il s’arrête. La mer suinte amicalement la mort, et le goût du lendemain.
Demain, il se lèvera à trois heures pour porter à leur bord des pêcheurs. On entendra le remue-ménage obscur des hommes, qui, dans leur bateau, se prépareront à partir. La lune se balancera comme un fanal entre les nuages. Des maquereaux phosphorescents comme l’écume dégagée par les hélices se tordront sur le pont. Le petit jour découvrira un peloton d’une vingtaine de canots immobiles, à l’affût du poisson.
Peut-être que demain, à une heure un peu tardive, une barque orange appareillera. Les amateurs bavards et chanteurs qui la rempliront ne ramèneront que des échantillons de ce genre de poissons
téléostéens marins, de taille moyenne ou très petite, à chair tendre et légère très estimée, de la famille des gadidés.
Luis, à pas lents, regagne sa cabane verte.
***
Béatrice Vergnaud
Perds pas ton temps
Il n’y a pas si longtemps, existait un commerce florissant : le magasin du temps. William, désireux de connaître ce type de lieu ou, du moins, ce qu’il en restait, suivit le panneau indiquant : Vente de temps. Il en avait entendu parler lors d’une émission intitulée : Les métiers de jadis. Il s’agissait d’un groupement de personnes ayant du temps à revendre et qui se relayaient pour recevoir les clients. Le journaliste demanda à madame Printemps, la responsable de la boutique, pourquoi ces personnes vendaient du temps, en quelle quantité, comment ils procédaient, et qui se portait acquéreur. Elle avait répondu que c’était variable, que les revendeurs se relayaient en fonction du temps dont ils disposaient et avait expliqué qu’ils pouvaient vendre une ou plusieurs heures, une journée ou plusieurs, régulièrement ou ponctuellement. Il y avait même un système d’abonnement, des prix de gros pour les nécessiteux, qui pouvaient être des hommes d’affaires, des pères ou des mères de famille nombreuse et toute personne manquant de temps, répétant sans cesse sans même réfléchir : « Désolé, je n’ai pas eu le temps… Si je trouve le temps… Quand j’aurai le temps… Même en cent ans, je n’aurai pas le temps… Le temps, le temps, le temps et rien d’autre… » Mais aussi des personnes à qui on a répété depuis l’enfance : « Perds pas ton temps ! ». Toutes ces personnes vivaient dans la hantise de perdre leur temps et de ne pas le retrouver ; alors, ils prenaient une heure de leur temps pour aller acquérir du temps supplémentaire, parce que le temps, c’est de l’argent. Il y avait même des enfants qui demandaient combien ils pouvaient avoir de temps de récré pour quelques euros. Les ados étaient plutôt vendeurs qu’acquéreurs. Madame Printemps m’assura que ce business était légal puisque tout ce qui n’est pas interdit est légal.
Un passage à la boutique Printemps était un bon investissement, une façon de mettre le temps à profit. Certains achetaient au détail, d’autres en vrac, d’autres par lots quand il y avait une promo. Du temps, ajouta la marchande, certains n’en n’avaient jamais assez alors des vendeurs étaient présents chaque jour comme les bouquinistes ou la vendeuse de fleurs devant le cimetière. Plus les revendeurs avaient de temps à revendre et plus ils s’enrichissaient : autant que les hommes d’affaires. Cependant, il y avait des périodes creuses où il y avait un peu moins de temps disponible alors les prix montaient et les revendeurs s’enrichissaient encore plus. Qui étaient-ils ? Des retraités, des malades alités, des personnes sans domicile qui trouvaient le temps long, des enfants qui s’ennuyaient, plus rarement, quelques poètes du dimanche qui n’avaient rien à faire les six autres jours, des procrastinateurs, des intermittents du spectacle, des sprinteurs… Alors, dans les maisons, on entendait parfois : « Chéri, tu penses à prendre le pain au retour et quatre heures de temps : il est en solde, en ce moment. » Tout cela se passait bien, dans la joie et la bonne humeur, jusqu’au jour où des ingénus, pour ne pas dire de jeunes couillons, ne trouvèrent pas mieux que de donner de leur temps libre.
Jean-Michel Maubert
Je suis un humain de compagnie
Troisième et dernière partie
Puis je redeviens un homme d’intérieur.
Ne pas sortir.
S’occuper du ménage.
Laver la vaisselle.
Faire des puzzles.
Dormir.
Être l’homme qui n’existe (réellement) que les jours de pluie.
Je fais partie d’une chorale locale. Bien que je n’aie pas beaucoup de technique, il semble que ma voix étonne les autres. Ma professeure au premier chef. Elle m’a demandé où j’ai appris à chanter et, quand je lui ai répondu que j’étais pur de tout apprentissage, sa bouche s’est tordu en une moue si dubitative que les bras m’en sont tombés.
J’ai un ami : Andreï. Peut-être mon seul ami véritable. C’est un homme énorme. Il a beaucoup de difficultés pour se déplacer. Il marche très lentement, se tient aux tables, aux murs. Il mène une vie solitaire. Dans les rues, quand il s’arrête un moment pour reprendre son souffle, il se met à parler aux chats qui traînent dans le coin. Je ne sais pas pourquoi mais les félins réagissent en se contorsionnant, en minaudant, en faisant des bonds bizarres, comme s’ils avaient affaire à un courant électrique ou à une flaque d’eau froide. Ils n’arrivent pas à s’enfuir. Difficile de savoir s’ils souffrent ou s’ils vivent une expérience mystique. Souvent même, ils ne peuvent s’empêcher de le suivre jusque chez lui. On dirait un aimant qui attire irrésistiblement des objets ferreux. Je n’aime pas trop ces bandes de chats qui traînent autour d’Andreï. Il n’aime pas qu’on le questionne là-dessus. On se retrouve régulièrement dans un café, ou chez lui, pour jouer aux échecs. Sa vie semble triste à beaucoup. Elle l’est sans doute par certains côtés. Personnellement, je n’en sais rien.
Hier après-midi, ma femme et moi avons brûlé le cadavre d’un chat. Il avait dû être renversé par une voiture. L’abdomen était entièrement dévoré – par des pies ou un renard. On voyait la colonne vertébrale reliant la tête et l’arrière-train. Il s’est retrouvé – on ne sait comment – au milieu de notre allée envahie de mauvaises herbes ; les mouches étaient déjà dessus.
Elle comme moi ressentions un mélange de dégoût et de pitié. On ne savait pas quoi faire. Le brûler semblait être la solution la plus saine. Mais c’est horrible à faire, aussi mort soit-il, et ça prend du temps. Les yeux éclatent vite à cause de la chaleur, mais les os, eux, résistent. Un incroyable malaise ne m’a pas quitté pendant la crémation. Et pour tout dire, on ne se sent pas très bien non plus après.
Comme je ne dormais pas cette nuit-là, j’ai imaginé une histoire.
Un couple, en voiture, tue accidentellement un chat. Ils vivent à la campagne. Un peu désemparés (ils sont sensibles) ils laissent pourtant l’animal sur le bord de la route. Problème : peu de temps après, ils trouvent le cadavre de l’animal à demi-dévoré dans leur jardin. Ils décident de le brûler (comme nous). En même temps cela les dégoûte. Ils le font tout de même. La nuit qui suit, des rêves les assaillent. L’homme et la femme vivent en songe à peu près la même chose. Quelque temps plus tard, arrive l’hiver. Ils remarquent alors des chats dans les arbres dénudés qui bordent la maison. Il leur semble sans cesse apercevoir des ombres, des mouvements furtifs ; il y a des bruits bizarres, difficilement identifiables. Le comportement de l’homme se dérègle. Il s’imagine ou rêve qu’il chasse tous les chats des environs et passe son temps à les brûler – hormis son travail, cela devient sa seule activité ; ou alors il rêve qu’il les tue et les enterre dans son jardin, parsemant celui-ci de centaines d’ossements de félins. Une vraie ordure, ce type.
Pendant des mois et des mois, qui s’entassent comme un tas de bois, branche après branche, je me suis tu, parlant le moins possible. Agissant, mangeant (peu), dormant, buvant (de l’eau surtout), écrivant des cartes postales, etc. – tout cela dans un état de stupeur. N’avoir rien à dire, à penser. Le dégoût de dire et de penser. Ne sentir que la vie – mûrir dans cette stupeur, cet abrutissement ; et la nuit, la peur vague de je ne sais quoi.
Mais aussi, pendant cette période, la redécouverte de l’intelligence du geste, le profond plaisir de découper, scier, clouer, poncer (je fabrique des cercueils). Ne rien savourer d’autre. A part le sommeil. Se sentir comme une page blanche au dedans – un ver de terre coulant sur la terre avec une belle viscosité (le sol craquelé par endroit, petites torsions régulières, ramper, rien de plus plaisant même si cela se fait difficilement sous le dur soleil d’hiver).
Les mots, les pensées se décomposent dans ma bouche comme des champignons secs – poussière, effritements sans nombre de ce qui stagnait dans cette vase mentale qui croupit au sein de notre caverne d’os, notre pauvre crâne d’hominidé. Proposition : devenir, insensiblement, absolument muet – comme un arbre humain sans langage.
J’ai toujours eu une attirance pour les femmes que le regard commun tend à qualifier de laides. Pas des filles trop déformées ou défigurées (avec lesquelles c’est encore autre chose…), mais celles qui sont affectées d’une légère laideur et qui spontanément cherchent à fuir plutôt qu’à solliciter les regards des hommes ou des autres femmes. Quand un visage ayant un certain charme à mes yeux se trouve en même temps alourdi par une sorte de gravité flasque, un peu informe, voire maladive, alors il devient pour moi comme une lumière attirant un papillon de nuit. Mon esprit les photographie – et le soir pour m’endormir je repense à ces femmes, à leurs visages et à leur silhouettes, nimbées le plus souvent d’une douce lumière de néon de supermarché.
C’est étrange pour moi de rêver.
Dans un de mes songes, ma femme me poursuivait dans une vaste maison labyrinthique, constituée presque exclusivement de couloirs ; hormis une pièce au dernier étage, apparemment son repère, où tout était noir (les murs, les objets, le sol), si bien que je n’y distinguais rien (j’y suis entré par inadvertance (en fuyant): un piège à lumière où la moindre lueur se trouvait absorbée, comme évaporée l’instant d’après). Des fragments de films muets (?) parasitent ma course dans la maison. Mon malaise est si profond. Je ne sais pas ce que je fais là. Parfois je me tiens immobile. Il n’y a pas de raccord sensé entre chaque moment. Quand je parviens à sortir par un escalier qui mène dehors, dans un jardin sauvage, je m’aperçois que le clone onirique de ma femme me poursuit toujours et est en fait bien trop véloce pour moi ; je me retourne un instant, ralentissant ainsi ma course, pour m’apercevoir avec un mélange de stupeur et de résignation que je suis à sa merci. Ses mains sont tendues en avant vers ma poitrine, mais ce ne sont pas vraiment des mains, plutôt des griffes de félin – et d’ailleurs son visage semble avoir quelque chose du chat ; mais quand elle fond sur moi, je me réveille…
S’enfoncer dans l’ennui. Immobile à écouter les craquements d’un radiateur qui se dilate. Assis sur une chaise de bois jaune, les paumes des mains abandonnées sur une table petite et laide, face à la fenêtre. Le ciel blanc – bleu pâle ; la lumière grise partout, comme un soir qui n’arrêterait pas de tomber, tellement lentement qu’on se sent vaguement paniqué. Petites maisons, palpitantes de lumière, bordant les bois ; dans l’ombre rampante, je perçois encore l’à peine discernable scintillement d’une étendue d’eau (cette masse liquide qui semble croupir, moisir doucement à la façon d’un champignon dans une vieille armoire).
J’aime la musique. Beaucoup. C’est à la fois proche et lointain.
Je chante et j’écoute.
Uniquement la musique que l’on dit sacrée. Je ne sais pas vraiment pourquoi.
Comment dire ?
Peut-être qu’au fond on sent que ce n’est pas tout à fait d’ici, tous ces sons. Ça éveille en moi quelque chose.
Le sens du lointain, je dirais. Et que ça surgisse dans ce qui est le plus proche – un visage, une voix – c’est terriblement troublant. Presque effroyable. Beau souvent. Comme une nuit soudaine. Tout peut arriver.
J’aime ce lointain-là.
Le lointain, c’est bien.
Mais ce n’est pas toujours évident. C’est comme ma femme quand elle se tait et fait sa muette sans que je comprenne pourquoi. Une telle chose peut durer des jours. Des jours et des jours. Puis, au bout d’un certain temps, c’est comme si elle se réveillait de quelque chose, retournait vers nous, vers les chats et les lapins, les quelques oiseaux d’ici, les arbres, les visages des voisins, les nuages trop bas, et vers moi parmi tout ça. J’ai alors vraiment l’impression qu’elle revient d’une sorte de voyage, qu’elle était au seuil de quelque chose.
Mais je n’ose pas lui demander ce qui s’est passé.
Comme on voit, aimer le lointain ce n’est pas toujours facile.
C’est pourquoi on peut dire que j’aime le proche aussi.
Mais, de fait, ma compagne est pour moi proche et lointaine, comme une mélodie, une série d’harmonies, un chant profond ou quelque chose de plus indicible encore. Je veux dire qu’elle me fait l’effet d’un souffle musical, à peine humain, qui se love en moi – comme le ver qui cheminera au plus intime de nos chairs mortes – et me traverse – et qui cependant, en même temps, toujours, m’échappe. Totalement. D’ailleurs, ce que j’aime le plus me fait souvent l’effet d’une lame de couteau qui blesse et tranche au dedans d’obscures, et pourtant sensibles, fibres (?).
Rien d’autre à dire.
J’attire les mouches, c’est certain. J’ai beau les chasser d’une main rageuse ou en remuant convulsivement la partie du corps qu’elles viennent inopportunément visiter, toujours elles reviennent, s’acharnent sur ma pauvre viande. L’éternel retour de ces micro-charognards m’oblige ainsi à des chorégraphies pour le moins saugrenues. En même temps, si je m’immobilise, je prends le risque d’être recouvert par ces sombres demoiselles de compagnies, comme ces monstrueux papiers tue-mouche que l’on suspend dans les cuisines. Les hominidés savants n’ont aucune pitié.
Des songes vraiment bizarres déferlent en moi. Celui de cette nuit est encore tout frais dans ma mémoire.
J’étais perdu, désorienté, au sein d’une vaste plaine d’herbe vert tendre – mon principal problème venant d’un troupeau de rhinocéros à l’attention duquel j’essayais d’échapper (apparemment sans succès) ; ils étaient munis d’une corne effilée qui me parut terriblement pointue, mortelle ; ils semblaient tirer à eux l’espace lui-même (comme une simple couverture ou un simple tissu) tant leur masse corporelle les rendait à la fois majestueux, hypnotiques, effrayants. Cherchant un abri j’avais repéré un arbre blanc, très haut, dénudé, mais pourvu de suffisamment de branches pour que l’escalade en soit possible. Hormis cet unique havre végétal, l’horizon était désespérément nu et vide, d’une platitude écrasante. Il me sembla un instant que la troupe de mastodontes s’était éloignée je ne sais où, bien qu’il me semblât dans le même temps (de façon paradoxale) sentir sa présence menaçante tout près de moi. Me précipitant vers l’arbre, je m’aperçus qu’un des rhinocéros m’avait repéré et entamait une poursuite, gagnant à chaque instant – d’une façon incroyable – de la vitesse. Paniqué, je sentais déjà cette véritable armure de chair vivante fondre sur moi, anticipant l’inéluctable empalement de ma maigre carcasse et le concassage de mes os, muscles, organes et autres – il n’y avait aucune pitié à attendre de la part du sublime et antique herbivore (!). Secoué par cette vision, je me concentrai hypnotiquement sur ma cible, dépensai une énergie folle (nerveuse et musculaire) pour la rejoindre, l’atteignis enfin et grimpai frénétiquement le long du tronc de l’impassible végétal, tandis que mon poursuivant arrivait à proximité (je le sentais sans le voir véritablement, devinant sa danse furieuse autour de mon perchoir solitaire). Bientôt ses congénères le rejoignirent, augmentant ainsi considérablement la possibilité de ma fin prochaine.
Je me suis réveillé au moment où, sous leurs coups de boutoir l’arbre s’étant affaissé, je me trouvais à terre, dans la poussière, déjà à demi piétiné, le corps tout ensanglanté, attendant au-delà de tout effroi l’ultime estocade – ma conscience s’écoulant sans retour, comme mon sang, hors de moi.
Quelqu’un m’a encore parlé de la jeune femme. J’ai bon espoir.
Un autre rêve a surgi dans mon esprit, un matin, alors que je venais de me rendormir. Dans ce songe se manifeste – c’est pour le moins inhabituel – une femme-vitre dont le visage n’apparaît (dans le verre) qu’avec les irisations de la lumière naturelle, la pluie qui rend le matériau translucide ou le jeu des lueurs des réverbères. Sa transparence coutumière la rend plus mystérieuse et secrète que tout geste de dissimulation – que dire d’un être prisonnier de cet étrange espace, qui est peut être son ultime texture ?
Et dans mon rêve je rêve de la rejoindre.
Je pense toujours ce qu’il m’aurait fallu penser après coup. Toujours à contre-temps. Dans l’après certaines choses deviennent pour moi lumineuses. Les meilleurs jours, je me sens alors, pour quelques minutes, bienveillant et tranquille, mon corps devient plus léger, le pied est plus mobile. Mais cela ne dure pas. Peu après, tout retombe et je sens à nouveau le sombre magma psycho-organique remonter de je ne sais où en moi – c’est comme une mauvaise odeur, écœurante, qui envahit l’esprit, le corps, le paysage et rend tout irrespirable.
Difficile de s’arracher à cette pesanteur interne – tirant vers le bas chacune de mes fibres (comme ces vêtements gorgés d’eau). Alors chaque instant devient difficile.
Je l’ai retrouvée. Enfin ! Je lui proposerai de venir vivre chez nous. Ce n’est pas très grand mais on peut faire de la place. L’espace est toujours plus vaste que ce que l’on croit. Ma femme ne sera pas contre. J’en suis presque certain.
Ma bicyclette et moi dessus filant par les chemins sous le ciel couleur mine de plomb. Vent froid cinglant le visage.
Je m’approchais du lieu qu’on m’avait indiqué. De vastes champs à l’abandon. Une maison en ruine. Les bois tout autour. Chiendent et chardons proliférants, et partout des ronces en auréoles, entourant la maison.
A l’intérieur, petites pièces sombres encombrées. Des araignées sur les murs en quantité. De la vermine. Des museaux craintifs de souris ici et là.
Sur un pauvre feu, la carcasse, me semble-t-il, de ce qui avait dû être des endives, à demi-cuites à présent.
La jeune femme, près du maigre brasier, avait dû m’entendre approcher, mais elle ne dit rien. Elle me regarda juste ; et je ne pouvais que lui rendre son regard, y séjourner de longues minutes.
Je lui ai proposé de venir vivre avec nous. Ma femme l’accueillera avec cette douceur sobre qui la caractérise. La jeune femme est demeurée muette. Elle sourit pourtant. Nous pourrions former, dans cette maison, une étrange petite compagnie. On verra. Il me faut dormir à présent. La campagne est brumeuse, ce soir.
Jean-Michel Maubert
Je suis un humain de compagnie
Ce texte fait l’objet d’une publication en trois temps.
Deuxième partie
Dans un jardin abandonné une poignée de marguerites rouge écarlate, comme venues d’une autre planète.
On m’a indiqué des gens qui semblent savoir des choses sur la jeune femme du supermarché.
Tout cela m’inquiète, me tourmente. Pendant des jours.
Il me faut la retrouver. Et pour cela, il faut être patient et méthodique.
Ma première fiancée m’avait quitté en me disant : tu n’es qu’un sombre idiot. De même, lorsque je travaillais dans un magasin et qu’on m’a mis à la porte, c’est je crois pour un motif semblable.
Il semble que je ne comprends pas ce que tout le monde comprend – tout le monde : je veux dire un certain ensemble de personnes, leur nombre reste mystérieux. Toujours quelque chose m’échappe, aussi concentré ou éveillé que je sois. Par ailleurs, je ne suis jamais très sûr de ce que les gens veulent dire – réellement : ce qu’ils projettent de leurs sensations, humeurs, calculs, réticences, pensées, dans ce qu’ils disent. Certains mots sont comme des cailloux au fond de l’eau, je m’absorbe tout entier dans leur contemplation au lieu de m’accorder à l’écoulement des paroles – ce n’est pas une très bonne image mais je n’ai que cela sous la main. Comprendre ne m’est pas facile, c’est un fait. Et cela me tourmente, me laisse intranquille – comme un paysage à l’approche de l’orage – d’un orage perpétuellement différé. L’étrange impression demeure en moi que ma conscience n’est qu’un amas cotonneux (ou : un défilé perpétuel de nuages sales dans un ciel sans lumière) ; elle n’adhère pas vraiment à ce corps, à cette masse agglutinée de muscles, d’os, d’organes, de lymphe, de sang, comme si elle était hantée d’un sommeil profond, innommable, présent depuis toujours, rongeant la pauvre vie qui m’est échue, m’aspirant dans une torturante et sournoise, imperceptible, impersonnelle spirale (autour, il n’y a que des spirales : une mouche tournant dans un verre de bière – l’eau moussue et grasse de la vaisselle, chargée de limon alimentaire, tournant quelques instants dans le siphon de l’évier – le ciment tournant dans la bétonneuse – des pensées tournant dans ma tête – le lait tournant dans la centrifugeuse). C’est cette demi-vie qui est étrange, je n’y comprends rien. Je ne pourrais jamais me reposer assez, je sens que cela ne sert à rien, l’obscur engourdissement est plus profond, plus enfoui, sa mécanique si implacable est au cœur de ce que certains appellent encore bizarrement l’âme.
Mettons.
Ma femme a je crois une forme de compassion pour moi. Mon idiotie ne la rebute pas. C’est étrange si on y pense.
Pour elle je ressens une obscure passion. C’est à la fois calme et tumultueux, comme la mer. Ça n’a pas besoin de beaucoup de paroles. Mais, à travers sa présence, je respire. Je sens que (même maigre et mal employée) mon énergie vitale et le désir de demeurer ici-bas dépendent d’elle, de sa proximité ou de son éloignement, de son silence, du timbre de sa voix, du fait qu’elle marche, tourne la tête vers moi, sourit parfois, soit assise ou allongée dans l’herbe – et tant d’autres choses infimes. Même la nuit, ma main cherche à l’effleurer. Sans elle, je sens que rien ne tiendrait bon en moi, je partirais en poussière ou je m’écoulerais, je retournerais à la stupeur végétale de ma vie telle qu’elle était avant elle – avant qu’elle ne pose délicatement sa tête sur mon épaule.
Un calme tumulte je dirais, finalement.
Herbes grêles secouées par la brise froide. Je suis dedans. La vitre est mon séjour dans cette lumière d’ardoise.
Enfin, la pluie arrive.
Pourtant, rien ne peut me sauver réellement. J’ai perdu pied depuis trop longtemps sans doute. Effondré en dedans, comme un vieux mur. Souvent, pas de ressort. Reste seulement le vague écho d’une vivacité ancienne rongée par l’acide des heures et des jours. Englué dans la répétition du morne. Le vertige pourtant devant cet amoindrissement.
Souvent besoin d’air. Il me faut sortir.
La nuit donc, je rôde dans la campagne ou aux abord des villes. Je ne suis pas seul. La nuit est peuplée. Je rencontre souvent un homme à la voix un peu étrange (son accent je ne parviens pas à l’identifier) dont je ne vois jamais vraiment le visage. Nous marchons dans la nuit. C’est comme une autre vie.
Je continue à collecter des informations à propos de la jeune femme de l’hypermarché. Certaines langues se délient. Bien des gens vivent ici dans des maisons abandonnées, délabrées, insalubres – tant que personne ne vient, pour une raison ou pour une autre, les jeter dehors.
Je me sens terriblement maladroit. Je ne suis pas un enquêteur efficace. Pourtant ça avance un peu. Je sais qu’elle s’appelle Marie.
Ma petite table de bois. Face à la fenêtre. Manger un peu de pain sec. Un verre d’eau bien fraîche. De petites araignées stagnent sur la vitre. La lumière ne les tourmente pas encore.
Traverser les jours comme on traverse des murs.
Gris doré des paupières. L’ampoule –– illuminant un coin de nuit. Le terrain vague où passent d’étranges formes.
Ma femme. Le lit –– elle, dormant comme une ombre calme.
Des tulipes, bordées de ciel bleu.
L’œil rouge sang d’un lapin blanc comme du blanc d’œuf. Une guêpe sur un pare-brise, balayée d’un coup d’essuie-glace. Le jaune brûlant d’un champ de tournesols. De la poussière, plaquée sur les lèvres –– et le visage tout entier, les mains, et sur les murs les vitres : l’œuvre d’un vent continu. Le frémissement des hautes herbes. Une maison abandonnée.
Le sommeil d’une souris minuscule au creux de ta main.
Les couleurs feutrées de la chambre .
La lumière douce des objets.
L’ombre, quasi liquide.
Ma tête comme du coton noir.
Mes rides. Mes mains sèches.
Le souvenir d’un vautour dans un lavabo.
L’alcool. Le lit défait. La peau nue de ma femme, comme un rivage oublié. La ligne de tes vertèbres.
Une pomme découpée dans une assiette. La fenêtre entrouverte. L’odeur fraîche des champs.
Les eaux bleues noires.
Des museaux suintent au creux de la nuit. La forêt.
L’ombre maigre de ton corps.
La digue –– semblable à un signe oublié. La mer grise. Le clignotement des balises.
L’œil de cyclope du phare.
De vagues lueurs.
La lampe asphyxiée.
La poussière sur les vitres.
Les petits corps inertes des insectes. Des coquilles molles. Amis cloportes, je pense à vous.
Au sein de la nuit rongeuse, l’effacement des visages, des mains – des champs, des maisons et de leurs habitants, prisonniers du sommeil comme ces personnages de plastique dans leur bulle de verre neigeuse.
Ta main sur la table.
Nue. Immobile.
Délaissée.
L’aube. Le lait figé d’un clair matin.
L’orge, les blés.
Déjà le jour et son odeur de bête chaude.
Le silence des visages.
Une carafe, embuée de lumière.
Dans l’après-midi, l’estuaire, sa forme utérine soulignée d’ombre.
Des chiens se coursant sur la rive.
Le vol d’un essaim de guêpes.
Dans une crique, des mouettes avançant à pas menus sur le sable.
La lumière calme, éblouissante, du soir.
Un arbre, tel un cierge se dépouillant de ses oripeaux de cire.
Ces moments intermédiaires. Je ne cesse de les méditer.
Ciel filandreux. L’herbe tout autour de la maison. Fouillis. Entrelacs. Gravats, bicyclettes rouillées. Arbres décharnés – tous malades – et ces grouillements divers : vers, chenilles, mille-pattes, limaces, taupes, boue presque vivante (animée de l’intérieur par je ne sais quoi), araignées noires sur les murs (comme des traînées d’encre de chine). Puis, champs de maïs, renards furtifs. Parfois j’aperçois un lièvre chenu vibrant immobile (un instant) dans la brume froide de cet interminable matin.
L’impression vague de revivre plusieurs fois le même jour.
Mais ce n’est pas si simple.
Car, au fond, ma vie m’effraie – pas celle des gestes quotidiens, où on manipule des objets, plie des vêtements, touche le pelage d’un chien, ouvre la bouche pour parler, non, je veux parler de ce qui se passe entre tout ça, dans les moments intermédiaires, entre deux mouvements ou deux séquences de gestes ; là, pour moi, quelque chose échappe, je ne sais pas trop quoi, mais ma confiance s’évapore.
Moi, dont la vie onirique se trouve singulièrement raréfiée, j’ai, semble-t-il, rêvé cette nuit que le monde était envahi par des robots habillés en bleu. Rien de plus.
Je suis seulement là, le soir, au milieu de l’air vibrant d’une douce fraîcheur, habité d’une grouillante vie animale – apparemment calme pourtant.
Les arbres au loin. La vapeur estompée des lointains, comme absorbés dans un ondoiement blanchâtre. Confusion des formes. Cris d’oiseaux. Piaillements. Verts tendres et plus profonds des alentours. Superpositions de nuances de vert – de jaune. Un cri de coq perdu dans le lointain. Puis celui d’un coucou – sonore, clair. Des corneilles comme des tâches d’encre noire sur ce ciel-buvard blanc-bleu refroidi ; leur cri si grinçant, d’une pure noirceur sonore, constamment sinistre. L’humidité ; l’air se rafraîchissant ; une brise passagère ; ondulations froides. Un rouge-gorge délicatement posé sur une barrière de bois. Des pigeons sur les fils électriques. Un énorme bourdon velu errant dans l’herbe, voletant lourdement autour de petites fleurs jaunes. Le beuglement profond d’une vache, comme un bloc sonore surgissant de la profondeur des champs (ouvrant l’espace, le déchirant presque). Des grives empêtrées dans les fines branches d’un arbuste. Des mouches sur les vitres. Des tout petits lapins apparaissant furtivement dans l’herbe fraîche. Et au loin, sous les arbres, glissant déjà dans l’ombre (mon regard l’a à peine effleuré), la silhouette hâve d’un renard.
[…]
**
Jean-Michel Maubert
Je suis un humain de compagnie
Ce texte fait l’objet d’une publication en trois temps.
Première partie
« Je n’étais pas dans mon assiette. Elle est profonde mon
assiette, une assiette à soupe, et il est rare que je n’y
soit pas. C’est pourquoi je le signale. »
« Bon. Maintenant qu’on sait où l’on va, allons-y. Il est
si bon de savoir où l’on va, dans les premiers temps.
Ça vous enlève presque l’envie d’y aller. »
– Molloy –
« Non non, simplement la misère mentale, le nom me
reviendra dans la nuit. »
– Tous ceux qui tombent –
Samuel Beckett
Une araignée progresse prudemment sur le plâtre blanc du mur.
Encore l’éternel ballet mécanique de l’arachnide errante, fidèle à elle-même, belle en un sens, mais trop lente malgré ses pointes inopinées de vitesse, je trouve.
Dissimulée, à présent.
Deux pattes sont un peu trop visibles.
J’ai une technique avec des bouteilles en plastiques coupées en deux. Il faut juste être patient. J’ai tout l’après-midi. Quand l’araignée a daigné sortir de sa cachette je m’arrange pour qu’elle tombe dans le fond de la bouteille. Je vais ensuite tranquillement la remettre dans un buisson ou dans le garage s’il fait trop froid. Cette fois-ci, je la dépose au pied d’un arbre.
J’aime les algues.
Des lamelles. Reposant dans leur piscine d’huile.
Une grande assiette blanche bordée d’un liseré bleu. Je dois manger ce fouillis mariné (pour me nourrir). Je vais donc les avaler. Dans une poignée d’instants.
Voilà, c’est fait.
C’est fait, mais il me faut dire que je me sens solidaire de ces créatures – et de bien d’autres (comme les loutres, par exemple, mais ça n’a rien à voir).
Ces algues, bien sûr, elles sont écrasées, broyées, mâchées consciencieusement pour certaines et finalement dissoutes, réduites à l’état de pur souvenir – n’empêche, je me sens solidaire.
La solidarité instinctive des vaincus, peut-être. Sûrement, oui.
Je suis assis dans un fauteuil. Ma femme s’approche, pose sa main sur ma tête. Va-t-elle esquisser un mouvement?
Non, finalement non.
J’attends. Quoi encore ?
J’attends.
La main reste immobile un bon moment, puis se retire.
Le plus difficile pour moi a été de découvrir que j’étais un minable pur. Un pur, oui.
J’ai eu du mal à m’y habituer.
Plus encore : ça m’a été difficile de le comprendre – je veux dire : réellement, le comprendre, saisir l’idée à même les gestes et pensées du quotidien.
Car mon esprit est lent. Très, très lent. D’une lenteur de jour gris interminable.
Donc, ce fut une sorte de révélation – progressive, disons. Ma femme m’a aidé à y voir clair, à sa manière.
L’onde de choc s’est fait sentir durant des années. Jusqu’à aujourd’hui sans doute.
Mais on se fait à tout finalement. C’est ça le plus étonnant – cette sorte de jouissance froide et fade devant l’irrémédiable constat.
En fait, il n’est pas si facile que cela d’être soi.
A la réflexion, j’ai toujours eu du mal, au fond, à savoir de quoi il retournait. Je ne comprends même pas exactement ce que cela veut dire. Celui que je rencontre dans mes pensées quand je me tourne vers l’intérieur n’est jamais exactement celui que je croyais rencontrer et j’avoue que ça m’a toujours un peu, voire beaucoup, déçu.
Pour oublier, s’il ne pleut pas des cordes (en fait ça n’a aucune importance), je fais un tour de vélo. Le pâté de maison peut suffire, mais, si le moral est au plus bas, je m’aventure alors sur la route, ce qui est toujours source d’émotions, étant donné les bolides qui ne manquent jamais de me frôler, à ma plus grande joie. Le mieux pourtant est de pouvoir bifurquer sur un chemin de campagne, si bien sûr aucun molosse égaré ne se met en tête de me courser au-delà du raisonnable.
Je dors très peu.
Ma femme, elle, dort comme une pierre. On l’entend à peine respirer.
Son visage a une douceur angélique, quasi divine, qui disparaît au réveil…
Le plus souvent, je sors dans la rue faire un tour. Presque toutes les nuits.
Je fais mon jogging.
Il y a toujours un chien quelque part qui explore une poubelle.
J’ai inventé un jeu. Mais il ne faut pas trop en parler. Les voisins pourraient se plaindre.
Parfois je fais un peu de jardin, quand la lune est pleine surtout. J’observe les vers de terre, les limaces – des renards passent le long des champs. Il y a aussi des chevreuils.
J’ai exercé quelques temps le métier de cantonnier. Ce furent mes meilleures années, en termes d’activité professionnelle.
Puis je me suis retrouvé manœuvre pour une boîte vendant des matériaux de construction.
J’ai aussi exercé mes talents dans un supermarché, au rayon épicerie salée.
Maintenant je suis au chômage.
A la base, je voulais être infirmier; mais on n’a pas voulu de moi dans ce domaine. Je regarde souvent le film A tombeau ouvert. Ça me console de presque tout.
Nager. Une grande affaire. Chez certains, il y a un problème de température. Un défaut de constitution, une faiblesse métabolique entrent sans aucun doute en jeu. Dans la résistance au froid, je veux dire.
Pour ma part, quand l’eau n’est qu’un horizon lointain, je me sens assez semblable à un fruit déshydraté. Un peu chétif, un peu sec, amoindri en tout cas. Puis viennent les mois où je me sens prêt. Je recherche alors des lieux plutôt déserts. Il me faut de l’espace, du vide. C’est pour moi un moment d’ascèse – loin des jeux, des cris, des éclaboussements trop humains.
Une mer bien froide, gris-vert, pas trop agitée, a ma préférence. Alors le fruit déshydraté revient à la vie. Lentement. Il me faut un temps d’accommodation. Quelques exercices nautiques et les muscles reprennent peu à peu leur fermeté et leur souplesse originelles, la mécanique des bras, des épaules, des jambes se dérouille. Je peux alors filer dans l’onde opaque comme un jouet dont on aurait remonté le système d’engrenages à bloc. Crawl est le nom de ma religion. Tout est dans la respiration et la coordination des mouvements. Le début est laborieux. Oh Thalès, cruel Thalès de Millet ! Le corps se bat pour ainsi dire avec l’élément aqueux. Il n’y est pas encore tout à fait accordé. C’est un problème de rythme. Très important, le rythme. Avec de la persévérance et du calme, il finit pourtant par venir. Quand la symbiose se fait entre l’organique et l’environnement aquatique, alors le corps que je suis semble simplement glisser à la surface de l’eau comme une vague parmi les autres vagues. De fait, il y a bien à un certain moment une sensation d’effort, mais le mieux c’est lorsqu’on franchit justement le seuil de celui-ci. Il me semble alors que le temps se ralentit et qu’étrangement la lenteur que je savoure dans le déroulement et l’enchaînement de mes gestes est la source d’une stupéfiante vitesse. Quelques poissons me frôlent – et il est clair à mon esprit que parfois je suis à un cheveu de pouvoir les regarder dans les yeux.
Paradoxalement, mon autre source d’extase est une mer déchaînée (toujours froide), hurlante d’écume, prête à vous broyer les os, à vous concasser comme une benne à ordure. Je n’y verrais pas d’inconvénient d’ailleurs. C’est assez semblable à un combat de boxe. Sans doute y a-t-il une forme de démence des deux côtés. Chez moi, une rage, un effroi qui ne trouvent pas vraiment d’exutoire dans le rythme ordinaire des jours. Du côté de l’élément liquide, je ne sais pas. Mais la démesure est là. J’exulte donc devant l’effroi du paysage lui-même. Les collines autour, noires, compactes, assaillies par les flots glacés, le ciel plombé, l’atmosphère brumeuse et incertaine. Des mouettes, seules spectatrices, semblent ricaner, à l’abri, de mon insupportable forfanterie. Mais on ne se refait pas. Ma pauvre joie est à ce prix.
Un chien pouilleux semble s’être attaché à moi dans le quartier. La pitié animale n’a pas de mesure, dirait-on.
Quand je m’occupe de mon potager – quelques légumes malingres – il s’approche inexorablement d’une patte méditative et vient s’accroupir à quelques pas de moi. Il me fixe pendant des heures. Au bout d’un certain temps, il semble hocher de la tête, le museau humide. Puis, il s’en retourne.
Quand j’étais enfant, ma mère avait inventé, pour me punir, un supplice à mon intention : elle mettait des cailloux dans mes chaussures, me les laçait fermement et m’obligeait à marcher de longues minutes jusqu’à ce que les larmes me viennent. Idiot ! me lançait-elle alors.
J’ai mis au point un exercice d’ennui. Imparable.
C’est un secret.
C’est cela que je ressens je crois : un horrible et profond chagrin. Je ne suis pas certain que ces mots conviennent mais je n’en ai pas d’autres à disposition.
Je viens de faire des courses à l’hypermarché du coin. Je ressortais avec mon petit sac garni de quelques victuailles pour la semaine. Et là, je l’ai aperçue. A peine visible dans la pénombre de la fin d’après-midi, comme si elle avait honte de simplement être là. Un visage encore jeune, mais creusé. Quelque chose comme de l’effroi émanait d’elle, je crois. Mal habillée, et ce voile de tristesse dans le regard, je l’ai déjà rencontré, je ne sais où, mais ça sent la nuit, la pauvreté, l’abandon. Sur un carton qu’elle tenait devant elle, la tête basse, quelques mots expliquaient sa situation. Ils sont gravés dans mon esprit. Je me les répète encore. La plupart des gens passaient comme s’il n’y avait rien de particulier. Je suis aussi passé devant elle. Mais je n’ai pas pu aller très loin. Je sentais que ma gorge se serrait comme un linge humide que l’on tord. J’ai fait demi-tour et je lui ai donné mon sac. Elle a un peu souri. J’étais gêné, je ne me suis pas attardé. Puis je suis rentré. Et c’est là que je me suis mis à pleurer sans pouvoir m’arrêter.
J’y suis retourné. La jeune femme n’était plus là. J’espère pourtant pouvoir retrouver sa trace.
Journée migraineuse – distendue et alourdie par la fatigue du mauvais sommeil.
Ce soir, j’ai expulsé au dehors deux grosses araignées : une qui remontait le long de la cheminée et l’autre à l’étage, près de la chambre. Cela inquiète ma femme : elle en a très peur. Une angoisse, un frisson de dégoût horrifié la traverse à la seule vue de l’animal (une telle sensation m’est inconnue). Elle m’affirme que rien qu’à en saisir une, soudain, du coin de l’œil, dans un angle mal famé de son champ de vision, elle sent presque comme un contact comme si la bête la touchait vraiment, entrait en relation avec elle de façon intime – quelque chose de la substance de l’araignée lui semble alors proliférer sur sa peau, des éclats de peur la parcourent de la tête aux pieds. Véloce ou immobile, l’animal arachnéen a quelque chose (pour ma compagne) du fantôme, attendant nuit et fraîcheur pour ses dévorations spectrales – elle est de l’ordre de l’apparition, du surgissement incongru : un recoin quelconque, le dessous d’un meuble, un tiroir pourtant bien fermé (croit-on) : la condition de cet apparaître subit étant une progression laborieuse dans l’ombre, comme une mauvaise pensée.
A ce propos, il m’est arrivé d’imaginer à partir de cette obsession apeurée pour les araignées une histoire paranoïaque dans laquelle un mari terrifie sa femme à l’aide d’une (ou de plusieurs) petites/moyennes araignées qu’il domestique en secret. Son épouse en a une sainte horreur, n’ose même pas les écraser, tant la simple vision de l’animal la tétanise. Lui, construit, renforce, fait monter en puissance (peu à peu) cette insidieuse hantise. Il exacerbe l’aspect maladif de la situation, de façon quotidienne, en confrontant sa femme à des situations qu’elle ne peut dominer et qu’elle aurait voulu par-dessus tout éviter. En travaillant ainsi la peur entêtante de sa compagne, il la pousse au bord du suicide (un demi-accident…). Pas d’autre motif psychologique qu’une haine maladive, le désir de détruire à petit feu, l’arme du crime étant en elle-même innocente.
Tout ceci n’est pas très rassurant. Je vais aller jardiner. C’est une activité plus tranquille. Mon soutien psychologique canin m’attend sûrement.
Regardons ce qu’il y a dans ce miroir. Ma tête au premier plan. Bon. Derrière, une fenêtre et des rideaux. Une mouche qui s’approche de la surface froide et lisse, dessine une double parabole puis se pose sur son reflet – longtemps, ainsi, elle reste collée à son double ; et elle chemine un bon moment comme un étonnant petit narcisse drosophile.
Quand je reviens à ma tête, je me dis : tu es cette larve amère, mal rasée, posée à cet endroit dans l’espace.
C’est étrange.
[…]
(A suivre)
***
Jean-Jacques Brouard
La fuite dans les idées
Dans la lumière noire du songe nocturne, plongé dans les grands méandres bleus et jaunes du fleuve de l’aventure, il s’adonnait à des fantasmes outranciers sans jamais se soucier du qu’en-pensera-t-on.
Grand ami de son chat, un fin matou aussi noir que la suie des cheminées du diable, luisant comme l’anthracite, furtif comme la pluie traversière des grandes îles de l’ouest, il côtoyait les félins du rêve dans leurs escapades ténébreuses.
Bercé par les ondulations caressantes de la Suite n°1 pour violoncelle de Bach, il trouvait les sources d’une inspiration profonde dans les failles du tréfonds de son inconscient. Les pages qui s’ensuivaient se déroulaient comme les parchemins d’un texte sacré que des lecteurs intronisés venaient déchiffrer au crépuscule sur le lutrin de jaspe d’un promontoire antique qui dominait une plaine inondée. L’entrée du labyrinthe n’était pas gratuite : les avares n’en sortaient jamais.
Son égérie, une jeune fille nubile aux longs cheveux noirs, allait et venait dans un jardin aux arbres si vénérables que leurs racines patinées par les sandales des fidèles plongeaient en torsades compliquées dans les chairs d’une poésie chtonienne, ancestrale et lustrale.
Beaucoup veillaient tard. Les souffles de la nuit parvenaient à travers une brume de textes flottant dans l’air du temps… Des yeux séduisants volaient dans un ciel mauve qu’illuminaient parfois les queues en spirale des galaxies les plus proches. Les étoiles composaient des signes mystérieux…
Il était le Grand Maître du sens occulte. Son rempart était la solitude. Le contexte social et politique l’importunait : il préférait s’isoler dans la quête d’un Graal intérieur, retiré du monde futile, refusant les sortilèges de l’apparence et les faux-semblants de la modernité… Peu à peu, détaché des choses de ce monde, enfermé dans ce manoir qui était un palais, il en arriva à éprouver de l’amour pour l’abstraction pure.
Le temps fut celui d’une longue ascèse. Enfin, un jour, il rencontra un être qui était cette abstraction, l’incarnation d’une beauté idéale et il éprouva pour elle un amour platonique, voire platonicien. Après cette rencontre, que pouvait-il y avoir d’autre ? Elle était l’alpha et l’oméga. Il vécut auprès d’elle des moments indicibles, des instants éternels, des secondes extatiques.
Au fil des mois et des années, le plaisir de partager sa vie avec elle céda à la crainte de la perdre. Il se mit à souffrir de ne plus pouvoir se concentrer sur le présent. Aspiré par un futur funeste, il sombrait dans une tristesse exténuante. Seule la perspective d’un éternel retour pouvait le sauver du désespoir. Elle allait mourir un jour et dès lors ils allaient revivre leur voluptueuse union. Mais l’attente de la tragédie prévisible sans qu’il pût savoir quand elle se produirait devint insupportable. Il fallait donc la faire mourir sans tarder pour mettre fin au martyre. Un soir d’orage, il la tua d’un coup de poignard et l’ensevelit dans le caveau du domaine. Comme il revenait vers le bâtiment central du château, la foudre s’abattit sur lui et il s’embrasa dans la tourmente. Les vents dispersèrent ses cendres et il disparut du monde.
Quelques années plus tard, la fondation chargée de la gestion de son œuvre obtint des autorités la permission de faire l’inventaire des meubles, des objets et des manuscrits et d’exhumer le cadavre de celle qu’il avait adulée et – on en avait désormais la preuve en étudiant ses écrits – assassinée. On finit par trouver le caveau au centre du labyrinthe. Le cercueil fut ouvert : il ne contenait rien. L’inventaire commença, mais ne put s’achever car, trois jours après le début de l’opération, un incendie ravagea l’immense bâtisse. Biographes et analystes littéraires s’accordent pour douter de l’existence de l’être idéal qu’il célèbre pourtant dans de nombreux textes, soulignant sa beauté, son intelligence, sa sensualité et son… évanescence.
***
Régis Roux
Au ciel de la maison des morts
La maison n’est pas seule. Son entrée qu’une vente accorde à de nouvelles silhouettes conserve secret le vent des collines. Chaque peinture à l’huile de maman dans la cuisine, le salon, le couloir qui monte à l’étage et les chambres en est la lumière infinie. Le vent des collines efface tout labyrinthe. Je ne crois pas que la poussière envahisse un portrait vivant, que l’odeur du bois plongé dans l’obscurité ne parle plus d’une fête avec l’herbe coupée, la glycine, la menthe.
Je suis dans l’antichambre de la foudre et j’interroge les signes immobiles de ce qui reste. Ce violon sur la commode, a-t-il été donné par un passeur de rêves après qu’il ait vécu au-delà de nos collines ? Cette statuette si pâle de jeune femme qui lit, une joue dans la main, avec à côté d’elle, sur le piano, un violon qui est aussi représenté dans un tableau, juste au-dessus, quelle lecture fait-elle ?
Et moi, combien d’automnes brûlés dans la chaudière ou d’hivers fous de silence ai-je toujours en moi ?
Voici le grand canapé noir. Je m’y allonge, tout comme papa le faisait ; et comme papa juste avant sa mort, je regarde la bibliothèque. Il avait demandé quelque chose comme ( je le formule de façon plus poétique) : « où est l’album du jardin disparu ? »
…
Dans ma petite chambre sous le toit, le poêle en fonte n’existe plus, mais je retrouve l’odeur de l’épicéa, je sens la furie du foyer qui surchauffait la pièce. Aux murs sont encadrés un champ d’hiver, un chemin creusé dans les bois.
Le temps a séparé un cœur des couleurs et des formes. Petite maman, quel coup tombé d’un ciel de démence, depuis quelques années, masque ta sensibilité ? Il te coupe de la peinture. Sur la neige du paysage d’hiver on voit mes traces de pas. Elles viennent d’une photo que j’avais prise et qui t’avait inspirée.
J’ouvre un tiroir : voici de petites aquarelles. Ce sont des cartes de vœux dont tu réalisais bien des versions, mais que tu n’envoyais pas toujours, ayant de la peine à t’en séparer. A propos de la série sur notre maison, jamais la façade n’est peinte, elle pourtant très typique avec ses galets rouges disposés en arête de poisson. De l’intérieur de l’habitation, par contre, on retrouve le coin de cheminée, la statue blanche au violon, l’horloge comtoise, des compotiers, des verres bleus, des fruits avec un chat, et puis le grand miroir du salon habité par une prairie que des fleurs illuminent.
…
Je me rends dans le bosquet de pins de la propriété. Comme avant. Je ne restais jamais longtemps dans la maison, et souvent je partais marcher à travers les collines jusqu’à l’étang de Johanna, ou alors gagnais la rivière sauvage que les crues faisaient danser, nouvelle entre pierriers, souches et passerelles tordues.
Je suis bien dans le bosquet de pins couvert d’aiguilles. Je regarde, entre les branches, le ciel tourner lentement, et je revois, dans ma mémoire, ce croisement de sentiers, juste avant le plateau des Chambarans, ce rendez-vous aimé depuis l’enfance.
Là-haut, des pins de belle taille faisaient frissonner quelque frontière entre les collines et le désir d’infini.
Aujourd’hui, moi non plus, je ne suis pas seul. La terre, la maison, l’heure qui précède la fin d’un lieu qui fut notre petit royaume écoutent le battement profond du silence. Tout s’apaise dans une couleur libre, sûre des promesses de la transparence, des jours pas si différents alors qu’ils semblent s’effacer, de la complicité de l’herbe, de la pierre, d’une histoire complice et des anciens rivages que l’on croyait privés de source.
***
Rémy Leboissetier
Alice Grey
Alice Grey dormait.
Elle avait croisé dans son sommeil de lourds corbeaux qui passaient dans la neige et, peu à peu, au dehors, des flocons s’allumèrent.
Alice Grey dormait, mais tout son corps, un instant convulsé, se souleva.
Blanc minois tacheté de noir, un chat traversa l’ombre du lit pour venir s’installer, imperceptible, sur le rebord de la fenêtre.
Une fois encore, Alice se tourna violemment, comme pour quitter une vision aveuglante, puis nicha sa tête dans le creux de l’oreiller.
La neige s’amoncelait sur les toits, couvrait l’arête des rochers.
Jusqu’alors impassible, le chat s’aplatit soudain.
Un corbeau venait de s’abattre devant la maison, violant de sa masse hideuse le pur paysage.
Alice était parvenue à l’extrémité du lit ; l’un de ses bras pendait, sa main effleurant le sol, les veines en saillie.
Dans la neige imbibée de son sang, l’oiseau déchu remuait mollement des ailes.
Un bruit sourd se fit à nouveau entendre : Alice avait cette fois basculé. Sous ses cheveux désordonnés se cachait un visage ruisselant. Près d’elle, au pied du lit, une coupelle de lait s’était renversée.
Les flocons, de plus en plus serrés, formaient une belle unité, sans horizon discernable. Seule, à l’endroit où le corbeau était tombé, persistait une rougeur obsédante qui donnait au regard des proportions gigantesques.
Le chat vint lécher le liquide que lui volait la feutrine absorbante.
À cet instant, le corbeau, dans un ultime effort, révéla son horrible mutilation : ses plumes en pagaille masquaient deux grandes cavités sanglantes à l’emplacement des yeux.
Doucement, le chat s’approcha, flairant le corps d’Alice, explorant sa pâle nudité, aux fines marbrures.
Furtive, la neige élut domicile dans la chambre et, comme dans un rêve, le plâtre se morcelait déjà. Peu à peu, les murs s’estompèrent et l’espace fut envahi d’obliques étincelles…
***
Gérard Cukier
Si la femme m’était contée
La jeune femme gravissait les flancs de la montagne avec un entrain qui aurait pu faire plaisir à voir s’il n’y avait pas eu un manque regrettable de témoins.
Elle était d’une beauté à couper le souffle. De longues jambes bien galbées et d’une musculature sensuelle, une immense chevelure d’un noir de jais qui parcourait vivement sa croupe délicieuse en se balançant d’une hanche à l’autre avec une grâce infinie, des yeux bleu-vert d’une profonde suavité qui aurait fendu le cœur de la bête fauve la plus cruelle, une poitrine généreuse qui à chaque secousse cinglait sans pudeur la masse touffue des sapins verts dont les aiguilles rigides frétillaient d’un plaisir indicible à son contact brutal. Tout en elle participait de la candeur magique de son sexe.
Arrivée aux deux tiers de la pente elle fit une pause de courte durée, bien décidée à ne s’offrir un véritable repos qu’à proximité de la cime enneigée.
Sa bouche était à peine rosie par les morsures du froid et l’haleine vaporeuse qui s’en dégageait aurait réjoui les plus exigeants des habitants des fleurs.
Elle reprit son intrépide ascension. Elle savait ne pas avoir entrepris ce voyage périlleux par hasard. Depuis qu’une mystérieuse épidémie avait décimé les hommes par troupeaux entiers, chaque femme se faisait un devoir de débusquer des survivants mâles. Il était donc logique qu’elle cherchât son prince charmant et elle se faisait fort de le dénicher au sommet de cette montagne délaissée.
Un grondement prolongé se fit entendre sur son versant opposé.
Les hommes se cachent, pensa-t-elle. Ils essaient de donner le change. Mais j’ai des arguments convaincants pour leur faire entendre raison. Un seul argument me suffira et je ne cherche qu’un homme, le mien.
Les sapins commençaient à se raréfier et leurs branches rabougries sentaient bien plus le bois gelé que la caractéristique résine.
Elle dut ramper pour parcourir les derniers mètres, accrochée à un chemin imperceptible qui se dérobait sous ses pieds. La roche était dure et glissante, ses chevilles puissantes parvinrent néanmoins à la maintenir en équilibre.
Un dernier effort. Elle posa enfin ses pieds sur un rebord glacé mais suffisamment élargi de la crête. Un bruit sourd se fit entendre. Elle allongea son cou et comme un cou n’arrive jamais seul, une tête d’homme dépassa d’un large torse à moitié recroquevillé sur lui-même. Elle le toisa, non pas des pieds à la tête comme elle aurait pu l’espérer, et n’eut que le temps en s’éclaircissant la voix de prononcer ces quelques mots choisis :
– Jeune homme, en faisant chacun la moitié du chemin…
Un fracas inopiné lui répondit dans un roulement effroyable comme si une gigantesque avalanche se déclenchait.
La tête de l’homme avait disparu, son torse aussi, quant à ses pieds invisibles, elle les entendit racler la terre durcie dans un crissement désespéré pour éviter une chute par trop brutale. Elle ne put s’empêcher de lui crier :
– Dites donc, jeune homme, la politesse n’est pas la plus grande de vos vertus.
Elle n’eut que le temps d’entendre un écho qui se para de tous les attributs de l’énigme :
– Attendez-moi ici, je reviens tout de suite !
Elle voulut lui répondre mais l’écho avait déjà dévalé la pente pour se perdre dans le murmure du vent. Dépitée, elle laissa échapper bien malgré elle cette amère réflexion :
– Il n’y a aucune raison pour que celui-ci revienne. Je vais en attendre un autre. Dommage, il avait l’air beau gosse.
Fatiguée par tant d’efforts répétés, elle s’endormit d’un sommeil paisible et ne fut réveillée qu’au retour du même grondement désagréable.
– Qu’est-ce qu’il se passe encore ?
Quelques minutes passèrent dans une attente anxieuse, une tête d’homme se présenta à nouveau, la même tête irréfléchie qui la salua d’un bonjour distrait pour disparaître aussitôt.
– Jeune homme, comment vous appelle-t-on, si on a le temps de le faire, courant d’air, homme aux semelles de vent, vertige d’un soir ?
Une voix caverneuse et lointaine lui répondit :
– Je m’appelle Si…
Elle crut entendre à nouveau cette même résistance vaine, un frottement strident luttant contre les lois de la pesanteur, accompagné de jurons spasmodiques. Elle haussa les épaules et se rendormit.
A la lueur rougeoyante du soleil levant, une tête s’aventura contre la poitrine endormie et soupira d’aise. Ce soupir profond la réveilla et en reconnaissant la tête elle laissa s’échapper instinctivement cette brève question de ses lèvres transies :
– Simon, vous vous appelez Simon ?
– Si…
– Oui, Simon, c’est ça ?
– Si…
– Si, quoi ?…
– Silence ! Vous ne cessez pas de parler. Je n’ai pas le temps de vous répondre !
La tête avait tenu le temps qu’elle avait pu tenir mais elle avait déjà commencé à glisser et le reste du corps l’entraînait vers le bas. La jeune femme entrevit un gros bloc de roche coincé entre les jambes du jeune homme et cette masse rocheuse malgré son cri de désespoir était en train de reprendre sa liberté.
Assourdie par le vacarme engendré par cette nouvelle descente, elle lui cria en vain des paroles d’encouragement. Elle se promit la prochaine fois d’égayer la conversation de mots plus tendres dès qu’elle l’entendrait remonter (elle ne doutait plus qu’il allait remonter) et, pour ce faire, se posta avec maintes précautions sur un petit monticule d’où elle put embrasser tout le panorama découvert sur l’autre versant.
Le spectacle offert par le jeune homme quand elle le vit réapparaître faillit lui faire perdre son sang-froid :
– Mais lâchez donc ce rocher que vous roulez à bout de bras comme une âme en peine jusqu’au sommet de cette montagne, c’est une condition sine qua non pour ne pas tomber à la renverse à tout bout de champ.
– Ne me parlez pas en latin, je suis grec, ça ne se voit pas ?
– Ne détournez pas la conversation et obéissez !
– Les Dieux m’ont jeté un sort peu enviable, je suis victime d’une véritable malédiction. Ils m’obligent depuis des siècles à monter ce rocher jusqu’au sommet de cette foutue montagne et me font redescendre en décuplant son poids dès que je touche au but.
– Ils ne vous obligent à rien du tout. Vous avez un TOC, c’est clair comme de l’eau de roche ! Cessez de vous regarder le nombril et pensez plutôt à moi. Vous aurez alors résolu votre problème.
– Malheureusement nous autres, les hommes, nous subissons un châtiment divin et, ayant été leur porte-parole dès le début, je suis en première ligne pour expier les fautes de mes congénères.
– Et nous autres, pauvres femmes, nous vous recherchons par tous les moyens et, même quand l’une d’entre nous arrive à enfanter des œuvres de l’un d’entre vous, nous n’engendrons que des filles. Mais qu’avez-vous donc commis de si grave ?
– Si je le savais, je ne serais pas là à me morfondre comme un damné.
– Si vous le désirez, je m’en vais vous rejoindre et je vous aiderai à porter la misère du monde.
– Quelle bonne idée ! Cherchons alors un rocher encore plus lourd.
– Mais non, ce n’était qu’une image. Il n’y a rien à porter.
– Mais alors, aussi bien, je peux vous porter sur mon dos.
– Et puis quoi encore ? Et arrivés au sommet vous allez vous débarrasser de moi et me faire dévaler la pente.
– Mais non, on dévalera ensemble, je ne vous abandonnerai pas.
– Arrêtez de vouloir me rouler dans la farine. Je ne suis pas aussi pauvre d’esprit que vous le pensez.
– Pierre qui roule n’amasse pas mousse !
– C’est bien ma veine. Je suis tombé sur un mythe qui n’a rien de proverbial. En tout cas vous avez de trop beaux yeux. Je propose que nous fassions l’amour tout de suite. Mais la procédure va être insurmontable si vous vous entêtez à garder cette saloperie de roche entre vos jambes. Débarrassez-vous en tout de suite.
– J’ai déjà eu du mal à la maintenir en place et je sens qu’elle va m’échapper. Mais si je la lâche de mon propre chef, je vais être obligé de la suivre.
– Allez, un geste décisif et je saute dans vos bras.
– Aussi vrai que je me nomme Sisyphe, je puis le dire en toute modestie puisque vous avez découvert mon nom, vous n’aurez ma vertu qu’en me proposant le mariage.
– Le mariage ce n’est déjà pas gai en temps normal mais avec vous le risque est grand de me retrouver veuve avant l’âge.
– Seul votre sacrifice donnera au mien ses lettres de noblesse.
Ayant tous les deux le devoir de sauver l’humanité de son inexorable extinction, la jeune femme rejoignit le jeune homme et, lui faisant perdre la tête, elle lui fit perdre tout contrôle sur son rocher et leurs gémissements de plaisir s’entendirent jusque dans la demeure des Dieux.
Les rares touristes qui ne craignent pas de s’aventurer au pied de cette montagne perdue dans les déserts glacés peuvent parfois entendre s’ils prêtent une oreille attentive cette ébauche de conversation :
– On remonte ?
– Pour quoi faire ?
– Pour voir si vous ne m’attendez pas là-haut !
– Mais non, ça ne risque pas d’arriver, je suis déjà dans vos bras !
– Alors faites comme si !
– Comme Sisyphe ? Alors allons-y !
***
Gérard Cukier
La quadrature magique du cercle
…Admettons que je reprenne le récit là où je ne l’avais pas interrompu…ou même ailleurs…
…Un jour de forte turbulence intellectuelle, tentez de prendre un cercle au dépourvu ! Au détour d’une circonvolution, il y en a toujours au moins un qui se promène. Si vous y parvenez, ce qui ne serait pas un mince exploit, examinez-le sous toutes les coutures. Puis, si vous avez toujours le compas dans l’œil, divisez-le pour mieux régner. Pas par n’importe quel empêcheur de tourner en rond. Le dénommé Πtagore serait le plus apte à s’y coller. Il a déjà fait ses preuves tout au long d’une vaste carrière criminelle. Admettons que la division soit couronnée d’un succès fracassant. Peut-être penserez-vous alors en connaître sur votre cercle vaincu un fameux rayon. Détrompez-vous ! Tout cercle capturé dans sa zone d’influence est un cercle magique par définition. Sa capture n’aura servi à rien. Le plus intelligent d’entre vous voudra immédiatement revoir sa copie. Admettons que ce soit vous. Pris d’une inspiration aussi subite que miraculeuse, vous tenterez sans hésitation d’en attraper un du plus loin possible. De le prendre au lasso par exemple. N’en faites surtout rien. Un lasso, même mal lancé, a toujours tendance à se terminer en nœud coulant. Vous aurez deux cercles contre vous. Essayez de leur faire tourner la tête en vous les mettant à dos, vous m’en direz des nouvelles. Quand les ronds-de-cuir sont lâchés il n’y a plus grand-chose à espérer.
Oh ! Je sais, vous allez vous entêter, et plus vous tenterez une improbable capture, moins vous y parviendrez. Et plus vous vous obstinerez à ne pas y parvenir, plus vous parviendrez à maintenir indéfiniment votre obstination.
Pour rompre ce cercle vicieux qui vous conduit tout droit à la folie furieuse, une seule solution s’offre à vous : une immersion corps et âme dans l’univers vertueux des TOC. Il ne faut pas se voiler la face – qu’elle soit ronde, ovale ou triangulaire –, ces Tentatives d’Oubli de Cercles peuvent s’avérer totalement infructueuses. Mais comme dit le proverbe : « Qui ne risque rien n’a rien ».
Admettons que, même en tentant quelque chose, vous n’aboutissiez à aucun oubli digne de ce nom, à bout de forces et en désespoir de cause, vous serez amené à convoquer en toute hâte votre cercle de famille. Bien sûr, sans résultats. Vous n’avez plus qu’un lointain cousin et il n’a jamais été au centre de vos préoccupations. Orphelin d’arguments, l’idée de réunir des conférences de circonférences effleurera sans doute votre esprit pointilleux. N’y pensez même pas en rêves ou bien l’encerclement vous guette !
Enfin, sans crier gare, sans même mener rondement son affaire, l’illumination surgira de votre circulation cérébrale. La consultation psychanalytique, voilà ce qu’il vous faut ! Le déballage d’une vie, allongé sur un canapé délicieux… La voix hypnotique d’un vieux monsieur qui pourchassera vos vieux démons… La révélation d’un secret enfoui jusqu’au tréfonds de votre conscience… Votre mère a été cerclée pendant toute sa grossesse ! Et l’enfant formé dans ses entrailles, vous en l’occurrence, bien à l’abri dans un cordon sanitaire, a résisté de toutes ses petites forces pendant d’interminables heures à l’extraction au forceps de sa racine carrée, vécue comme un véritable châtiment corporel. Votre mère a failli en mourir !
Euréka ! Un lourd fardeau de remords vient de s’arracher de votre poitrine. De joie vous poignardez le psychothérapeute, du moins mentalement. Et vous courez vous réfugier dans un monastère pour mener en boucles une longue vie de prières. Le bonheur dans l’expiation est à ce prix. Votre fervente dévotion fait grand bruit. On accourt de toutes parts pour vous surprendre à prier et à bénir les plus humbles. On vous prend pour un Saint, on se jette à vos pieds, on se recueille avec piété, on vous désigne comme un saint homme perclus d’abnégations. La première fois, ça vous fait tout drôle. « Moi ? Un Saint ! Pourquoi donc ? En ai-je l’air ? » dites-vous avec modestie. « A quoi voyez-vous ça ? » Tous les curieux présents ce jour-là abondent dans le même sens.
« On le voit au halo de lumière qui plane immobile au-dessus de votre tête, tout rond et tout brillant, visible même en plein jour. C’est la première fois qu’on peut admirer un tel phénomène. Un cercle immaculé vous suit où que vous alliez, une aura scintillant de tendresse, un nimbe doré aux contours rayonnants. »
Le bouche à oreilles fera le reste. Un véritable pèlerinage s’amorcera et, dès lors, sa renommée ne sera jamais démentie.
En admettant que tout cela soit vrai, circulez, il n’y a plus rien à voir !
***
Rémy Leboissetier
L’Encrevé
J’étais au jardin public, allongé sur un banc à l’écart, pour observer la floraison imminente des cistes cotonneux lorsque mon regard surprit sa Suffisance, Mademoiselle Taupe, pointant son museau d’un cratère fraîchement formé. L’an passé, j’avais appris d’elle quelques rudiments de terrassement, le b-a ba du royaume souterrain, mais tant en surface qu’en profondeur, elle m’avait fait comprendre la nature de ma relégation et l’étroitesse de mon jugement : ouvrir bien plus de voies que ne l’énoncent les préceptes philosophiques ; faire hardiment confiance à l’instinct de survie et au don d’organisation des mammifères rongeurs, ces grands maîtres de l’enfouissement. Imaginez-vous dès lors l’étendue de ma peine et mon besoin de consolation, face à de telles carences.
De sa patte griffue, Mademoiselle Taupe me fit signe tandis que ma mémoire accrochait encore quelques souvenirs terrestres ridiculement encombrants. J’avais obtenu d’elle qu’elle se fît plus discrète, n’en pouvant plus d’amuser la galerie, car je savais combien ma pâleur anormale et mes ongles embrunis pouvaient être dérangeants pour les gens de l’Au-Dessus. J’avais pour une bonne part réappris à vivre à l’air libre et recouvré la vue, et selon mes amis les plus proches et plus lointains parias, je ne m’en tirais pas si mal, quoique les enfants comme les chiens s’accommodassent mal de ma présence, secrètement rebutante.
Comme à chaque date anniversaire, en conjonction d’une phase de crise printanière, de fortes odeurs d’humus assaillaient mes narines. Je sentais la sève me grimper dans les jambes… J’étais pris d’une fièvre séminale qui me faisait dire des mots dépourvus de sens, effectuer des gestes d’infamie, ponctuées de vulgaires grognements. Flairer, fouir, fouiller, fouailler… Ah, comment résister à pareil envoûtement ?
Odeurs de recuit, de revécu, de révoqué… De pied en cap, je sentais l’encrevé. Car j’étais mort une fois, et la mort ne me voulait plus. N’ayant souvenir que de suc, radicelles et racines, je dévorais germes et bulbes, plongeais ma tête ivoirine dans le cœur des laitues. Pour me distraire de ma mélancolie, dressée sur son monticule, Mademoiselle Taupe sifflotait un air d’opera buffa. Son flair formidable l’avait rapidement instruite de ma présence et conduite à mes pieds ; de là, pas à pas, elle avait entrepris l’ascension de la jambe de mon pantalon. J’eusse aimé l’accueillir avec le maximum de dilection, la presser dans mes bras, mais aucun encrevé, que je sache, n’a jamais été à même de retrouver l’aisance naturelle exigée par ce genre d’accolade.
J’avais encore trop le souvenir de mon ancienne contention et rigidité cadavérique et, à l’évidence, beaucoup de signes extérieurs trahissaient mon rattachement à l’En-Dessous. Dans ces moments-là, affligé de parasitose, je me tordais dans la lumière comme un ver effrayé par sa propre nudité. Car j’étais mort une fois, et la mort ne me voulait plus. Souhaitant disparaître, je ne faisais que m’absenter. « À l’aveuglette ! répétait sa Suffisance, à l’aveuglette ! » Jusque dans les plus lointains passages et savantes bifurcations, elle avait su me guider, détruisant pour finir le souvenir de la raison et la raison même de ce souvenir. Loin, bien loin des humeurs peccantes de l’Au-dessus, j’appartenais corps et biens au souverain monde souterrain. N’éprouvant aucune pitié, les enfants crachaient sur moi, les chiens s’attaquaient à mes chevilles, déchiquetant le bas de mes pantalons. Je n’éprouvais aucune colère : j’étais heureux enfin, rendu idiot, tel un puceau découvrant son corps d’endive, transfiguré par l’érection inaugurale de son sexe ponceau.
Flairer, gratter, creuser… Plus rien ne pouvait s’opposer à ce besoin d’enfouissement : frappé de malédiction, exhumé de la fosse, je devais procéder à ma réintégration, rejoindre d’instinct le terrain intra-utérin. Au moment même où ce désir avait mûri, Mademoiselle Taupe me désigna l’emplacement d’un ancien terrier, dont j’élargis l’entrée. J’en dégageai la terre, ferme d’abord, puis de plus en plus malléable et, le soir venu, une assemblée de mammifères insectivores fêtait mon départ pour une nouvelle mort.
Allait-elle enfin me vouloir ?
Ce vieux fou de Kaetz & autres phénomènes, inédit
***
Jean-Jacques Brouard
Le passant
Le hors-venu avait surgi un matin d’hiver dans un village du bas-pays. Il semblait chercher quelque chose. Il n’était pas passé inaperçu. On crut qu’il était de passage, mais les jours se suivirent et il resta. On ne pouvait pas l’éviter. Il était sur tous les sentiers et dans tous les refuges. Quand on l’avait vu une fois, on ne pouvait pas l’oublier. Il avait un air étrange. Son silence était singulier, son dire enivrant. Tous l’écoutaient sans broncher, l’œil fixe, la bouche ouverte. Ce qu’il disait enflammait l’esprit et figeait les sangs. Il forçait l’admiration et instillait l’angoisse. Après son passage, on s’affrontait verbalement : c’étaient des joutes interminables qui ne menaient à rien.Et nul ne savait pourquoi il était venu. Il ne faisait pas grand-chose dans ces bois perdus. Il errait sans autre intention que de s’enivrer des chants d’oiseaux. Il allait auprès des souches pour les embraser. Il s’y réchauffait le corps. Puis, pour cuire son gibier, il brassait ces brûlis dont la fumée âcre rendait la brume épaisse. Le soir venu, il entrait dans les hameaux et parlait aux gens pendant des heures. Après sa venue, on s’oubliait en parleries et en disputes. Les semaines passèrent.Puis ce fut l’incendie. Pas à cause de lui, non. A cause d’escarbilles de fagots de saule que des bûcherons de la plaine avaient imprudemment jetés dans les flammes. Le feu ravagea d’abord les landes du haut, puis embrasa la forêt d’Ajoubes à la lisière de laquelle se trouvait le bourg de Sarche. Rien ne put barrer la route aux flammes. La réserve de la Banque Régionale, les réservoirs de la compagnie pétrolière et les soutes à munitions de l’armée, tout finit par exploser. Projetée au-dessus du gros village en ruines, une poussière d’or se répandit dans les halliers, dans les bosquets et se déposa sur tous les arbres qui étincelèrent bientôt sous le soleil ambré… A dire vrai, il n’avait jamais envisagé de s’établir dans cette région de forêts. D’emblée, il avait senti que le pays n’était pas sûr. Des étrangers venus avant lui s’étaient infiltrés dans le terroir. Ils vivaient de rapine, de braconnage et de trafic. Assez rusés pour échapper aux agents forestiers, ils débroussaillaient les friches et faisaient semblant de cultiver la terre. Vivant dans des cabanes de fortune, ils refusaient de partir. Les autorités locales les soupçonnaient bien d’infractions, de déprédations et de saccages, mais, faute de preuve, elles ne faisaient rien, elles n’osaient pas s’aventurer dans les campements. Pourtant, de temps à autre, pour apaiser les gens du pays et conjurer leur colère, on capturait un pauvre hère qui s’était approché trop près du village et on le brûlait sans délai sur un bûcher dressé devant la Maison Centrale. C’est ainsi que les gardes régionaux s’efforçaient de maintenir la paix en ces contrées sauvages. Malgré leur souci d’appliquer les directives du pouvoir, ils avaient un doute sur la probité du commandeur qui, dans la région, faisait appliquer les lois : il spéculait sur les matières premières, détournait les fonds public et caviardait les articles de loi. Ce magistrat corrompu avait d’ailleurs envoyé les intellectuels au fin fond de la sylve, une dizaine d’individus éparpillés sur des centaines de kilomètres carrés, s’occuper de réguler la population d’oiseaux. Membres désignés d’une prétendue « brigade de protection ornithologique », ils étaient relégués dans le secteur le plus hostile et le plus accidenté de la région. Heureusement, ils bénéficiaient de la protection bienveillante des Sylvestranes, ces femmes des bois soumises à une prêtresse de la forêt que tous craignaient et qu’on appelait la maîtresse de la pluie. De temps à autre, on la voyait debout au sommet d’une colline crier dans sa corne de voix : « Il faut protéger les arbres. ». Les villageois avaient beau hausser les épaules dès qu’on parlait d’elle, nul n’osait plus aller couper les arbres de la forêt de Veltebrugue.C’étaient de vastes bois qui tapissaient les vallées sinueuses du massif. On n’y trouvait jamais personne. Et pour cause. Les Sylvestranes étaient irascibles et supportaient mal la présence d’étrangers sur leurs terres sacrées. Les vagabonds frontaliers qui venaient parfois chercher des chutes d’écorce rare en savaient quelque chose. Malheur à celui qu’atteignait une de leurs flèches empoisonnées !Jusqu’alors, le hors-venu avait supporté les intrusions des trafiquants, les embuscades des nomades et l’irrédentisme des Sylvestranes, mais désormais, étant donné la disparition du village et la dévastation des environs, il prit sa décision : ne plus rien dire à personne, partir, aller plus loin. Il passa donc les crêtes et entra, silencieux, dans le pays d’A-haut.Dans cet autre ailleurs coupé du reste, on faisait comme on avait toujours fait. La nuit, sur les grands plateaux sans arbres, au milieu des champs immenses, les gardes des greniers communs passaient leurs nuits à contempler la lune, tout en surveillant les récoltes et en contrôlant le passage des dérivants sur les terres collectives, c’était la loi. On craignait les réseaux clandestins de subversion. On parlait de malfrats sans scrupules qui projetaient de dérober tous les stocks de grains pour les revendre sur la côte Est à des équipages d’Outrocéan. La commanderie n’accordait guère de crédit à ces rumeurs subreptices qui hantaient les esprits rustiques, mais il fut décidé de renforcer la garde en recrutant des miliciens. L’étranger s’engagea. Le travail, bien payé, n’était pas sans danger : la nuit, des attaques eurent lieu, surtout par les nuits sans lune. Plusieurs gardes et miliciens disparurent, comme happés par des choses indicibles qui gargouillaient dans le noir et disparaissaient dans les grottes.C’en était trop pour lui. Il n’était pas d’ici et il ne voulait pas risquer sa vie pour les autres. Il s’esquiva un matin de brouillard et alla s’embarquer sur un navire pour des îles où il finirait peut-être par trouver qui il était vraiment. On ne le revit jamais, mais son souvenir persista, on imagina ce qu’il était devenu et le récit devint légende. Le temps passa. Bien plus tard, on se mit à douter. Avait-il, cet étranger, vraiment existé ? Ou bien n’était-il qu’un autre nous-mêmes ?
Jean-Jacques Brouard – Visions dans les parcs et autre récits fantasques (2023)
***
Jean-Claude Goiri
Bouffons froids bouffés frits.
Six chiens chauds, chics et secs, cherchant saucisse chiffe, tombèrent sur chiche chienne chiffrant six chiots si chiants que les six chics virent leurs langues sans chichi sécher.
Ne sachant si dire quelle chierie c’était, les six teckels toqués chassant femelle fumante s’engagèrent en galère en galants muets.
Déçus par une mère si lasse et lâche laissant six chiots si sots tout faire sans laisse, hélas, pas déchus d’être mâles, de la bonne pâte ils prirent en mains les nains.
Quand, aiguillant les petits Sieurs dans les champs un par un, purs-sangs pourtant, la peur les prit…
…car les cabots cabotins, bien que plus glands que grands, ouvrirent une gueule cent pour cent pur leurre ; leurs dents dehors, bavant sang d’encre, sans brailler, bravant les chauds secs, calmement ils clamèrent :
« – virez vos gueules, méchants chauds chiens ! Notre dernier amuse-gueule était plus grand et plus fol que vous ! Nous fritons les bouffons et les bouffons tout frits ! Mais tellement qu’on les aime, on se fait peur nous-même ! Gare à nous bienvenus ! Fin vous guette car… comme maman le dit : si époux n’est pas papa, il est bon bonbon ! »
Il eût fallu brandir phallus, mais…
…portant la croix du croire, le froid les frit.
Le sang glacé, à brûle-pourpoint les grands fols s’enterrent sans dire un demi-mot qu’on sente.
C’est ainsi que
Six galants gisent à la chaîne,
Sans foies ni lettres,
Six queues éteintes.
Et, puisqu’il faut que tout con-
-te trimballe sa morale à la con-
-clusion, celui-ci charrie la sienne :
Sot chiche n’est pas chiffe molle.
***
Jean-Jacques Brouard
Dans les hauts de l’île
Il avait revu en rêve ce rivage poudreux d’écume et de lumière de sa jeunesse. La mer y battait son plein à coups de houle rauque et de vent fou. Sur les falaises grumeleuses d’humus, coiffées de fougères noires et d’ajoncs constellés d’étoiles, frémissaient dans le souffle du grand large les grands pins efflanqués. Sur les crêtes de l’intérieur, parallèles à la côte, les châteaux s’élevaient au-dessus des grands bosquets de sapins touffus émergeant d’une mer de brume rosâtre qui coulait des sommets comme la liqueur de l’aube.
Un matin, il avait quitté l’atmosphère saumâtre de la côte méridionale et l’air vivifiant de la petite cordillère littorale pour aller rendre visite à des amis retirés dans la haute montagne du centre de l’île. Ils habitaient une vieille bâtisse à la sortie d’un hameau désert accroché au flanc d’un massif de granit vert surplombant un petit lac aux eaux sombres et profondes dont les pics étaient couverts de neige bleue. Dans cette contrée sauvage entièrement soumise aux caprices des cimes, le vent pourtant était encore chargé d’effluves de sel et d’iode en provenance des grands océans. Parfois même une volée de mouettes s’abattait sur les pâturages après avoir déchiré le vaste silence du ciel de leurs piailleries criardes.
On but de l’alcool de miel à l’abri du vieux mur ancestral de la fratrie où les urnes reposaient dans des niches, au bord du précipice. La saveur du breuvage était fraîche et brute ; son aspect laiteux semblait provenir de la base des nuages blanchâtres qui effleuraient les sommets les plus proches. Comme le veut la coutume, chacun cracha dans le vide après avoir fait l’éloge d’un des convives. L’âcre fumet d’un rôti de mouflard qui émanait des cuisines toutes proches venait caresser les papilles gustatives. Les quelques racines séchées de courteflume données à ronger à l’apéritif lui avaient donné faim. Le miellon poivré l’avait enivré : il commençait à voir des choses… C’était à cause de l’altitude aussi peut-être. Les propos des hôtes concernaient le sens de l’existence et le choix de l’isolement dans « les bois du haut » comme disait l’ancien du clan. Il se taisait, écoutant avec toute l’attention dont il était capable le dire des attablés.
Cependant, peu à peu la vallée d’en bas s’était couverte d’une sorte de nuée un peu grise. Au-dessus du massif, le ciel était devenu d’un noir de sépia conféré par une masse effrayante de grosses nébulosités arborescentes. L’air était immobile, un peu lourd, malgré le froid perçant. Soudain, un énorme craquement secoua tout le paysage : le feu du ciel venait de plonger dans le fond du lac. Ses eaux s’illuminèrent une fraction d’instant, puis le vent s’engouffra dans le défilé des Princesses et, en une minute, la bourrasque déferla dans la passe, dans la vallée, rabotant les pentes, fouettant les bois. On se hâta de rentrer dans la grande salle et l’aïeul referma la porte selon le rituel accoutumé afin d’écarter les génies malfaisants de l’ouragan. Bientôt des rafales de neige obscurcirent le jour. Les flocons étaient incroyablement volumineux et il ne fallut pas longtemps pour que le sol du promontoire soit recouvert d’une épaisse couche blanche. Mais la violence du vent redoubla et la neige qui tombait s’amenuisa. Le blizzard charriait maintenant comme une fine poussière tranchante qui hachait la matière molle des arbres de la forêt. Dans le hurlement strident de la tempête, on entendait des craquements sinistres de végétaux en souffrance. Le tout était ponctué toutes les trois minutes environ par l’éclat formidable de l’enfer du ciel qui déchaînait sur la terre son déluge de feu blanc et ses grondements de dragon en furie.
L’ancien se pencha vers lui, l’œil sombre, et lui tapota l’épaule avec chaleur.
« Sois le bienvenu chez nous, mon ami. A la tournure que prend la chose, il y en a bien pour une semaine : pas question de redescendre avant. La montagne semble vouloir faire ta connaissance. Garde-toi de la défier ou de la séduire, elle te garderait pour de bon. Mes filles vont te préparer une chambre et l’une d’elles, que le sort désignera, dormira à tes côtés pour la chaleur du cœur et de l’esprit. Achiabana, belle épouse, sers-nous la chnouille tant qu’elle est chaude, si tu le veux bien, mon égale. Moi je te verse l’élixir d’amour, ainsi qu’à tous nos gens et à notre hôte.»
Et le vieux sage s’empara du lourd matras où bouillonnait un liquide viride aux reflets écarlates et remplit les verres…
Dehors, les mugissements des troupeaux glacés de l’atlas insulaire venaient frapper les murs épais de l’ancestrale demeure. Le visiteur remonta le col de sa pelisse de laine et s’assura d’un bref regard que le feu brûlait bien fort dans l’âtre. Tous trempèrent leurs lèvres dans le breuvage sacré de la tribu. Et le grand silence qui noya la maison rendit la symphonie des montagnes du ciel plus barbare encore…
Une femme se leva et elle se mit à chanter le Verbe obscur.
Alors, il s’abandonna à l’ivresse des poèmes, à la magie du feu et aux sortilèges de la nuit.
***
Rémy Leboissetier
Ce vieux fou de Kaetz
L’autocar s’arrêta au maximum de ses freins, gravant sur l’asphalte l’empreinte de ses pneus. Hébété, je m’approchai du véhicule et humai les multiples senteurs de son voyage. Au volant, je reconnus aussitôt ce vieux fou de Kaetz, à la rousseur de sa chevelure, hirsute, à son front, ses joues, criblées d’éphélides. Il arborait un curieux sourire en coin qui avait pour effet de lui contorsionner la moitié du visage ; cette asymétrie lui donnait un air équivoque, à la fois clownesque et faussement engageant. Enfin, il appuya sur le bouton de commande : les portes se déplièrent, m’aspirèrent, puis se replièrent en soupirant.
Comme je montais, un groupe de gens, fêtant je ne sais quoi a priori, m’enveloppa aussitôt et me dispensa dans l’hilarité générale de vives accolades. L’une de ces personnes – que je ne connaissais ni d’Ève ni d’Adam – me tendit une chope remplie à ras bord d’un liquide incolore (de l’eau ?). De part et d’autre, les vêtements bigarrés des voyageurs formaient une fresque mouvante tandis qu’une étrange rumeur s’élevait, tel un chant funèbre, une sorte de gospel flottant… Des bribes de musique éclataient en même temps aux quatre coins, l’instant d’un rire ou d’un sanglot (non, ce n’était pas de l’eau).
Soudain, ce vieux fou de Kaetz se mit à déclamer :
— Je prends à témoin cette lueur matinale qui s’élève à l’est et qui nous offre une fois de plus sa lumière mirobolante ! Un jour comme celui-ci, hier comme demain, identique à tant d’autres, ne prétend pas briser les maillons de nos chaînes ! Pourtant, mes amis, voici l’heure du départ ! Voici l’heure insoupçonnée, qui retentit, en marge du temps !
Et, en manière de conclusion, il pressa de toutes ses forces l’avertisseur sur son volant. Je crus qu’une bande de pigeons effarouchés venait au même instant de souffler l’habitacle, avant de comprendre qu’il s’agissait d’une salve d’applaudissements. Après ces effusions, les passagers – combien pouvaient-ils être ? – entonnèrent à nouveau leur sombre mélopée. Subitement, quelqu’un piétina sa montre avec rage ; suivit un cri : de l’objet éventré s’écoulait comme du sang, avec ceci de particulier qu’une odeur se propageait, nauséabonde.
L’atmosphère du car devenait suffocante. Pour je ne sais quel motif, l’ensemble des vitres avait été recouvert de peinture ; j’entrepris alors de chercher une issue lorsque je sentis qu’on me tirait en arrière. Me retournant, j’aperçus un vieil homme en bleu de travail, au teint gris et lilas, filamenteux, qui répétait inlassablement : « Vois-tu mes mains et mes veines incandescentes ? Vois-tu mes mains ?…. Il parut ensuite s’assoupir, sans cesser d’actionner ses lèvres.
Autour de lui, les gens continuaient à se tortiller comme s’ils étaient en transe, et les couleurs de leurs étoffes, merveilleuses, virevoltaient devant mes yeux. A ces couleurs, une à une, j’esquissai un rêve, mais mon rêve avorta : une odeur d’huile distança mes pensées et mon cœur prit l’aspect d’un immense moteur éclaté.
L’autocar venait de démarrer.
***
Jean-Jacques Brouard
Dédale et Icare
Imaginons que le mythe d’Icare soit un faux, que le jeune homme ait écouté son père, qu’il ait renoncé à s’élever dans les airs et qu’il ait vécu longtemps, assez longtemps pour être au chevet de Dédale quand celui-ci mourut…
Dédale, méconnaissable, gît sur son grand lit défait, le souffle court, les yeux hagards. Il regarde son fils Icare qui revient de la chasse : il est en sueur et sent le gibier mort. Dédale fait un signe de la main et souffle :
– Bientôt, je serai sous la terre et toi, tu marcheras dans le soleil, alors approche mon fils et écoute ce que j’ai à te dire… D’où qu’on le regarde, le monde est un immense labyrinthe en quatre dimensions. L’homme y passe à travers un enchevêtrement de sentiers tortueux, de ruelles et d’impasses entrecoupés d’autres chemins, de venelles, d’avenues et de routes qui partent dans mille directions obscures et improbables.
Parfois, on croit voir en une tour imposante un repère dans le réseau confus des voies entrelacées, mais l’architecte diabolique nous fait alors entrer dans le labyrinthe le plus complexe et le plus effrayant : la bibliothèque. Réification de l’esprit humain, la bibliothèque nous emporte vers l’au-delà du visible, l’au-delà du pensable.
Avec tous les hommes morts et vivants, ces allées nouées et déroulées dans les brumes de l’inconscient s’en vont vers l’intérieur de notre nature, là où tout est culture. Et nous avançons toujours en quête de la clé du sens, toujours tentés par l’école buissonnière hors des champs sémantiques…
Çà et là, nous croyons voir des fragments de lignes droites, des rudiments de structure, des semblants d’ordre … Illusions d’harmonie ! Simulacres de sphères éternelles ! Faux-semblants de vérité ! Mais nous retombons dans la réalité du songe inextricable…
La science, moderne ou ancienne, nous offre des concepts-clés pour ouvrir des portes qui donnent sur des murs…
Nous en sommes réduits à envoyer vers les autres de l’ailleurs et du temps des messages désespérés : missives, cris, pigeons voyageurs, parchemins griffonnés, signes sur des pierres lancées, poèmes, messages codés, bouteilles à la mer…
Tous ces amas de signes complexes qui filent dans l’espace-temps comme des flèches invisibles loin de nos âmes… et nous saignons de notre flux au lieu de le conserver et de le délivrer par crachats métaphysiques !
Mais nous n’avons encore rien dit des chausse-trappes et des pièges infâmes que nous tendent les barbares incultes…
Car le monde est une cité de pierre, de fer et de mythes où le mensonge et la dissimulation comptent autant que la vérité qui, d’ailleurs, – comme le dit le philosophe – n’existe pas… Le labyrinthe cache la forêt où se trouve l’arbre de la connaissance…. Les chemins qui relient les concepts ne sont pas tous de même nature : ils se superposent, se côtoient, divergent et convergent, s’annulent, se complètent… La clé, c’est le sens… Le sens est un parti pris… Mais ne pas prendre parti, c’est justement mourir perdu dans le grand désert de la confusion… Le pouvoir, en empêchant les gens de choisir, d’exercer leur volonté en toute connaissance d’eux-mêmes, les condamne à mourir idiots, au sens strict du terme. Les potentats de la canalisation, les détenteurs du savoir, les «brouilleurs» nous font croire que ce sont des réseaux de communication, mais ce ne sont que des canaux d’influence, des conduits où passe le jet puissant des poisons inducteurs… Hiérarchies, arbres, relations entre les hommes, multiplications à l’infini de choix binaires régentés par la codification sacrée… N’existe-t-il pas la possibilité de choix ternaires, quaternaires, de choix infinis, de choisir le néant ?
Dédale regarde ses doigts, regrette soudain ses ailes perdues et reste enfermé dans son énigme… Il se voit dans le miroir du plafond : il est fasciné par son propre reflet… Puis, il pressent le monstre tapi dans le fond des eaux noires qui va jaillir et l’engloutir tout entier… Il poursuit son explication :
– On peut aussi considérer que l’homme est un être qui reste enfermé dans le dédale des interdits qui le composent ou le décomposent : le déchirement… Le labyrinthe, sache-le, mon fils, est une des plus vieilles représentations de la pensée humaine. Le sphinx que terrassa l’esprit d’Œdipe et le dragon dont Merlin tenta d’apprivoiser ne serait-ce que le souffle font partie de ce labyrinthe aberrant. Concrètement, les labyrinthes sont légion : gravés, peints, construits avec des arbres ou avec des pierres… Il y a les labyrinthes naturels que le poète a recensés : la forêt, la mer, le désert, la nuit, la brume, le cosmos, le pelage des tigres. L’homme reste partagé entre deux désirs : celui de sortir du labyrinthe ou de trouver son centre. Deux questions se posent alors : la première est de savoir si le labyrinthe a un centre ; la seconde de savoir s’il existe quelque chose en dehors du labyrinthe. Mais d’autres questions surgissent : si centre il y a, qu’y trouve-t-on ? Et est-ce possible de sortir du labyrinthe ? L’eau qui coule, s’immisce et s’épanche, s’évapore et tombe en pluie… le labyrinthe suprême !…
Il s’arrête, hors d’haleine. Puis, il reprend de sa voix faible et rauque :
Il faut que je te dise… oui, il le faut…Le Minotaure,… c’est l’homme : un poète en parlera dans un récit qu’il intitulera La Demeure d’Astérion, mais il n’en tirera pas toutes les conséquences… Laisse-moi te dire un secret : Thésée, Ariane et le Minotaure ne sont qu’une seule et même personne, la… trinité païenne… La force… le mal et…l’intelligence… Dès lors, tout nous incline à penser que c’est l’homme qui construit autour de lui, pour lui et par lui le labyrinthe qui l’affame et l’asservit, le nourrit et le libère, le défie et l’obsède. Le labyrinthe, comme parcours, porte et clé, c’est… lui-même…
Soudain, Dédale pousse un cri et tend la main à son fils. Quand Icare la prend, elle est si froide et si lourde qu’il sait que la mort est déjà là. Il comprend alors qu’il est condamné lui aussi à rester sur la terre. Et il regrette l’instant où là-haut il avait senti sur son front l’ardente caresse du soleil.
***
Rémy Leboissetier
Vacances en Aciérie
Il pénétra dans la salle d’attente : elle était en forme d’écrou.
Au moment de s’asseoir, il ne put se retenir et vomit pour la seconde fois : un jet de limaille tomba, piquetant le sol de minuscules ébarbures. Pour dissiper le goût âcre de la poudre, il suça une pastille de lactose. Une femme de service au corps transparent apparut, constellée de diodes clignotantes. Elle s’avança vers lui, d’un air impassible puis, laissant tout deviner de ses connexions, s’inclina, actionnant une sorte de balai électro-magnétique. Sa mission terminée, elle fit rapidement demi-tour et voyant ses fesses de résine superbement moulées, il eut la brève sensation de se déplier, tel un couteau suisse.
Sous la porte, il aperçut du sable, et ce sable remuait. Un climatiseur diffusait des caresses alizéennes, parfum vanille. Au plafond, un petit appareil optique tournait doucement et projetait des images kaléidoscopiques au centre de l’hexagone. Quatre baies, situées à l’opposite l’une de l’autre, permettaient de découvrir les Aciéries. On était en plein mois d’août et les estivants affluaient par grappes, allaient chercher leur attirail et réapparaissaient vêtus de bleus de travail, tenant à la main une lourde caisse à outils de métal gris. Le minerai se faisait rare, les fourneaux étaient suralimentés. L’âge d’or, l’ère du verre et le grand rêve d’acier, tout cela était pourtant bien dépassé.
En ce temps-là – je parle d’une époque révolue -, il portait une large ceinture de cuir autour de laquelle brillaient chaînes, crochets, anneaux, pinces, ciseaux et gouges… Il était maître-comptable de sa quincaillerie, appointait et affilait chaque matin sa batterie d’outils. Une fois, il avait planté un tournevis dans le dos d’un des hommes de la colonie. Non content de ce crime, en un tournemain, il l’avait démonté, pièce à pièce. C’était un type aux pieds rouillés, un taulier. Il passa ensuite un an en maison de Corrosion, ses rêves étaient brisés, et il échoua commis chez un sinistre ferblantier.
Un rai de lumière bleutée émergea du trou de la serrure. On avait dû allumer les postes à souder. Il commença à ôter son bronze avec d’infinies précautions. Ses membres grinçaient de façon atroce et il aurait donné n’importe quoi pour une goutte d’huile. A peine pouvait-il bouger les yeux, tant ses orbites étaient grippées. Le moindre effort provoquait des étincelles dans chacune des ses articulations : ce n’était plus qu’un vieux pantin, qui finissait par encombrer…
Il n’était plus seul à présent. Celui qui venait d’entrer, tête rejetée en arrière, avait un foret planté dans la nuque. Heureusement, il portait une minerve en acier galvanisé. Un peu de mâchefer, lichen grisâtre, s’était néanmoins déposé aux commissures de ses lèvres. C’était un grand gaillard avec une tête d’airain, qui portait un uniforme simple et moderne en molybdène. Malgré son handicap, le nouveau venu entama la discussion :
— Dans quelques jours, je repars en mission. Ces vacances sont agréables, mais épuisantes. Et vous ? demanda-t-il, essayant mine de rien de s’aimanter.
Derrière la porte, on entendait les chalumeaux, sifflant-soufflant.
— Moi ? Terminé, ou presque.
— Où comptez-vous aller, si ce n’est indiscret ? reprit l’étranger, d’une voix excessivement métallique.
— Bah… En Sidérurgie, peut-être. Il y a longtemps que j’en ai
envie. Ma femme aussi…
A cet instant, il fut appelé et entra dans le cabinet surchauffé.

***
Gérard Cukier
La vérité des masques
L’autre matin alors que je me promenais aux confins de la zone de confinement, j’aperçus un quidam qui s’avançait vers moi d’un pas décidé. Je reculai par prudence d’un bon mètre mais il était déjà arrivé à ma hauteur, portant un masque qui à ma grande surprise ressemblait à s’y méprendre à un visage humain. Décidé à comprendre le fin mot de l’histoire et persuadé que son masque imitait à la perfection son propre visage, je me précipitai avec fougue sur l’individu masqué pour lui arracher ce déguisement grossier. L’homme, car c’était un homme, poussa un cri de douleur et de colère. J’avais décollé la moitié de son visage et d’épais lambeaux de chairs ensanglantées pendaient lamentablement de mes mains tremblantes. L’écorché vif tenta de prononcer quelques mots mais il bégayait tellement, une partie de sa bouche ayant été emportée, que je ne pus rien comprendre. Reprenant mon assurance je lui fis comprendre qu’il ne fallait pas porter avec désinvolture un visage qui ressemblait tant à un masque confectionné avec sa propre chair. Ce comportement par les temps qui couraient était irresponsable et d’autres que moi moins avertis auraient pu lui occasionner des blessures bien plus graves. Il me dévisagea avec perplexité si on peut encore employer cette expression au sujet de quelqu’un qui vient de perdre, sorti de son orbite, un œil tout frais scrutant désormais avec prudence l’humeur trempée d’une de mes mains comme une perle méfiante dans son huître entr’ouverte. Son air de reproche ne me découragea pas pourtant de postillonner dans son œil valide quelques recommandations tout aussi valides : On ne sort pas de chez soi sans porter un masque qui ressemble à un masque et le plus simple dans le cas contraire est de griffonner sur son front ces quelques mots bien sentis : JE PORTE UN MASQUE.
A bon entendeur, salut !
Métamorphose
J’avais changé d’apparence et personne d’autre que moi ne le savait, Et pour cause. J’étais partout à la fois, donc nulle part. Qu’il me soit permis de ne pas divulguer ce à quoi je ressemblais. En tout cas pour l’instant. Tout avait commencé par une sensation bizarre qui m’était étrangère et cela m’avait mis la puce à l’oreille. Je me suis regardé dans une glace et je n’ai rien vu. Ce rien c’était moi, j’étais devenu invisible. J’en ai pris mon parti, après tout j’avais vu le feuilleton américain « l’homme invisible ». Il suffisait de faire comme lui, de m’entourer de bandages et je saurais où je suis. Il m’est venu une meilleure idée. Je n’avais qu’à m’envelopper dans un drap. Un fantôme est nettement plus sympathique qu’une momie. Malheureusement quand j’ai voulu m’affubler du drap celui-ci est tombé par terre. Je me suis dis : quel maladroit tu fais ! J’ai remis le drap sur moi.
Même manège de la part du drap, il s’est tout de suite retrouvé sur le plancher. J’ai commencé à paniquer. Je n’étais même pas capable de soutenir un vulgaire drap. Et puis j’ai réfléchi. Car il y avait matière à réfléchir. Si le drap tombe par terre c’est qu’il n’y a rien pour le retenir. Je n’avais donc plus de consistance. La matière que je possédais depuis ma plus tendre enfance avait disparu. J’ai voulu me toucher, je n’ai rien senti. J’ai voulu saisir de moi ce qui passait à ma portée. Il n’y avait rien à saisir. Je me suis dit, me voilà bien. Je ne vois rien de moi car je n’existe plus. Restait-il de moi quelque chose de concret ? J’avais quelque chose de moi, c’était ma conscience. Je pensais ! « Cogito ergo sum » avait dit Descartes. Je pense donc je suis ! Cela m’a rassuré. Je n’étais pas totalement absent même si je ne pouvais plus me sentir. Y avait-il encore en moi quelque chose de palpable ? Une idée m’est venue à l’esprit. Je vais essayer de parler à voix haute, mieux encore, de chanter. Si j’arrive à faire sortir des sons, cela veut dire que j’ai des cordes vocales. J’ai retenu mon souffle et j’ai envoyé les chevaux sonores. Et là, miracle ! Un chant mélodieux sortait de ma bouche. Le miracle était double. D’abord parce que des sons sortaient de mon gosier et ensuite parce que je chantais à la perfection alors que je n’avais jamais su chanter. Le larynx était donc intact. J’ai voulu enfoncer deux doigts dans ma bouche mais je ne savais pas où les trouver. J’étais à deux doigts d’y renoncer quand je me suis dit qu’il serait plus simple de faire parvenir les sons contre mes dents serrés, bouche fermée, pour les faire ricocher sur mon larynx. J’ai senti une violente douleur au fond de la gorge et je me suis empressé d’ouvrir ma bouche pour faire cesser mon supplice. Je me suis appuyé contre un mur pour reprendre haleine et à ma grande surprise j’ai eu l’impression de m’enfoncer dans sa paroi. J’ai voulu me dégager mais malgré mes efforts je restai encastré comme un vulgaire gibier pris au piège. En désespoir de cause je me suis mis à hurler et à proférer des insultes si bruyantes que le mur à n’en pas douter n’en crut pas ses oreilles. Le mur me relâcha, abasourdi par mes vocalises et moi je pus me vanter d’avoir franchi le mur du son. Il ne fallait pas s’endormir sur ses lauriers. Le problème restait entier. Je ne pouvais pas rester délesté de mon corps. Je devais coûte que coûte renouer les fils avec lui. Mais comment m’y prendre ? Les murs ne m’étaient d’aucun secours. Peut-être étais-je devenu un fluide qu’il fallait solidifier. Je résolus d’entrer dans le congélateur. La porte s’ouvrit facilement à mon approche comme si j’avais une télécommande. Cela me parut de bon augure. Devais-je maintenant sauter à pieds joints dans un compartiment de volume somme toute assez restreint au risque de me faire un tour de rein ?
Le mieux était de faire semblant de rien, de dégager quelques sacs congelés et de prendre leur place. Plus facile à dire qu’à faire ! Je fus saisi par le froid et résistai stoïquement à la morsure cinglante jusqu’à ce que n’en pouvant plus je sortis précipitamment de l’igloo, mécontent de ne pas m’être transformé en bonhomme de neige.
En me réveillant je me posai cette seule question : avais-je rêvé toute cette fantasmagorie ? J’entendis des voix au-dessus de ma tête. L’une d’elle disait: il s’est réveillé ? L’autre ajoutait: on va enfin avoir le fin mot de l’histoire !
La première répétait il s’est réveillé ? La seconde répétait on va enfin avoir le fin mot de l’histoire !
Je me redressai et vis deux visages qui me ressemblaient et qui n’arrêtaient pas de répéter à tour de rôle leur phrase respective. Je n’eus qu’une seule idée en tête, les faire taire une bonne fois pour toutes. En fouillant dans mes poches ( plus fictives que réelles) je trouvai deux glaçons qui n’avaient pas fondu et je les envoyai avec l’énergie du désespoir sur les faces criardes. Qui n’a jamais commis de mauvaise action me jette la première pierre ! Les deux visages se crispèrent et éclatèrent comme des bulles de savon. Je remarquai deux gouttes de sang sur le drap qui me couvrait et je ne pus m’empêcher de ricaner comme un enfant pris en flagrant délit de méfait. Et tandis que ce sang reconstituait ma chair mon esprit s’estompait.
Nuit féline
La nuit c’est bien connu tous les chats sont gris. Mon œil ! Moi, quand je me promène tranquillement, longeant tel un fantôme des rangées de réverbères assoupis, j’ai beau écarquiller les yeux, je ne vois jamais ramper un seul chat dans les rues. Aussi prétendre en plus qu’ils seraient tous gris relève de la plus pure affabulation. Admettons qu’en faisant un suprême effort je parvienne à scruter l’ombre furtive d’un félin miaulant pour réclamer la présence de la pleine lune, y verrais-je de la couleur grise pour autant ? Quand bien même le lourd manteau d’une nuit sans étoiles s’accrocherait tel un chat gris à mes épaules engourdies, serait-ce suffisant pour battre en brèche ma manière de penser ?
Ne serait-ce pas tout simplement les griffes de la nuit qui voudraient réveiller ma coupable léthargie ?
Cessons un court instant d’être un peu trop sérieux.
Quand les lumières de la ville s’allument au firmament des édifices, reléguant la nuit à un décor de faire valoir, quand le vacarme des voitures oubliant la perte du jour s’amplifie jusqu’à perdre toute notion de prudence, quand les cris des passants, titubant, chantant, dansant, éclaboussent l’obscurité d’éclairs fulgurants embaumés d’alcools, le doute n’est plus permis. Les chats n’ont qu’à bien se tenir. Les noctambules sont de sortie et la nuit tous les noctambules sont gris.
Pharmacien d’officine, lui qui n’aimait pas le commerce, Gérard Cukier dit avoir « empoisonné » le bon peuple de France pendant quarante ans tout en se « désintoxiquant » par l’écriture de poèmes, de récits « loufoques » ou de
textes sociopolitiques. Son écriture est longtemps restée solitaire avant de s’ouvrir à la convivialité dans des ateliers d’écriture organisés sur le net par un copain (les « Scribouillards » » puis les « Gratte-papiers »).
Rêveur, utopiste et idéaliste, Gérard Cukier dit de lui-même : « Je suis né partagé entre deux idées. L’idée de la science et l’idée de l’art. Et dans la science ma préférence allait à la biologie et à l’astronomie. Et dans l’art me faisait signe la littérature. Et entre les deux voguait l’ Histoire. […] Ma femme m’a dit que j’étais né sous le signe des 3 P. : poète, prolétarien, pharmacien. Sauf erreur de sa part je suis aussi paresseux, passionné, philosophe. »
***
Jean-Jacques Brouard
Voyage en Anthropie (extraits)
40.- Au pays de Loop, tout est courbe. C’est dire la difficulté de regarder l’autre droit dans les yeux ! De plus, tout voyage s’apparente à une circumnavigation compliquée… On n’est jamais sûr d’arriver à bon port. On louvoie sans cesse entre les obstacles et l’on finit par faire des ronds, des spirales, des cercles concentriques… et l’on finit par courber… l’échine… La végétation, courbe elle aussi, s’enroule tant et tant sur elle-même qu’un arbre finit par devenir un sac de nœuds encombrant et inextricable que l’on ne peut défaire qu’en le tranchant d’un coup de sabre. Mais l’arme, courbe, elle aussi, n’est pas très fiable et on risque de se blesser. On appelle une ambulance, elle arrive, elle approche mais la trajectoire qui s’incurve à mesure la fait passer à quelques centaines de mètres. On ne vous voit pas et vous mourez en perdant votre sang qui jaillit en ellipse d’une blessure en demi-lune et suit la pente courbe vers les méandres du fleuve en arc-de-cercle.
41.- L’Onirisia est à l’origine un immense pays de plaine, mais les paysages y changent sans cesse selon les fantasmes de ceux qui les traversent. Certes, la plupart des habitants sont de doux rêveurs et les modifications sont inoffensives, mais l’on conçoit aisément que cela ne facilite pourtant guère la tâche du voyageur qui ne reconnaîtra jamais l’endroit par lequel il est déjà passé une fois.
Il va donc sans dire qu’on erre beaucoup en Onirisia, car les cartes sont inutiles et il serait fort absurde et risqué de demander son chemin à quiconque : le riverain interrogé en effet, qui peut très bien être en train de ne penser à rien, se met alors à imaginer le lieu en question qui aussitôt s’altère et devient un ailleurs évolutif désormais méconnaissable et inconnu de tous.
Le mal absolu, c’est le mauvais rêve. Même si c’est extrêmement rare, certains habitants ont le malheur d’être malades, d’être sujets aux cauchemars : du fait de leurs visions démentes, ils engendrent des aberrations effrayantes, des gouffres, des monstres. Ils rendent le pays invivable, l’existence périlleuse : c’est pourquoi on les traque, on les chasse, on les brûle. Pour éviter de contracter ce mal, beaucoup évitent de dormir et se forcent à toujours penser la même chose du même endroit. Plus le conformisme règne, moins le pays bouge : c’est le secret d’un bon gouvernement.
43.- A Moloa, l’allée rectiligne surgit d’un bois profond et épais dont les limites ne sont définies ni par une connaissance du terrain ni par une carte précise que l’on pourrait trouver à vendre dans les débits de tabac ou dans les librairies de bourgade. Le territoire de Mwabondie est encastré entre des montagnes de moyenne altitude dont les sommets sont souvent noyés dans la brume et dont le climat est déterminé par l’océan proche au sud. Un peu au nord, une langue de mer pénètre profondément à l’intérieur d’une vallée que l’on appelle Hessonfwe, « la glissade du serpent », dans une langue ancienne dont les locuteurs sont depuis longtemps éteints.
La capitale, Bilolo, est pratiquement inexistante : les rares villes sont en effet diluées dans une nature exubérante ou règne la luxuriance et l’anarchie naturelles des temps primitifs. Il faut dire que le peuple indigène qui partage ce territoire avec les envahisseurs successifs n’a aucun idéal de progrès matériel tel qu’on peut l’imaginer. Les autochtones prônent une existence sereine où les désirs doivent absolument être assouvis dans l’instant. Mais il est parfois de bon ton de ne pas céder à tous ses désirs et de préférer l’inaction à leur assouvissement, ce qui fait que l’étranger, dans un jugement hâtif, a toujours tendance à qualifier le peuple sédentaire qui occupe ce territoire de capricieux, d’imprévisible, de paresseux et d’oisif. Il est vrai que la plupart des tribus ont une tendance fâcheuse à la gourmandise ou à la temporisation : « tout, tout de suite » ou « toujours repousser au lendemain ce que l’on peut faire le jour même », tel semble être leur principe alternatif de vie, au grand agacement des occidentaux qui cèdent souvent à la fébrilité de l’industrie et ne comprenne pas cette nature bipolaire. Dans le centre de la Grande Terre, là où la forêt recule en raison d’une sécheresse imputable à la proximité des sommets où se vident les nuages, sur de vastes surfaces qui bordent un désert assez aride, il tombe quelquefois assez d’eau pour cultiver les céréales et certaines plantes comestibles que les occupants du continent cultivent opiniâtrement depuis le passé le plus reculé. C’est là que l’on peut trouver la plus importante densité de population, mais elle n’est guère élevée : quelques hameaux et des fermes égrenées le long des rivières.
Les animaux sauvages y sont rares et le mode de vie se rapproche à quelques exceptions près de celui des gens du haut moyen âge. Plus au nord, cependant, l’altitude et l’humidité favorisent la croissance de toutes les essences d’arbres qui a abouti à la formation d’une des forêts septentrionales les plus foisonnantes et les plus denses du continent. Toutefois, en raison du relief tourmenté, des vents violents et des précipitations qui ne le sont pas moins, c’est aussi une des régions les plus hostiles du pays. C’est pourquoi son exploration est restée jusqu’à ce jour très incomplète.
Les hauts plateaux sont séparés de la pente douce des monts littoraux par une vallée en forme de U écrasé. C’est là que s’étend une forêt tropicale des plus inextricables dont l’exploration est rendue problématique par le pullulement d’insectes extrêmement venimeux, une région dépourvue de peuplement humain, à l’exception de la tribu de Wakawombas, paradoxalement fort bien adaptés pour des raisons mal déterminées à un mode de vie particulièrement difficile.
L’océan qui vient ronger les côtes calcaires est un des plus poissonneux du monde mais ses rivages sont infestés de requins et le découpage déchiqueté des côtes rend toute navigation compliquée à cause des hauts-fonds, des îles et des récifs disséminés du nord au sud à quelques milles des criques ou bien trop près des caps.
Au bout de l’allée, s’élève le temple noir en l’honneur du dieu des non-dits : on y vient de très loin pour le culte secret de ***.
On arrive le soir, on se fige, on psalmodie et on attend l’aube !
44.-A Dyschronos, le temps est élastique et inégal. Les jours varient en longueur : on ne sait jamais vraiment quelle heure il est. Les indigènes ratent constamment leurs rendez-vous; aussi la vie sociale y est-elle erratique. On ne parle que du temps passé, du temps perdu, du temps mort, du temps présent. Il n’est jamais question de futur… ou alors sur le mode funèbre. C’est que l’avenir est si incertain : lorsqu’un projet aboutit, ce n’est que le fruit du hasard.
45.- Au pays d’Entretemps, pour des raisons obscures, le crépuscule offre des propriétés singulières… Arrivé au trois quarts de sa course, l’astre solaire ralentit et reste comme suspendu pendant un temps indéfini. Ainsi, le coucher du soleil est l’un des plus lents de l’univers, comme si la planète renâclait à entrer dans l’ombre… En vérité, ce ralentissement est purement subjectif : ce sont les habitants qui, par une sorte de douce hystérie collective, jouissent ainsi le plus longtemps qu’il leur est possible des derniers rayons de soleil de la journée. A l’origine de cette propension, l’angoisse de l’obscurité… profondément enracinée dans les tripes des hommes depuis l’aube des temps anciens.
Extraits de Voyage en Anthropie – 2020
Cf. le site de la revue Décharge : https://www.dechargelarevue.com/Voix-nouvelle-Jean-Jacques-Brouard.html