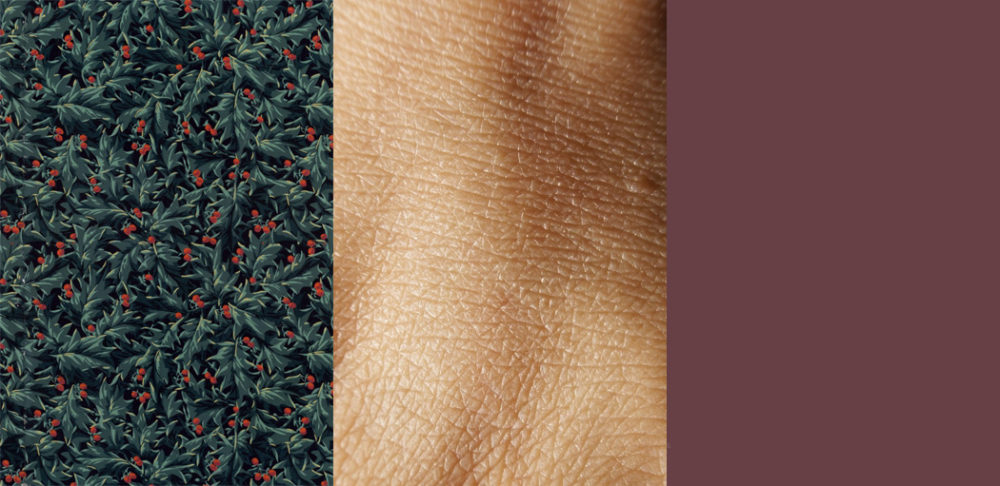Au départ, il n’y avait qu’un être pervers qui ne pensait qu’à nuire à ses hôtes, un sadique polymorphe ou bien une créature préhistorique, anhistorique, occupée à écraser entre ses ongles des poux infects que nul n’adorait, contrairement aux prétentions de Lautréamont qui en soulignait le caractère quasi divin… A évoquer ces bestioles qui épouvantent les mères de famille, le narrateur alimente la théorie kristevienne[1] de l’intertextualité que les professeurs de littérature enseignent toujours et partout à des générations d’étudiants en lettres dans les universités nationales. Toujours est-il que, comme on écrase les poux entre ses ongles, on écrase ses fantasmes sur l’enclume de la loi avec le marteau de la raison. Un esprit synthétique obsédé par les arcanes de l’analyse sémiotique irait jusqu’à dire qu’il existe un point commun entre un tueur et un écrivain pour des raisons liées à l’universalité des opérations logiques qui sont l’un des fondements essentiels de l’humanité : union / addition, inclusion / intersection, exclusion / différence…
Le tueur exclut sa victime de l’humanité à laquelle lui-même n’appartient que partiellement (intersection) ; en tuant sa victime, il recherche l’union intégrale avec l’être-humain en étant soi sans restriction aucune, selon la théorie de l’ignoble marquis. L’écrivain, en s’excluant du monde de l’action, réel et matériel, cherche l’union intégrale avec l’idée qu’il veut partager avec son prochain par un jeu d’intersection et d’inclusion qui s’apparente à une sorte de possession mentale : en tirant le lecteur hors du monde, il le fait entrer dans un monde fictif qui va l’englober et le retenir prisonnier, le temps de la lecture. Toutefois, au sortir de celle-ci, il lui restera une partie de l’entité suggérée par l’auteur qui a ainsi injecté des éléments de son ensemble dans l’ensemble que constitue la conscience de son semblable. Tout ce qui se passe au monde est une communication : en ce sens, commettre un crime et écrire un livre sont des activités parallèles. D’ailleurs, tout lecteur qui se respecte voudra bien admettre qu’un livre est une scène de crime : on infère un sens des indices laissés volontairement par l’auteur. Plus un auteur est subtil, plus les indices seront difficiles à interpréter. Parfois, le texte est immédiatement lisible : le crime est compréhensible, la faute caractérisée, le sens (le mobile) évident, l’assassin démasqué. C’est décevant. Un bon livre mérite une investigation profonde, une quête exigeante du sens, d’où l’intérêt des relectures dont on ne se lasse jamais.
Mais en quoi consiste donc le crime de l’auteur ? En une révélation complexe qui implique à la fois sa nature profonde, son essence et son existence… En se livrant corps et âme dans son texte, l’auteur se rend coupable d’un écart, d’une impudeur et d’une indécence, qui le différencient du commun des mortels : c’est scandaleux. Mais le lecteur n’est pas innocent non plus, loin de là : il lit ce qu’il est, même sans le savoir. De surcroît , la lecture a le pouvoir de le faire devenir lui-même… ou un autre. D’une certaine manière, la lecture est bien ce vice impuni dont parlait Valéry Larbaud.
En somme, écrire un livre, c’est d’abord céder à un narcissisme galopant, puis à une fièvre de la représentation, enfin à un syndrome démiurgique suspect. Et lire un livre, c’est bien vouloir se retirer du monde, consentir à céder aux illusions, à s’abandonner aux sortilèges et choisir délibérément de devenir un voyeur solipsiste.
Qu’importe ! Vive l’impunité de ces deux vices !
Et puis, enfin, il faut bien tuer le temps…
[1] Réf. à Julia Kristeva