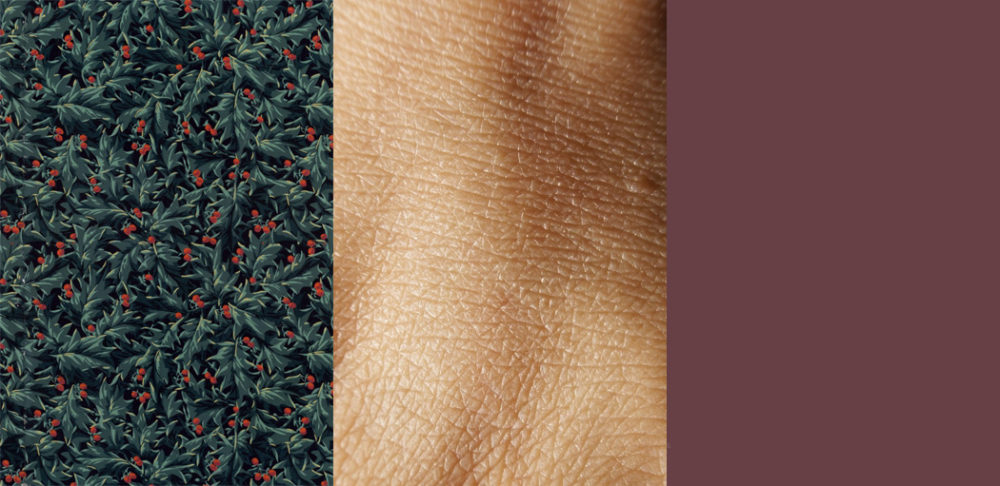La lecture des « Rébellions inutiles » bouleverse l’ordre établi des mots et des choses et bouscule les convenances poétiques. On ne sait plus à quoi s’attendre : là est la magie. Le poète nous fait « le plaisir d’aller à contre-courant des adjectifs », de « devenir une marée de consonances inédites »… Il ne cesse de nous surprendre et nous enchante par ses attentes exigeantes et ce qu’il en dit, avec humour : « J’attends l’abîme, le gouffre que je ne suis pas capable de construire. Je l’imagine. » (1) ; « …j’attends l’arrivée d’un jeune auréolé de lumière. »(12). Et, après avoir affirmé que « C’est dans les attentes que les sentiments sont les plus authentiques. » (23), il décide que « l’attente est un bruit plus fort que celui de la révolte » (1)…
Cette attente obstinée s’inscrit dans une quête envisagée avec humilité : il s’agit d’ « … imaginer des sacrifices qu’on sera incapable de commettre. ». Une quête à l’issue incertaine donc : « On espère trouver le geste parfait qui nous libère. ». L’on sent bien ici à la fois l’ambition et la modestie. Ȏ Paradoxe ! Paradoxe que l’auteur cultive avec délectation, paradoxe que le titre « Les Rébellions inutiles » illustre bien quand on découvre dans le corps du recueil l’irrépressible nécessité de la rébellion malgré la conscience de sa vanité. Virtuose du chleuasme ravageur, s’il aspire à « devenir une constellation », Miguel Ángel Real ajoute aussitôt que cette ambition n’est qu’ « un délire d’aspirant à démiurge pris dans la peur d’une nuit imparfaite. » (8). C’est qu’il se veut conscient des « erreurs que l’on commet par naïveté parce qu’on ignore ce qui est inutile » (4).
Ses poèmes sont traversés par la volonté de mener « cette lutte contre notre propre ignorance qui se dresse comme le seul combat valable au milieu des journées où les certitudes déposent l’opacité de leur voile » (17)…
Et si cette quête est toute tendue vers un idéal (« le geste parfait qui nous libère… »), l’humour se glisse dans « …cette recherche de pureté que contredisent les odeurs d’un enfer imaginaire ». Çà et là, affleure le constat désabusé de la vanité des choses et des sortilèges de la représentation. Avec humilité et rire en coin, le poète avoue qu’il ne sait « …pas très bien
ce qu’est une forge. » (12), voudrait « être capable de revendiquer l’ignorance » (14) et juge – avec , là encore, une certaine ironie tournée vers soi –, que « la tromperie de l’image consiste à glacer les veines des instants jusqu’à faire de nous des démiurges de pacotille. » (45).
Au-delà du constat que « les images se fanent dans leur cadre doré. » et que « les vêtements passés nient toute persistance. » (22), il affirme qu’ « il y a dans le geste même de l’écriture, une prétention de façonner, une posture… » et considère « l’absurde de ces gribouillages qui, loin d’être un fleuve opiniâtre qui a su transpercer les montagnes, ne peuvent altérer le cours d’une vie. », conscient de la « naïveté des pages pour construire un quelconque refuge. »(35). Plus loin, il nous fait sous-rire avec « Muses : paresse. » (25).
Par-delà le paradoxe et l’humour, la poésie de Miguel Ángel Real exprime la violence de la création, de la re-création… Il s’agit d’abord de « dévorer le monde », de s’insurger (2), il faut qu’il « arrache la peau de ce rocher pour aider les phares à s’écrouler» (2)… il appelle à « casser la clé dans la serrure » (7). Mais cette destruction est un préalable à une
métamorphose, une renaissance, une transfiguration : « Je parle et je me rebelle, j’écris et je vomis, et ensuite je m’endors bercé par la transparence du papier qui dévoile sans vergogne l’envers de mes traits. » (2). On est alors convié à une transmutation par la création poétique : les mots permettent tous les prodiges comme « Faire plier ma fourchette par la simple force de l’esprit. » Et par la simple force de l’esprit poétique, Miguel Ángel Real prépare « les mots dans un chaudron de sorcière » (3), ce qui lui permet d’ « imaginer alors au loin un palais aux miroirs brisés » (20), de « modeler des instants à (sa) guise : les altérer, leur imposer (sa) propre hiérarchie, recréer un monde. » (45). Il scande l’ « insurrection du verbe » (2), convoque « le mot qui mord » (2). On sent, dans ce recueil, une volonté de puissance verbale, l’ambition d’une démiurgie (« Je demande seulement une chose : garder mes forces pour cracher et penser au bruit d’une réaction chimique qui décompose le granit des archivoltes. » (14). Mais peu après, c’est l’éternel retour d’une vision lucide des limites : « Je prétends être un sculpteur de canyons mais je n’ose pas brûler mes idoles de cuivre. » (27).
Ici, l’écriture apparaît comme « une nouvelle envie banale de renaissance et la maladresse perpétuelle d’un effort que l’on consent pour croire que l’on fait croire. » (28). Là, elle est une impérieuse exigence : « le papier, sa blancheur haletante et affamée, vide dans son attente comme un miroir parfait. ». Plus loin, c’est une épreuve, un mystère : « Et le secret de l’écriture ? On marmonne, on bafouille, et l’équilibre se fait rare quand les coquelicots viennent s’immiscer parmi les cicatrices. » (36). La seule certitude, c’est qu’il lui faut absolument écrire « pour maintenir intacte la brûlure qui doit jaillir de nos poumons. » (36) … Cette ascèse exigeante le pousse à « …tenter de trouver les paroles qui soient capables de définir la relativité des nuages. » (41). Autant dire une quête sans fin – « Je me suis levé de bonne heure, une fois de plus à la recherche de la phrase idéale. » (46) – grand-œuvre ardu car « décrire le poison […] est une autre tâche, peut-être digne d’un temps où rien n’existe car nous réduisons tout à des impulsions électriques. » (50)… A cet égard, le poème realien a parfois, assez souvent même, la noblesse du fragment laconique : un trait incisif, un aphorisme teinté d’humour (« La raison, le courage, la marée : un seul définit la constance. » (77), l’aiguillon d’une pensée philosophique qui n’est pas sans rappeler le style des moralistes du XVIIe siècle (La Rochefoucauld, Chamfort, La Bruyère ou Pascal).
Et la rébellion qui couvait entre les lignes éclate au grand texte : « Je maudis la perfection du cercle, la force des antennes qui détruit ma solitude » (14). Il faut « échapper à la perfection liquide de l’après-midi. » (20). Insurgé, comme le fut Michaux, contre l’état d’un monde où l’« on dresse des barrières pour éteindre l’autre » (15), où « Les frontières sont des fils de soie et de mensonges. Barbelés dérisoires. » (44), Miguel Ángel Real lève son poème contre les vérités établies, contre les évidences et les dogmes : « Plutôt que la vérité des dogmes, les infinies variations du bourdonnement des abeilles. » (1). Il se moque des usages convenus qu’on observe dans une salle de concert où « les spectateurs sortent leur exigence de leurs poches et se flattent à voix basse… » (48), il se dresse « contre les livres qui apportent les réponses à chaque question. » (15), contre l’habitude : « la même promenade dans une ville déjà visitée. Mais en changeant le rythme de ses pas. ». Et pourtant – retour de paradoxe – « La routine est aussi une rébellion. » (23), mais – attention ! – c’est à condition de l’«attendre », d’ « en faire un but» afin de « se réveiller » ailleurs. Et si les vertus du voyage sont souvent exprimées, il arrive que… « Nulle envie de voyage : au contraire, les vertus de l’inertie. » (35).
Allergique à la bêtise ambiante du siècle, Miguel Ángel Real brandit la puissance du verbe : : « Les paroles résistent toujours devant l’ineptie car ce sont des barrières fragiles mais infranchissables. »
Mais se rebeller pour notre poète, c’est aussi traquer l’illusion. L’illusion du savoir déjà mentionnée : « les caprices des côtes sont la base de nos ignorances. » (75). L’illusion que l’on se fait : « On appelle tropismes les contraintes comme pour adopter un ton sauvage qui fait défaut à nos journées monotones et continuer de croire aux objectifs à atteindre. » (67). L’illusion des sens, ensuite : « Je traverse la ville, la nuit, en admirant les mirages sur les vitrines pour me croire plus libre. » (64). L’illusion du sens, enfin : « Face au besoin de réconfort, les vocables flottent toujours enveloppés dans leur forme imparfaite. » (90). Et cette imperfection engendre « le rêve récurrent de la parole incomprise. » (76)
Pourtant la rébellion n’exclut ni la contemplation ni le questionnement. Elle en est l’eau nourricière. Cette poésie originale – et résolument métaphysique – est toute travaillée des veines de perception du monde et des remous de sensations : « Il y a parfois des dimensions de rivière dans l’encre qui sort de ma plume. » (51). Elle interroge à la fois l’être-du-monde et l’être-au-monde.
Dans l’attente – qui est aussi « promesse » –, s’impose la force du regard (« je vois » (1), « je regarde » (2) jusqu’au « vertige » (3).) Regarder, donc, « Et sans au-delà, voir. » (19).
Le monde est posé là devant l’œil, à portée de main, à caresse de peau. Et s’impose alors dans les textes la présence incontournable des choses et des êtres, textes qui sont un constant rappel à l’ordre de la matière (« un pot en terre cuite, un chemisier en soie… » (59) ; « écrasé par la froideur du granit » (61), « Il faut avoir gravi les dunes pour que nos muscles apprennent à nous dire d’être humbles. » (70), etc.). Attentif à l’« épaisse barrière de ronces » « au fond de la vallée » sous « la lancinante asymétrie de la pluie » (72), le poète sent l’univers et pèse le sens : « Peu à peu, les sens récupèrent leur inertie et jouent à découvrir des volontés dans la disposition géométrique des champs, dans la silhouette lointaine et mauve des prochaines montagnes, dans les rares arbres… » (100). Il se livre à une subtile exploration de « la carte du monde », « au hasard des pas ». Hautement sensible à ce qui est, à ce qui a lieu, il ne néglige rien : aucun événement – si infime soit-il – n’échappe à sa perception et à sa pensée : qu’il s’agisse de « l’instant où le papier absorbe l’encre. » (19) des « trajectoires éphémères » (20) des enfants qui courent dans l’herbe ou encore du fait que « porté par le temps, chaque grain de sable avance vers la poussière. » (21).
Fasciné – comme Francis Ponge – par les objets et les créatures, – « la texture du papier » (25), les insectes, le bruissement de l’ongle sur la peau – , il « redécouvre un dense plaisir étonné » (29) dans la contemplation de l’insignifiant essentiel, qui est une volupté de l’instant : « Le vœu, le tonnerre : que mes vêtements s’imbibent de l’odeur du présent. » (29). L’alchimie métaphorique nous prend au dépour-pas-encore-vu : ainsi le simple geste de peindre un mur devient la « danse initiatique » d’un «bâtisseur de cathédrales qui n’oserait pas clamer son absence de foi. » (34) et « le sens des responsabilités […] prend parfois […] la texture de ces fauves dont on ignore tout. »
La fascination du monde est à la fois source d’inspiration et interrogation : « A l’origine, l’ensorcellement d’une carte qui dans un clair-obscur semblait éponger nos questions. » (24).
L’écriture poétique est une constante remise en question de l’être-au-monde (« A quoi cela tient que je sois là »), si bien que le poète est celui qui a « des mains qui dessinent une question plutôt qu’un sortilège efficace. » (3) et qu’il fait « « un trait sous les ratures, pour confirmer la permanence des questions. » (31).
Et la question qui revient souvent, de manière implicite ou explicite, est « Pourquoi ? » ( « un écho sourd – pourquoi moi, pourquoi moi -… » (42)).
C’est en ce sens qu’on peut dire que la poésie de Miguel Ángel Real est métaphysique, sans pour autant avoir recours à une quelconque transcendance : « Nul besoin de Création […]… seule compte la recherche du sens. » (38). Dans l’espace désacralisé de la création poétique, sa poésie profane décoche avec un humour borgésien : « Et dans les chapelles, le passé des chaires est un poids qui ne brise même pas les cages thoraciques des papillons. » (39). Sa poésie est exi-stance, une méditation sur le temps, la mémoire et l’oubli. Pour le poète des «rébellions », « le monde qui change aime un type de vitesse qui n’est pas celle des graines dans la terre. » (49) et « l’horizon est une impasse entre oubli et origine » (79). Son être-au-temps est à la fois défiance des « temps noirs », recherche de « la meilleure tactique pour cultiver l’oubli » (69) – oubli dont « Au loin, une tour » (74) est la « promesse », oubli qui est « la définition de la peur d’affronter les caprices de la mémoire » – , volonté de « maîtriser le temps d’une moue simple » (83) et humble conscience du temps (« Humus : dans une seule image, le passé, le présent et l’avenir de la forêt. » )
Miguel Ángel Real nous entraîne, par son écriture maquisarde et ciselée, dans le labyrinthe du sens où chaque bifurcation dans le jardin de l’imaginaire est un défi à la pensée. Inutile de dire que sa poésie ne saurait se résumer à ces quelques commentaires (du « verbiage illicite » selon George Steiner, in « Réelles présences », Gallimard 1989 ). Elle a une part d’énigme qui fascine et envoûte et une profondeur qui envers-tige. Elle exsude un humour subreptice « qui n’admet pas les certitudes », tout de sagesse et d’humilité, à « s’arracher la croûte ». Rébellion contre l’illusion et l’évidence, poésie contre-toute-attente, elle est une ascèse sensuelle où le paradoxe est un « acide sans faim », où l’infini sourd de l’infime et où l’espace et le temps se conjuguent au subjectif cosmique. Une poésie rebelle, inutile, mais belle, qu’il est absolument essentiel de lire pour « ne pas oublier notre condition humaine », « devenir volute, feu, brûlure, cendre tombée, vent, à nouveau rien. » et « s’imbiber de vertige ».
Jean-Jacques Brouard