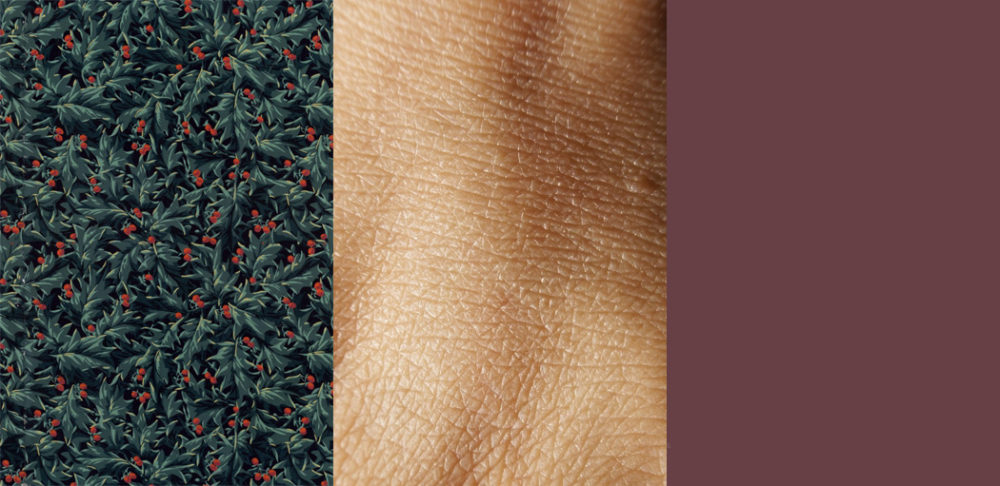Celui qui me voulait du mal
Je sens la confusion de nos âmes ; je ne sens pas nos âmes se confondre.
André Gide
Pour parler sans détours, les années que je connus au collège puis au lycée, le furent dans leur totalité à mes dépens. Je ne crains pas ici de le dire ; j’étais exposé à mon propre blâme. En aucunes façons je n’ai pu m’efforcer d’être heureux. Mes maigres tentatives furent désavouées dans leur totalité, si bien que je devais sombrer dans une nuit telle que seulela vieillesse pouvait à mes yeux laisser en imaginer de pires.
L’envie se fit, quoi qu’ici le mot soit impropre, de souhaiter rompre avec la vie. Joignons à tout cela que m’étant pris à me détester, je reportais cette détestation de moi-même sur autrui, et, moi qui avais été un enfant solaire, porté par une grande vitalité, toujours entouré de mes nombreux camarades, il apparaissait que je ne méritais plus l’estime de quiconque.
Quant à l’Amour, il était de tous les mots les plus éloignés de ma vie, le plus méconnu, son énigme même m’était trop distante et de fait, interdite.
Quels temps d’adversités !
L’immoralité ou la vertu de mes coreligionnaires n’étaient pas en question. Simplement, je suspectais tout le monde de me haïr, de trouver insultant ma présence à leurs côtés, pour les raisons que mon corps était laid, mon visage tout autant, et mon esprit trop aggravé par le mal qui le rongeait : cette haine de soi que ne saurait diminuer la pitié des autres.
Si les blessures creusées par de si térébrantes années se sont refermées sur leur chimérique nature dysfonctionnelle, par l’action du temps qui apaise les maux, je ne sais ce qui m’a pris aujourd’hui, comme je levais les yeux des carnets de Camus que je lisais au café, de me représenter en esprit celui que j’étais, marchant voûter vers le lycée Louis Feuillade, et passant le matin devant un concessionnaire de pierres tombales, m’arrêter pour en observer les modèles et prototypes disposés en vitrine. Il me revient qu’un jour, me tenant ainsi dans le petit matin nocturne et glacé de l’hiver devant la devanture, un garçon qui était en terminale me poussa contre la vitre et m’écrasa le visage en pressant sa main sur ma nuque, pour finir par proclamer, transfiguré par une haine qui m’était incompréhensible et me rappelait celle de mon père :
Je ne veux plus que tu vives ! On me dégagea de son emprise, des voix en appelèrent à sa raison, et ce criminel repartit libre comme s’il eut été innocent de la violence dont il avait fait montre à mon endroit.
Je me souviens m’être senti si enfoncé dans l’infortune que, de toute la journée, je n’écoutais rien de ce qui se dit en classe, marchant comme un automate avec des jambes de plomb, mangeant le midi avec la boule au ventre.
Je l’attendis le soir après la fin des cours au niveau du grand portail par lequel transitaient les élèves. Parvenu à son niveau, je me mis en travers de sa route.
« C’est quoi ton problème sale babouin ? demanda-t-il. Qu’est-ce tu veux ?
– Me tuer.
– Eh bien, bon débarras ! Qu’est-ce que tu veux que ça me foute ?
– Mais avant, j’ai une requête à te demander.
– Ah oui ? Avec ta bouche qui pue ?
– Je veux que toi, le type qui m’a prouvé être celui qui me déteste le plus au monde, vienne pisser sur ma tombe ».
Pour toute réponse, il me cracha dessus puis aplatit sa main, les doigts écartés en étoile et me repoussa avec une telle force que je tombais en arrière. Il me revient que des filles gloussèrent. Je me suis trainé, perclus d’humiliation, non pas le long de la route qui aurait dû me mener vers le bus pour que je rentre chez moi, mais dans le sens opposé, jusque dans les vignes, sur la terre craquelée et froide. Je voulais me trouver un lieu où je pourrais souffrir comme une bête sans que personne ne puisse me voir.
Pourquoi écrire ceci ? L’étrange est que dans une moindre mesure j’éprouve une sorte de gêne à l’idée de ne pas me souvenir du nom de mon meurtrier. Peut-être même ne l’ai-je jamais su ? Il me revient que ce soir-là, allongé sur mon lit, je fus épris d’un incontrôlable sanglot en entendant des chansons qui rencontraient le succès du Top 50 à la radio.
Jamais l’idée de la mort, en cet instant, ne m’était apparue si familière et si douce. J’entrevoyais en moi une délivrance possible et plus que jamais souhaitée. En finir !
Je desserrai mes poings et fermis les yeux, m’employant à tenter de me représenter ce que pourrait être le néant. Ne plus exister.
« A table ! » cria alors la voix de mon père. Il me fallait me dépêcher, dit ma mère en apparaissant dans l’encadrement de la porte, sans quoi j’allais manger froid.
De plus le film à la télé venait de commencer. Ce soir-là, Romy Schneider et Rod Steiger ne parvinrent pas à me distraire. L’impétueuse santé de la jeunesse était morte bel et bien, et le mal qui m’avait enveloppé tout entier l’était bien plus que les vertus de santé que l’on impute d’ordinaire à celle-ci, dont mes parents parlaient toujours avec une pointe de nostalgie, ignorants tout du fait que si j’avais eu ce soir-là en ma possession une arme à feu, je me serais brûler la cervelle, dans la niche, avec le chien.
Siri Hustvedt a écrit dans son Plaidoyer pour Eros dans la lecture duquel je m’absorbe en ce moment : Les métamorphoses de la personnalité sont liées à l’endroit où l’on se trouve, et l’identité est dépendante d’autrui. On ne saurait mieux dire !
Dans mon adolescence, j’ai vécu au mauvais endroit avec les mauvaises personnes.
Souvent, plus tard, jouir du corps d’une femme ne laissait pas de me rappeler qu’après cette terrible journée, j’étais allé me recroqueviller dans la niche avec le chien. Les frissons de plaisir de l’innocence bafouée se mêlaient à la mauvaise odeur et la sainte chaleur de la bête.
Récemment, j’ai revu celui qui me malmena tant. Seul son nom de famille me revient.
Lambert. Je jure qu’il s’est bien agi de lui. Il était assis, bedonnant, en jogging sale, le cheveu gras, un sac de la marque Tati à ses côtés, sur un banc de la place de l’Esplanade, à Montpellier. J’en conclus immédiatement qu’il vivait dans la rue. Je prenais un café juste en face de lui. Il lui était impossible de me reconnaitre, car mes yeux étaient cachés derrière des lunettes noires, et son regard indiquait qu’il n’était pas dans son état normal, tenant à la main une bouteille de vin, et bredouillant seul dans sa barbe, pour, de temps en temps, finir par pousser un cri effroyable, qui était plus une manière d’agonir que d’agonie.
Il n’avait pas de chaussures aux pieds. Nous étions en été, ce qui, évidemment, portait moins à préjudice. Mais quelle vision ! Quelle image d’un homme seul, aviné, en déshérence. Se pouvait-il que je ne pusse rien faire pour lui ? Le voulais-je seulement ? Oui, je le voulais.
Je m’approchai de lui et m’assis à ses cotés sur le banc. Il me demanda si je n’avais pas une cigarette. Je lui tendis mon paquet et lui dis de le garder.
Il me dit, avec une légère nuance d’ironie dans la voix : « Du coup, est-ce que je peux vous offrir une cigarette ? » me tendant en retour le paquet ouvert. J’en pris une et nous fumâmes un moment en silence.
« Ah, Montpellier, quelle belle ville, dit-il enfin, pas vrai ?
– Oui, en effet, dis-je, pour ne pas le contredire.
– Jamais je ne partirai d’ici, fit-il observer. C’est le plus bel endroit du monde, et je peux vous dire que j’ai roulé ma bosse. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud… Mais ici, c’est un petit ilot sacré.
– Et qu’est-ce qu’il a de si sacré ? me hasardai-je.
– Difficile à dire, marmonna-t-il. Très difficile, poursuivit-il d’une voix dolente.
Pour différents que nous fussions, je me sentis proche de lui, comme si sa douleur présente et mon ancienne douleur, sa solitude actuelle et la mienne passée, nous rapprochaient.
Je n’étais que de passage à Montpellier. Je détestais cette ville. Je n’avais qu’une hâte :
rentrer à Paris que j’affectionnais tant, retrouver ma femme, mes amis. Je ne pouvais pas aller plus avant dans ma présence aux coté de Lambert. Pour m’être aventuré à ses côtés à partager un bref instant une cigarette, je ne me sentais pas la force de lui divulguer mon identité ; au reste, je doutais qu’il s’en souvienne. Il ne restait aucune trace du mépris dans lequel je l’avais tenu quand nous étions au lycée. Je sortis de mon sac le livre de Georges Duhamel que je venais de terminer, une édition ancienne qui sentait bon le vieux papier, et dont les pages étaient mangées par le temps. Je lui demandais s’il aimait lire. Il me dit que non, il préférait parler aux gens.
Je lui demandais s’il accepterait que je lui lise un court paragraphe du livre que je tenais en main. Il opina du chef.
Je lus.
Quand j’eus fini, il me dit qu’il n’avait rien compris.
Je lui demandai s’il accepterait que je lui offre ce livre. Je dis cela en le lui tendant, si bien qu’il le prit dans ses mains aux doigts sales.
« Vous me donnez un paquet des cigarettes, vous me faites la lecture, et maintenant vous m’offrez un livre, mais qu’est-ce que je vous ai fait mon p’tit père pour mériter ça ? dit-il.
– Du mal, dis-je.
– Quoi ?
– Par le passé.
– Chuis pas sûr de bien capter.
– Ne faites pas attention », conclus-je.
Il me tendit sa bouteille. J’en bus une gorgée.
« Je suis un homme de bien, affirma-t-il d’une voix théâtrale. Ici, tous les gens m’aiment. Je suis une figure du quartier, comme on dit, de la ville tout entière même, et pourtant, cette ville, c’est bien la même qui n’a jamais voulu de moi ».
Il parlait comme s’il se prenait en pitié, qu’il témoignait quelque charité pour lui- même.
La conversation se poursuivit encore un bon quart d’heure, au cours duquel, rien dont je ne me souvienne ne marqua mon esprit. J’eus grand – peine à le quitter. Il me demanda si j’allais revenir. Je lui dis que oui, que j’allais faire quelques courses, et que je repasserai le voir.
« C’est pas tant que je m’ennuie tout seul, dit-il, mais je vous trouve sympathique.
– Merci.
– Et moi, vous me trouvez comment ? »
Je le fixai et lui dis : « Vous avez bonne mine ».
Là-dessus il éclata de rire, révélant une dentition en bien mauvais état. Il répéta : oui, je suis en pleine forme.
– A très vite, dis-je.
– C’est ça, en tout cas, tu sais où me trouver », dit-il plus familièrement en adoptant le tutoiement.
Quelle drôle de griserie ne ressentis-je pas en m’éloignant. Et combien, marchant d’un pas vif comme si je craignais d’être rattrapé par mon passé, il me semblait que je me lamentais, lors que je sifflotais une chanson ; oui, une lamentation se diffusait dans tout mon être.
Et c’est précisément ainsi que je me sentais : lamentable et heureux, le cœur aussi misérable que les paroles qui sortaient de ma bouche, issues d’une chanson mielleuse sortie de l’oubli.
Je n’ai jamais revu Lambert, jusqu’à l’été dernier, où je passais mes vacances à Montpellier avec ma femme et ma belle-sœur.
Il titubait dans la rue de Verdun avant de s’immobiliser devant le cinéma Le Royal.
« Allez tous vous faire foutre, hurlait-il. Soyez tous maudits ! Que la foudre du ciel vous frappe ! » Ses insultes n’étaient pas adressées aux passants, mais en direction des affiches des films exposées en rang d’oignon.
Je passai mon chemin. Il n’était pas grand-chose en cet instant que je pusse faire pour lui, ni pour moi, car ce n’étaient que les ombres de notre jeunesse qui nous recouvraient déjà.
Lui et moi n’avions rien en commun que celles-ci, et le désir que nos blessures reculent devant elles.